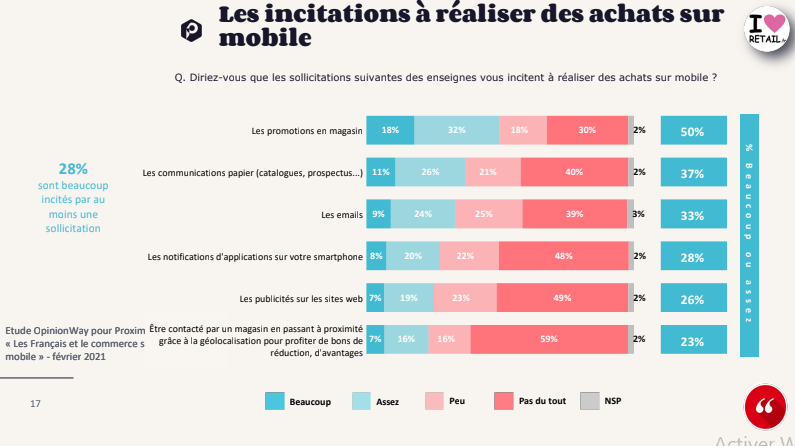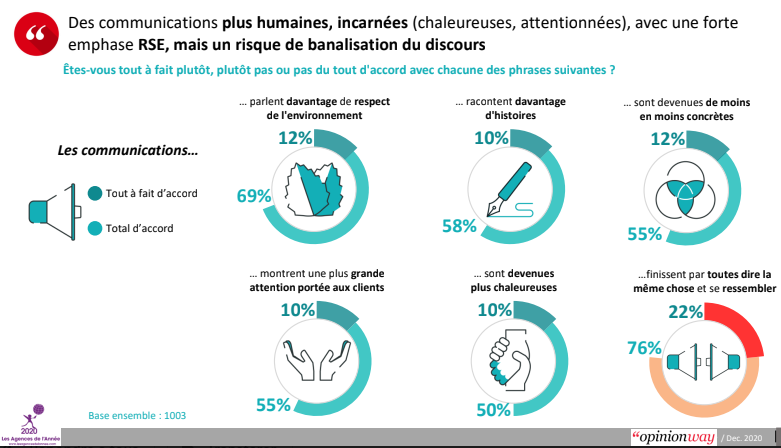Votre entreprise commence à décoller et vous souhaitez engager votre premier salarié. Comment procéder ? Comment gérer votre nouvelle recrue ? Lors de l’embauche d’un salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat, l’employeur doit respecter différentes formalités obligatoires dont la déclaration préalable à l’embauche (DPAE). Focus.
Les étapes de recrutement du premier salarié
Préparer l’embauche de votre premier salarié est fondamental pour l’avenir de votre entreprise. Procédez alors étapes par étapes pour cibler le meilleur profil :
- Déterminer le poste avec précision, en définissant les missions et les responsabilités que vous allez attribuer à votre salarié. Sans oublier les différentes perspectives de carrière
- Indiquer le profil requis, à savoir les compétences, la formation, l’expérience et les qualités humaines qui devront caractériser votre salarié.
- Sélectionner le type de contrat de travail selon le code du droit du travail en vigueur. Contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
- Lancer une offre de travail en précisant vos critères de sélection sans aucune forme de discrimination. Le contenu d’une offre d’emploi doit respecter certaines règles. Elle doit être rédigée en français (sauf exceptions) et être datée. L’annonce ne doit pas mentionner de critères discriminatoires sous peine de poursuites. Les motifs de discrimination relatifs à l’offre d’emploi s’appliquent également lors des entretiens.
- Fixer des entretiens avec les candidats dont les CV ont retenu votre attention pour mesurer l’engagement et les motivations du postulant.
- Embaucher et s’assurer de l’intégration de votre salarié grâce à une formation adaptée aux services proposés par votre entreprise.
- Fixer une période d’essai. Cependant, pensez à vous renseigner car la durée varie selon le type de contrat (CDD ou CDI) et la nature de l’emploi. Ainsi, cette période d’essai vous permettra de confirmer l’embauche ou de l’annuler.
A noter : La déclaration d’embauche du premier salarié permet à votre entreprise de s’inscrire auprès des régimes de protection sociale des salariés (CRAM, URSSAF).
Comment recruter ?
En tant que nouvel entrepreneur, vous ne possédez peut-être pas les compétences nécessaires pour recruter des employés. Pour cela, il est nécessaire de vous faire assister et d’évaluer les frais de l’embauche avec précision :
- Faire appel à un cabinet de recrutement. Néanmoins, le recours à un cabinet de recrutement vous permet de faire l’impasse de certaines étapes. Le cabinet se charge, lui-même, de sélectionner les candidats qui correspondent à vos attentes. Même s’il vous demandera de verser jusqu’à 20% du salaire brut du salarié, il vous évitera le temps nécessaire pour examiner une centaine de candidatures.
- Estimer le coût de l’embauche : Pour conserver l’équilibre de votre entreprise, vous devez tenir compte de toutes les dépenses liées à votre salarié : salaire brut, charges patronales (assurance, allocations, retraite, taxes sur le salaire), avantages (logement, nourriture, 13e mois, prime). Sans oublier les frais liés au travail (matériels et équipements).
Avant d’embaucher le candidat, assurez-vous qu’il y a un véritable rapport rendement/coût d’embauche. La présence de votre nouveau salarié doit être bénéfique pour le développement de l’entreprise.
- Transmettre au salarié le contrat de travail. L’employeur remet au salarié un contrat de travail écrit en fonction de la nature du contrat et l’informe du statut collectif en vigueur dans l’entreprise : convention et/ou accords collectifs applicables. Il informe le salarié de la mutuelle d’entreprise obligatoire pour tous les salariés et transmet au salarié une notice complète sur les garanties ouvertes lorsqu’un régime de prévoyance est en place dans l’entreprise. Il informe sur les risques professionnels et leur prévention.
Conseils pour gérer un premier salarié
Il ne suffit pas de trouver le candidat idéal pour travailler dans votre entreprise. Le plus important, c’est de savoir gérer cette nouvelle recrue et d’établir de bons rapports professionnels qui serviront l’intérêt de votre entreprise :
- Fixer un cadre de travail clair en déterminant les différentes tâches que votre salarié doit effectuer, les délais, le rendement attendu.
- Fixer une ligne de conduite : assiduité, ponctualité, politesse
- Gérer votre salarié avec souplesse dans le cadre du respect, de la responsabilité et de l’honnêteté (et non de la peur)
- Tenir compte de l’âge de votre employé. Le management d’un employé de 20 ans n’est pas le même que celui qui concerne un employé de 55 ans. Larry Page et Sergueï Brin, jeunes inventeurs de Google, ont su gérer une équipe d’un millier de salariés malgré leur jeune âge en établissant un climat de travail jeune et décontracté.
- Apprendre à gérer les débordements et la démotivation de votre salarié sans nuire à l’intérêt de l’entreprise.
A chaque personne sa perception de la gestion du premier salarié. L’essentiel, c’est de créer un climat professionnel, confortable et motivant aussi bien pour vous que pour votre unique « collaborateur ».
Remplir la déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
La DPAE doit obligatoirement être établie pour l’embauche de tout salarié, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail. Cette formalité est obligatoire sauf pour les petites entreprises (TPE-PME) ou les associations et fondations employeurs qui peuvent utiliser les dispositifs simplifiés. Elle doit être transmise à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) dont dépend l’établissement où travaille le salarié avant l’embauche et au plus tôt 8 jours avant. La déclaration en ligne est à privilégier, mais les employeurs ont encore la possibilité de remplir une déclaration papier. On peut l’envoyer par télécopie ou par courrierRAR.
A savoir. L’employeur doit établir la DPAE même si le salarié n’est pas encore immatriculé. Il doit demander ensuite au salarié d’effectuer les démarches auprès de la CPAM (ou la MSA pour un salarié agricole) de son lieu de résidence pour obtenir son numéro de sécurité sociale (ou NIR).
Sous certaines conditions, les petites entreprises (TPE-PME) ou les associations et fondations employeurs peuvent utiliser l’un des titres de paiement simplifiés. Ces titres incluent un volet de cotisations sociales, qui valent accomplissement de la DPAE :
- Titre emploi-service entreprise (Tese)
- Titre emploi simplifié agricole (Tesa) pour un salarié agricole en CDD de moins de 3 mois
- Titre emploi forains (TEF)
- Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso)
- Chèque emploi associatif (CEA)
Le particulier employeur d’un salarié employé à domicile dans le cadre des services à la personne peut utiliser le chèque emploi service universel (Cesu).
Les mentions obligatoires à inscrire sur la DPAE :
- Dénomination sociale de l’entreprise (ou nom et prénoms de l’employeur) et adresse de l’établissement
- Code APE de l’entreprise
- Numéro de Siret de l’établissement (ou le numéro de liasse délivré par le centre de formalités des entreprises, si l’immatriculation est en cours)
- Coordonnées du service de santé au travail dont l’employeur dépend, s’il relève du régime général de la sécurité sociale
- Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale du salarié (s’il est déjà immatriculé)
- Date et heure d’embauche prévisibles
- Nature, durée du contrat et de la période d’essai pour les CDI et les CDD supérieurs à 6 mois
La déclaration à l’inspection du travail
L’employeur effectue une déclaration préalable des personnes recrutées, par lettre recommandée, adressée à l’inspection du travail :
- Lors d’une nouvelle embauche dans un établissement qui a cessé d’employer du personnel pendant 6 mois au moins
- Lors de la déclaration de modification de l’entreprise (changement d’exploitant, d’industrie ou de commerce, ou transfert géographique)
Le récépissé de la lettre recommandée doit être présenté par l’employeur sur demande de l’inspection du travail à la première visite de celle-ci.
Le document à remettre au salarié
Une copie de la DPAE ou de l’accusé de réception doit être remise au salarié. Cette obligation est remplie si le salarié dispose d’un contrat de travail écrit, mentionnant l’organisme destinataire de la déclaration.
A noter : les sanctions en cas de non déclaration d’embauche
Si l’employeur n’effectue pas de DPAE, il s’expose à :
- La régularisation par l’Urssaf des cotisations de Sécurité sociale non payées du fait de l’absence de déclaration (sanction civile)
- Une pénalité de 1 095 € par salarié concerné (sanction administrative)
- Des sanctions pénales, car l’absence intentionnelle de DPAE constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Affiliation auprès des institutions de retraite complémentaire obligatoire
L’employeur a l’obligation d’affilier ses salariés aux institutions des retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco. Cette affiliation s’effectue par la transmission unique et dématérialisée de la déclaration sociale nominative (DSN) à l’ensemble des organismes qui gèrent la protection sociale des salariés.
La visite d’information et de prévention (VIP) obligatoire
L’employeur doit organiser une visite d’information et de prévention (VIP), qui a remplacé la visite médicale d’embauche. La Vip est réalisée par un professionnel de santé du travail (par exemple, un collaborateur médecin du travail, un interne en médecine du travail, un infirmier) si le salarié ne présente pas de risques particuliers. À la fin de la Vip, le professionnel de santé peut, s’il l’estime nécessaire, orienter le travailleur vers le médecin du travail. Si le salarié est reconnu travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité ou travailleur de nuit, la Vip est réalisée par le médecin du travail dans un service de santé au travail.
La Vip est réalisée dans un délai maximum de 3 mois à partir de la prise effective du poste de travail.
Pour un travailleur de nuit ou un salarié de moins de 18 ans, la visite est réalisée avant son affectation. Le médecin du travail peut demander des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.
À la fin de chaque Vip, le médecin du travail ou le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travail au salarié et à l’employeur. Le médecin du travail n’a pas le droit de transmettre à l’employeur des informations médicales concernant le salarié.
A noter : sous certaines conditions, un salarié nouvellement recruté peut être dispensé de la Vip.
Sanctions en l’absence de VIP
L’employeur qui ne respecte pas ses obligations médicales encourt :
- une amende de 1 500 €,
- une peine de prison de 4 mois et une amende de 3 750 € en cas de récidive.
Les aides à l’embauche
Si vous embauchez votre premier salarié vous pouvez peut-être bénéficier de l’aide à l’embauche pour les TPE et PME.
Cette aide financière vous permet de toucher jusqu’à 4.000 € sur deux ans, dans la limite de 500 € par trimestre.
Pour en bénéficier, il faut :
- être une très petite ou moyenne entreprise ;
- embaucher son premier salarié ;
- proposer un CDI ou CDD de plus de 6 mois.
La demande se fait dans les six mois suivant la signature du contrat par un formulaire en ligne. Vous devrez transmettre, tous les trois mois, une attestation de présence du salarié à l’Agence de services de paiement qui calculera le montant de votre aide. Les micro-entrepreneurs peuvent également bénéficier de l’aide à l’embauche d’un premier salarié.