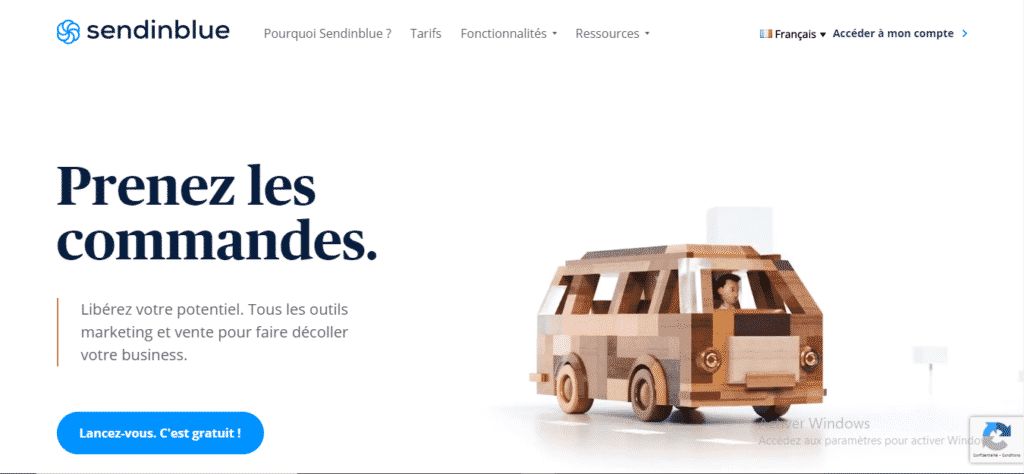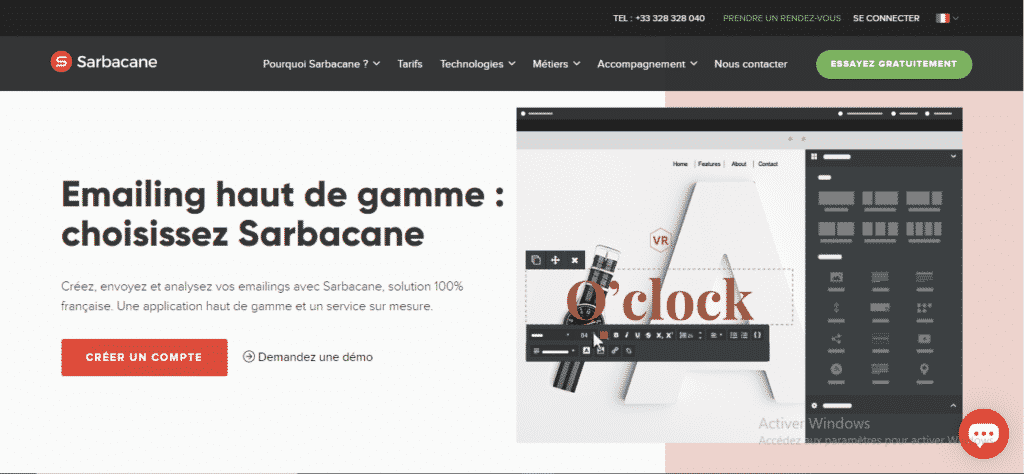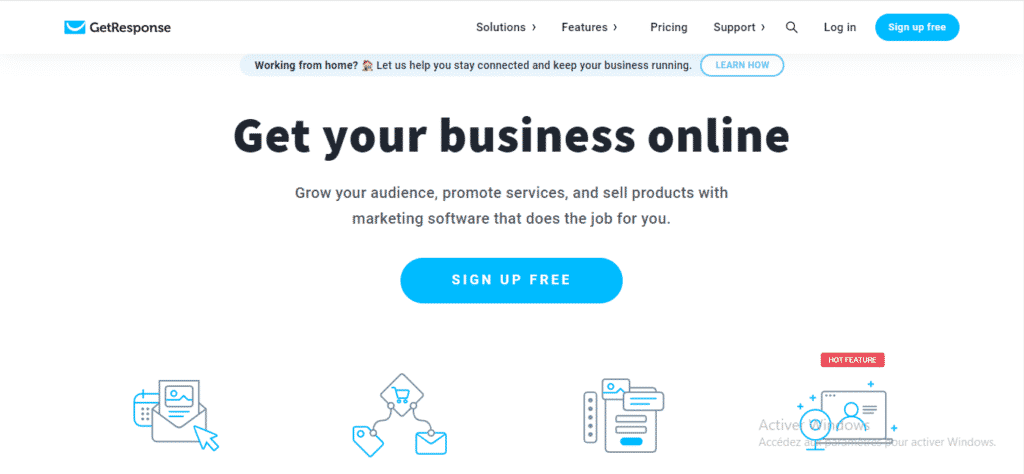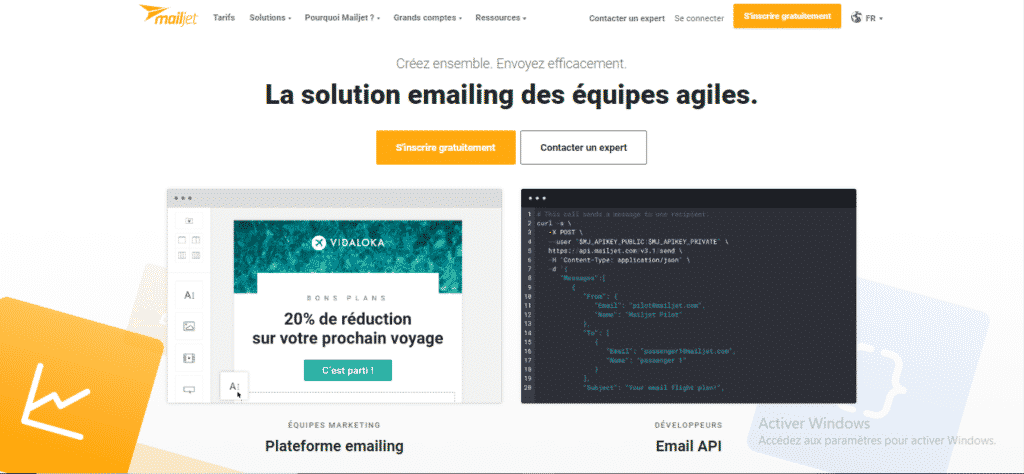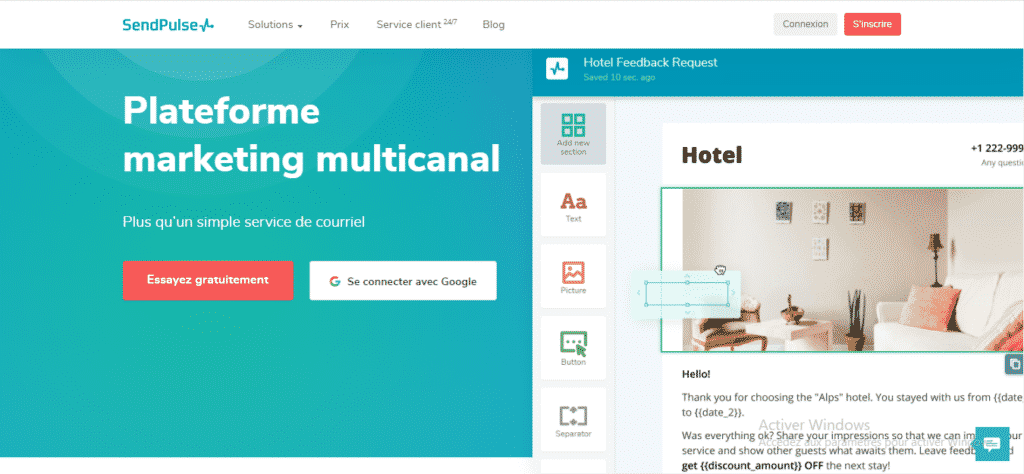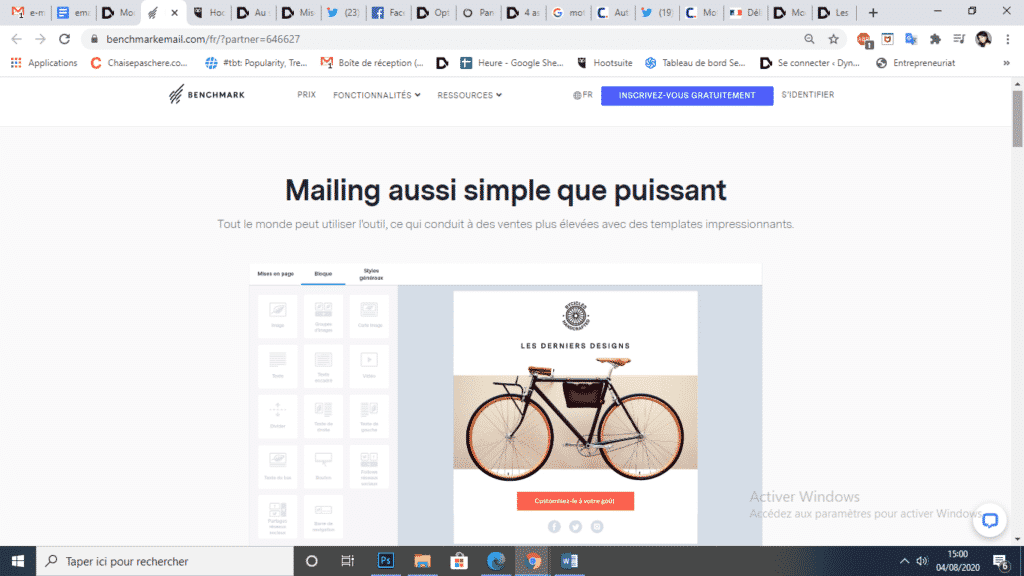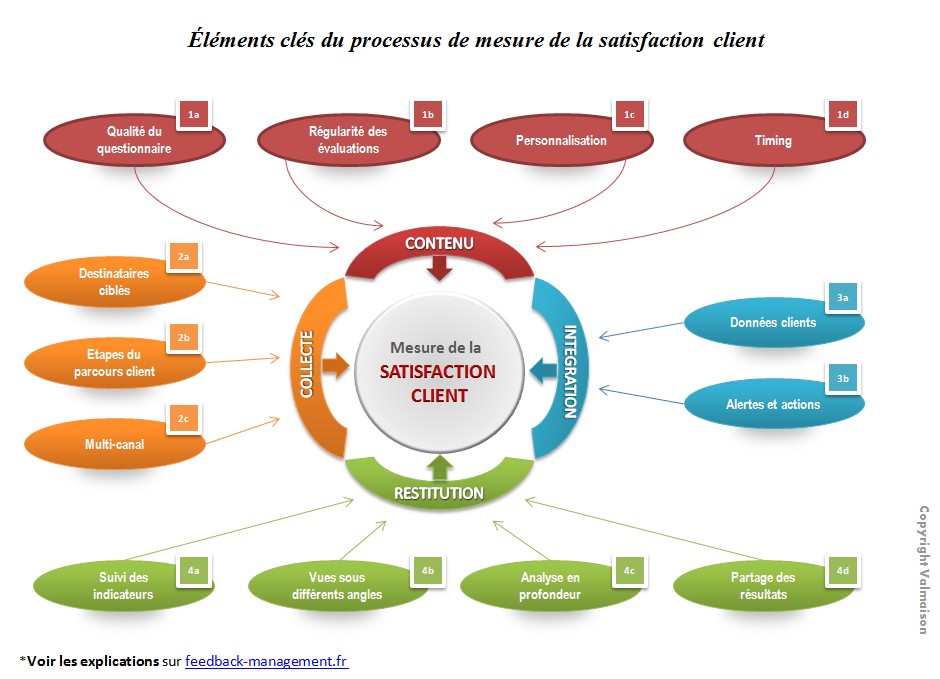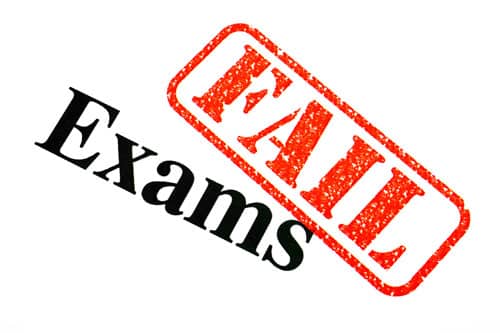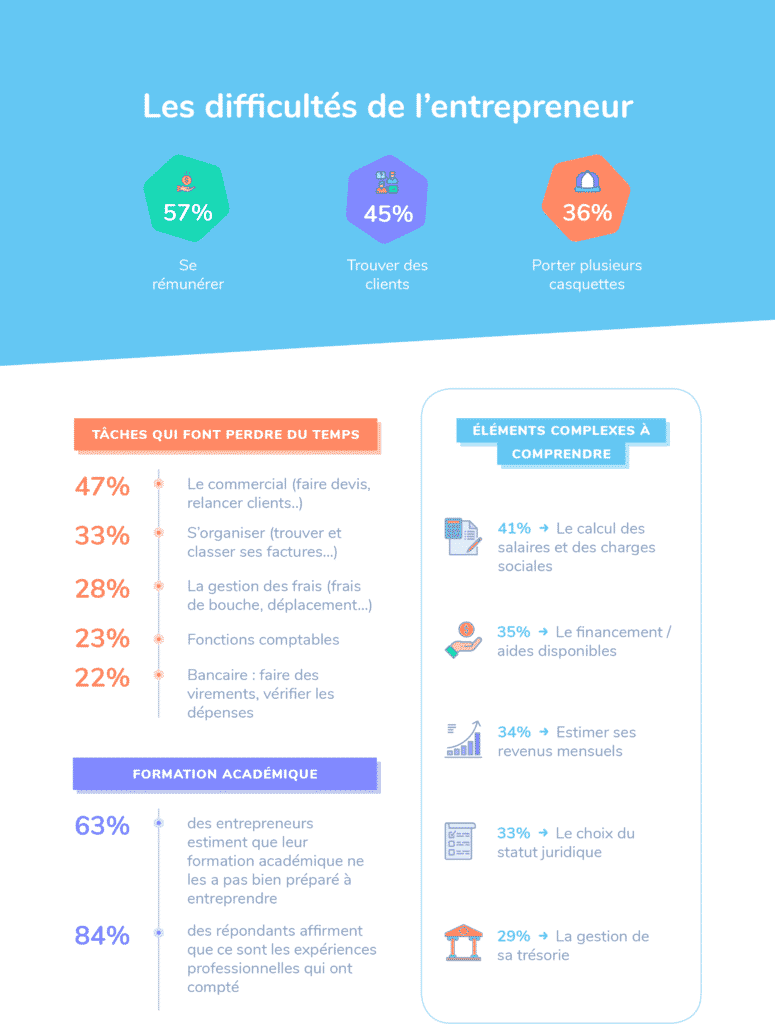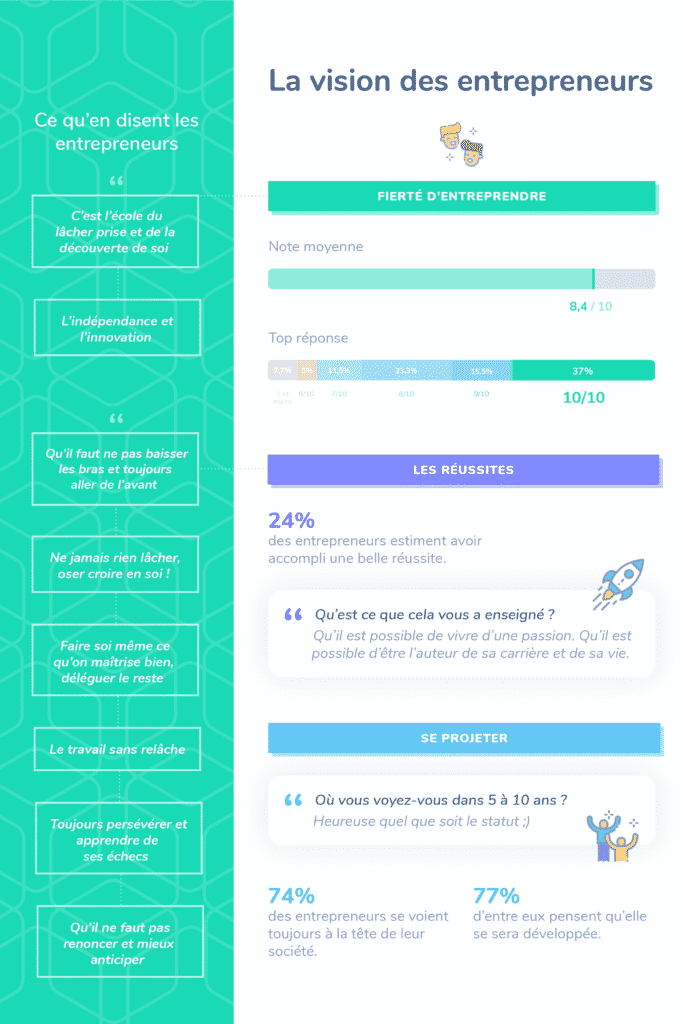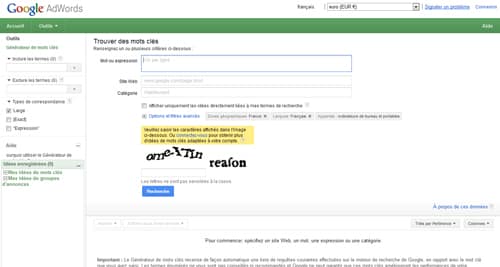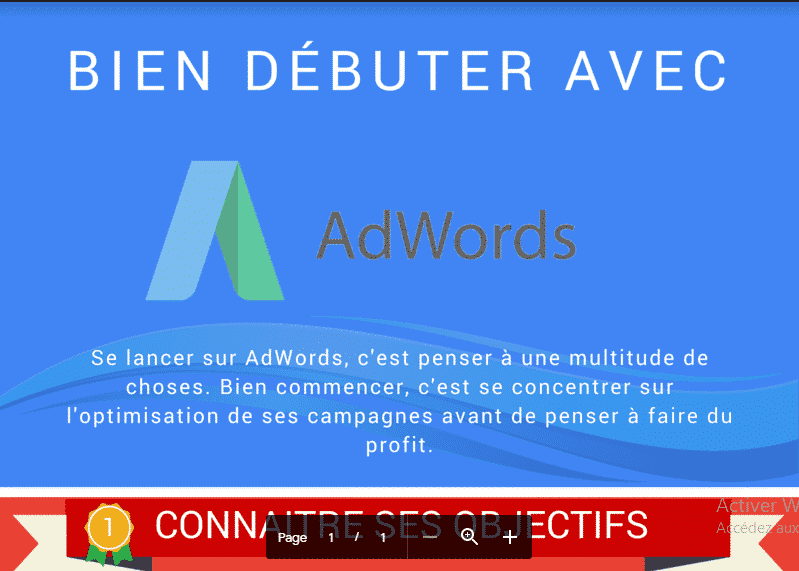Et oui, ces entrepreneurs sont plus d’un à avoir porté leur entreprise dans au Top sommet sans le bac ou sans suivre d’études supérieures. De quoi désacraliser cette fameuse ligne du CV, si chère à notre pays. Et ainsi démontrer que la chance est aux audacieux.
Alors que nous sommes en pleine restructuration du bac, et que vous, parents, haranguez votre progéniture à quitter leurs réseaux favoris pour s’organiser, revenons sur les grandes réussites qui ont boycotté la célèbre épreuve ou autres diplômes. Surnommés « autodidactes », un adjectif aussi obscur que connoté négativement, ou « Serial entrepreneurs », ces dirigeants ont deux points en commun ! l’ambition et le goût de challenge. Focus sur ces « exemples qui font rêver » à suivre ou à ne pas suivre…
Gérard Mulliez –fondateur du groupe Auchan
Fortune : 40,5 milliards d’euros en 2017, 1ère fortune française
Portrait : Gérard Mulliez rate son bac puis, pressé par son père, rentre à l’usine Phildar à 18 ans. Ainsi, en travaillant sur des machines, il perd une partie de sa main droite. L’autre lui permet, à 30 ans, d’ouvrir le 1er magasin Auchan en juillet 1961. Il développe progressivement le Groupe Auchan, qui emploie aujourd’hui 269 000 employés dans le monde.
Martin Bouygues – fondateur de Bouygues Telecom
Fortune : 2,61 milliards d’euros en 2017, 27ème fortune française.
Portrait : Contrairement à ce que peuvent dire certaines mauvaises langues, il est très loin d’être un « fils à papa ». Il s’arrête net après le baccalauréat. Il entre à 22 ans dans le Groupe Bouygues en tant que conducteur de travaux. En fait, 15 ans plus tard il est nommé PDG, et devient l’un des plus jeunes patrons du CAC40. Le groupe qu’il dirige aujourd’hui est 4 fois plus important que celui de son père. Cet homme discret
François Pinault –fondateur de Kering (Pinault-Printemps-La Redoute)
Fortune : 12,35 milliards en 2017, 8ème fortune française
Portrait : François Pinault quitte l’école deux ans avant le bac. A 26 ans, il rachète la scierie de son beau-père, et crée en 1963 le groupe de distribution Pinault. Dans les années 90, il rachète Conforama, Le Printemps, la Redoute et la Fnac. Puis, il se lance dans le luxe en remportant notamment Gucci. Le groupe est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de l’habillement, et l’homme, parmi les 100 plus riches mondiaux.
Jean-Claude Bourrelier –fondateur de Bricorama
Fortune : 215 millions d’euros en 2017, 358ème fortune française
Portrait : Jean-Claude Bourrelier commence à travailler peu avant ses 14 ans. Il devient apprenti boulanger, puis apprenti charcutier avant de s’installer à Paris où il enchaîne les petits boulots. Il décide de se mettre à son compte car son patron ne le laisse pas progresser dans l’entreprise. A 29 ans, il fonde son 1er magasin de bricolage. L’affaire devient Bricorama, qui compte actuellement 222 magasins dans toute l’Europe. Consacré par les Victoires des Autodidactes.
Serge Papin –PDG du groupe Système U (magasins U, Super U, etc.)
Portrait : Serge Papin passe une partie de son adolescence comme pensionnaire chez des prêtres, puis s’essaye à la comptabilité. Un simple BEP Commerce en poche, il intègre la centrale Unico de l’Ouest (ancêtre du Super U). Il crée ensuite le service communication de Système U Ouest. Puis, Il rachète le magasin Super U de Chantonnay, et pas à pas, se hisse jusqu’à la direction générale du groupe, qui enregistre 17,8 milliards de chiffre d’affaires.
Patrick et Gérard Pariente –cofondateurs de Naf Naf
Portrait : Patrick et Gérard Pariente, pieds-noirs, ouvraient en 1973 l’ouverture de la 1ère boutique « Influence » à Paris. 9 ans plus tard, ils fêtaient l’ouverture de la centième boutique Naf-Naf, avenue des Ternes. Comme Jean-Claude Bourrelier, les deux frères ont été récompensés par les Victoires des Autodidactes, d’après eux le « seul diplôme que nous ayons été capables de lui rapporter [à notre mère] ».
Yves Rocher -fondateur du groupe Yves Rocher
Portrait : Yves Rocher commence à travailler dès 14 ans, à la mort de son père, pour aider sa mère. Au même âge, il fabrique artisanalement dans son grenier une pommade qu’il cherche à vendre directement aux utilisateurs. En 1959, il fonde la célèbre entreprise de produits cosmétiques, qui a aujourd’hui un capital de près de 2 milliards d’euros, et qui emploie 15 000 personnes.
Les lauréats audacieux des Victoires des Autodidactes(2008-2019)
2019 : Olivier Méril, lauréat régional Ouest
Président de la société MV Group basée à Saint-Grégoire près de Rennes, Olivier Méril a débuté sa carrière en tant que stagiaire chez Précom (filiale du groupe Ouest-France). Ainsi, en 2010, il rachète une agence web spécialisée en veille et webmarketing, Médiaveille, aujourd’hui intégrée à MV Group. Avec 200 salariés et un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros en 2018, MV Group est organisé autour de plusieurs filiales spécialisées dans le marketing digital. Au-delà des objectifs de performances, Olivier Méril est animé par des valeurs humaines fortes. Au travers de ses équipes, il a pour ambition de construire l’entreprise de demain et de lutter activement contre l’exclusion et la fracture numérique, notamment grâce à l’Ecole Digitale de la Nouvelle Chance (parcours de formation destiné à un public éloigné de l’emploi) et Stage301.
2019 : Alexis Devilliers, lauréat régional Nord
Alexis Devillers, PDG du groupe Alive, débute sa carrière dans l’événementiel en tant que DJ amateur pour arrondir ses fins de mois. En 1995, il créé ADF, puis saisit en 1998 l’opportunité offerte par la coupe du monde de football pour répondre aux besoins des mairies en vidéoprojecteurs : il décide alors de se spécialiser dans la prestation technique pour les événements. 20 ans et plusieurs rachats d’entreprises plus tard dans le Nord et en Région Parisienne, Alexis Devillers dirige un groupe de 300 collaborateurs, réalisant un CA de 51 millions d’euros et plus de 10000 prestations annuelles partout en France. Grâce à son offre complète en audiovisuel, sonorisation, distribution électrique, intégration d’équipements, mais également en fabrication de décor, location mobilier, décoration végétale et impression grand format, Alive groupe est désormais l’un des acteurs majeurs du marché de l’événementiel hexagonal
2019 : Gary Anssens, lauréat régional Île de France
Gary Anssens fonde en 2008 la plateforme alltricks.com, le « petit Amazon des sportifs » (Les Echos). Ce jeune autodidacte de 35 ans est à la fois humble, passionné et ambitieux. Tombé par hasard dans le bain de l’entrepreneuriat à l’âge de 20 ans à la suite d’un accident, il puise alors dans ses valeurs personnelles développées notamment par la pratique semi-pro du VTT. Avec son équipe, ils ont su relever les défis tant humains ― recruter les bonnes équipes managériales notamment ― que les défis technologiques, pour avoir des outils rapides et efficaces, un site web performant et une logistique rodée à toute épreuve. C’est une véritable success story : à ce jour, alltricks.com compte 140 personnes et en 10 ans, son volume d’affaires passe de 100k€ à 65M€. Les perspectives sont réelles entre ouvertures de magasins et de franchises, développement de marques propres (Lebram en 2019) et recherche de partenaires externes.
2019 : Alain Coulas, lauréat régional Auvergne Rhône Alpes
Né en 1955, Il est le président-fondateur de ATS Studios, le numéro 1 français du marché de l’identité téléphonique sonore. L’entreprise se porte très bien : une équipe de 93 salariés et un chiffre d’affaires pour l’année 2017 à hauteur de 7,5 millions d’euros.
2019 : Ludovic Larbodie, lauréat régional Sud-Ouest
Né en 1971 il est membre fondateur du festival Garorock qui compte parmi les grands festivals de musique français. Il est aussi la tête de Garosnow, festival itinérant de musique dans les Pyrénées et Garocamp rencontre dédiée à la transformation numériques des évènements.
2018 : Daniel Strazzeri, Président de Tecofi, entreprise implantée à Corbas et présente dans 80 pays à travers le monde. Dans les années 80, sa première mission professionnelle l’amène au Maghreb ; c’est là qu’il apprendra son métier et forgera ses premières expériences. En 1985, Daniel Strazzeri décide, avec deux associés, de créer sa propre société de robinetterie commerciale : Tecofi, et se tourne naturellement
vers les marchés internationaux : Chine, Russie, Europe, Cuba, etc. Ce positionnement stratégique permet à Tecofi de se développer et d’assurer une proximité avec ses clients ; l’entreprise compte aujourd’hui plus de 200
collaborateurs. « Chez Tecofi, nous avons toujours été multiculturels ».
2018 : Jean-Pierre Ponsard, Directeur général de Roche Emballages
Plastiques, entreprise de transformation de polyéthylène (par extrusion) basée dans le plateau sigolénois, en Haute-Loire. Avec un marché très diversifié (textile, bois, conserveries, blanchisseries, laboratoires, bâtiment,
etc.), REP a fait le choix de l’investissement dans son parc machines pour accompagner ses clients. « Notre parc machines est régulièrement renouvelé pour que les lignes satisfassent au mieux la demande de nos clients, mais également améliorent les conditions de travail de nos collaborateurs », confirme Jean-Pierre Ponsard. Grâce à
une santé financière saine et un marché porteur, REP souhaite maintenant se développer sur la filière bio.
2017 : Joseph Arakel , crée Tempo One, groupe de transport et logistique avec trois métiers principaux : commissionnaire en transport, transporteur et logisticien qui réalise 130 M€ de CA et emploie 500 personnes.
2016 : Philippe Ginestet, PDG et fondateur du Groupe GIFI, Autodidacte, Philippe Ginestet, a débuté en tant que maquignon, métier qu’exerçaient ses parents.
« La réussite de Gifi, et à travers elle ma propre réussite, prouvent que même sans diplôme, mais avec l’envie, le courage, la détermination et les idées de génie, on peut encore réussir. Il faut foncer, ne pas avoir peur des obstacles et croire en soi et en ses rêves. Les réaliser est à la portée de tous, j’en suis la preuve. » L’entreprise s’est fixé un objectif « élevé » à l’horizon 2025, «10 000 collaborateurs et 1 000 magasins, en continuant à préserver l’esprit de famille qui nous caractérise depuis toujours. »
2015 Marcel Guigal a débuté en 1961. C’est à cette date que Marcel Guigal a pris en main le domaine familial fondé en 1946 à Ampuis. Il est alors seulement âgé de dix-sept ans. La famille Guigal est aujourd’hui à la tête d’une exploitation viticole de 74 hectares, qui a produit, en 2014, près de 7 millions de bouteilles et emploie 29 personnes. Son chiffre d’affaires dépasse les 50 millions d’euros, réalisé pour moitié à l’export (Etats-Unis, Japon, Canada).
2014 : Pierre Riou, Groupe Riou Glass
2013 : Gérard Dorey, Président de Carrefour Proximité
2012 : Michel Garcia, Président d’Everial
2011 : Lucien Georgelin, Président de « Lucien Georgelin SAS »
2010 : Max Massa, Président du Groupe ONET
2009 : Pierre Groll, Président de FAM Automobiles
2008 : Pierre Alloin, Président du groupe Firalp
Malgré ces beaux parcours, deux questions sont encore à poser :
Aujourd’hui, peut-on encore réussir sans le bac ? Mais surtout, est-ce que la création d’entreprise est LA solution pour ceux qui se détournent des études ?