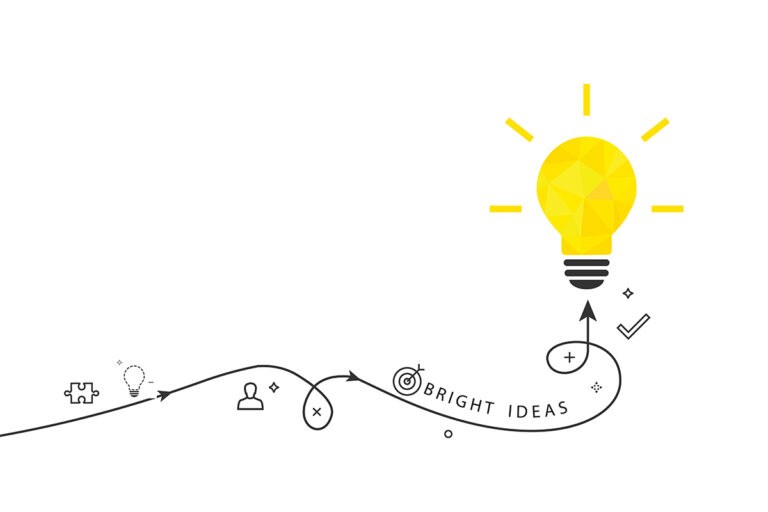La reprise d’une entreprise est loin d’être une étape aisée. Lors de la reprise d’une entreprise, le dirigeant doit acquérir d’autres qualités qui n’étaient peut-être pas le cœur de ses tâches pour pouvoir déceler les forces et faiblesses de l’entreprise. La reprise d’une entreprise constitue une étape fondamentale pour un dirigeant. Pour garantir son succès, le repreneur doit maîtriser l’art de la négociation. Il doit savoir toucher la corde sensible pour que l’acquéreur puisse revenir sur sa décision. La moindre erreur peut coûter cher quant à la négociation et à l’avenir de l’entreprise. Le respect de ces quelques étapes s’impose.
Préparer la négociation
La négociation constitue une étape pour le moins délicate dans la vie d’une entreprise, notamment en matière de reprise. Certains dirigeants n’hésitent pas à faire appel à un professionnel en la matière pour apprendre et maîtriser la technique de négociation. L’entrepreneur peut profiter des expériences d’autres professionnels du même secteur en procédant à des échanges. L’intégration d’une association ou d’un groupement de professionnels s’avère bénéfique pour l’entrepreneur. Lors de cette phase de préparation, le reprenant doit établir des arguments solides et éviter de procéder à la reprise sur un coup de tête. Il doit impérativement déterminer la principale raison pour laquelle il décide de reprendre l’entreprise.
La phase de négociation
En principe, les relations entre acheteur et vendeur demeurent très complexes. Chacun d’eux souhaite réaliser une transaction avantageuse. Lors de la négociation, les deux parties doivent s’accorder sur le prix. Il est impossible d’entamer l’opération si elles ne s’entendent pas sur une fourchette de prix. La différence de prix proposée par chacune d’entre elles ne doit pas dépasser les 20 %. À défaut, le processus risque d’échouer. Il faut tenir compte des garanties de bilan. Ces garanties concernent autant l’actif que le passif de l’entreprise.
Il existe d’ailleurs des clauses de non-concurrence. Ces dispositifs intéressent principalement l’acquéreur. Ces clauses permettent de limiter différents conflits tels que ceux référant à l’emplacement géographique de l’entreprise. L’établissement d’une négociation précise respectant les formalités légales ou administratives s’impose. Cela garantit l’opposabilité des accords conclus entre les deux parties et facilite la résolution du problème en cas de conflit.
Le protocole d’accord
La négociation doit faire l’objet d’un accord signé. Cette formalité garantit la formalisation des termes et des conditions de cession. Ce protocole doit contenir l’ensemble des éléments concernant la négociation. Aussi, il doit comporter les garanties ainsi que les pièces justificatives y afférentes. Pour que l’effet de la négociation puisse « être opposable à tous », il convient de faire appel à une autorité compétente pour rédiger ou assurer son authenticité. Un juriste, un notaire ou un avocat détient la capacité à assumer cette responsabilité.
Quelques conseils pour assurer le succès de la négociation
Lors de la négociation, l’entrepreneur doit garder l’initiative des débats. Il doit pouvoir imposer ses arguments et faire comprendre leur importance au cédant. En raison de l’importance de la négociation, il faut éviter les échanges téléphoniques ou par mail au profit d’un échange direct. La discrétion et la confidentialité s’imposent. L’entrepreneur ne doit divulguer que le strict minimum nécessaire au cédant. L’assistance d’un conseiller spécialisé s’avère également indispensable pour garantir le succès de la négociation. Il peut fournir des informations utiles et indispensables au processus de négociation.