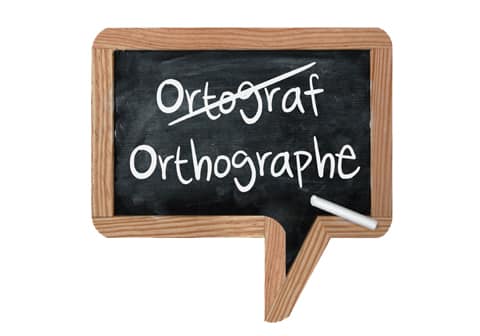Si le perfectionnisme reste la qualité citée en entretien comme réponse à la question « quel défaut avez-vous ? » et peut même faire sourire les recruteurs, il peut représenter un véritable frein pour les entrepreneurs. Zoom sur les bonnes raisons de ne pas être perfectionniste obsessionnel lorsque vous êtes chef d’entreprise.
La perfection est l’ennemie du lancement de votre projet
C’est simple : on peut toujours perfectionner plus son projet au son business plan. Si vous êtes perfectionniste, cela traduit parfois un manque de confiance et une anxiété difficile à maîtriser et de ce fait vous risquez de ne jamais lancer votre entreprise. Plus vous l’êtes, plus vous aurez tendance à emmagasiner des informations et à vouloir améliorer plus votre produit/service. Les lectures, les études, les petits détails sont légions lorsque vous montez votre entreprise alors autant le dire les perfectionnistes qui ne décident pas de dépasser leur obsession de fignoler ne lancent quasiment jamais leur entreprise car il y a toujours quelque chose à revoir. Surtout, si celle-ci est reliée à un manque de confiance, ils risquent fort de ne jamais prendre la décision de sortir de leur zone de confort. A vous donc de bien cerner ce frein.
La perfection est parfois un sujet temporel
En entrepreneuriat, les choses évoluent au gré des évolutions technologiques. Autrement dit, ce que vous offrez que l’on parle de produit ou de service, ne sera en toute probabilité, jamais parfait puisqu’une nouvelle technologie peut venir chambouler vos plans. Il n’y a qu’à voir que des géants comme KODAK qui n’ont pas suivi une évolution technologique (celle de l’essor du numérique alors qu’ils en étaient les inventeurs) et ont disparu pour se dire que le perfectionnisme ne convient pas toujours dans un monde où l’immédiateté est reine. Les théories sur l’amélioration continue ont d’ailleurs fortement émergé ces dernières années.
Il faut dire que les cycles et les habitudes de consommation changent et que nous sommes dans un monde où l’entrepreneuriat est de plus en plus un monde d’adaptation que d’anticipation (même si celle-ci reste nécessaire). Pour prendre un autre exemple pour ceux qui ont connu les jeux vidéo, Donkey Kong Country avait une note de 20/20 à l’époque de toutes les critiques sur la question. Aujourd’hui, il est à mettre au rang des antiquités et une bonne partie des jeux présents sur nos téléphones sont bien plus réalistes et avec une jouabilité bien plus importante. S’il a marqué l’enfance de nombreux gamers, ils montrent bien que la perfection dépend fortement des évolutions technologiques.
Elle peut nuire à l’amélioration
Si vous cherchez à avoir un produit parfait, cela peut nuire au fait que vous preniez en compte les avis consommateurs. Or ceux-ci évoluent avec le temps et sont fonctions des habitudes nouvelles de consommation qui prennent notamment en compte les nouvelles technologies vues plus haut. Autrement dit, si celui-ci peut voir un produit parfait à un instant donné, il peut se révéler très loin de la perfection quelques années plus tard. Autre point, vous êtes susceptible d’être copié (sauf à disposer d’un brevet très spécifique). Vous devrez donc sans cesse innover pour rester à la pointe.
Surtout, même si les clients apprécient votre offre, il faut prendre en compte que comme tout un chacun, ils banalisent ce que vous offrez. Autrement dit, plus ils auront l’habitude d’avoir votre service, plus ils trouveront cela normal et la satisfaction ne sera plus au rendez-vous. Il faudra donc très probablement améliorer votre offre afin de combler vos clients et vous n’aurez donc jamais atteint la perfection.
Elle peut vous stresser
Le perfectionniste ou en tout cas le fait de vouloir se rapprocher de la perfection peut être une qualité indéniable. Cependant, il faut prendre en compte qu’il apporte son lot de stress notamment lors de la sortie de produits/services. Il possède en général cependant un gros revers : si vous vous apercevez d’un défaut après avoir lancé votre produit en production, vous pouvez très mal le vivre. Il n’est pas rare de commettre des erreurs et un excès d’attachement au moindre détail peut non seulement vous ralentir mais également être source de stress dans le cas où tout ne sera passerait pas comme prévu. Or, celles-ci sont courantes en entrepreneuriat et il vous faudra donc apprendre à ne pas être trop rigide avec vos équipes et avec vous-même si vous ne souhaitez pas exploser sous le stress.