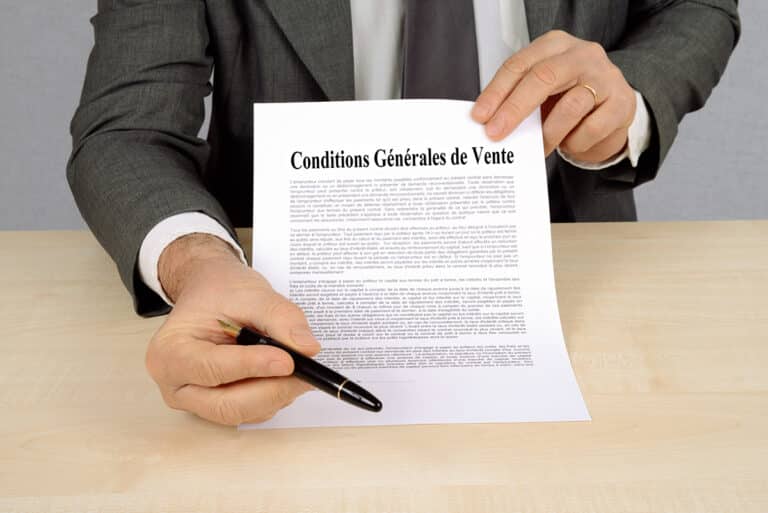L’art de la vente tient entre autres dans la capacité à s’adapter à son interlocuteur. Pour y parvenir, il convient d’apprendre à identifier son profil. Ce mois-ci, focus sur le profil du consensuel.
Profil : Le consensuel comme François Hollande
On peut classifier les interlocuteurs lors d’une vente selon quatre profils types : le processeur, le commandeur, le conquérant et le consensuel. Bien observer et identifier son interlocuteur durant les premières minutes vous aidera à vous adapter au mieux au profil de votre prospect. Après avoir étudié le mois dernier le profil du commandeur, comme Nicolas Sarkozy, un nouveau type de personnalité est de nouveau décrypté dans ce numéro.
De nature décontractée et tranquille, le consensuel est animé par ses relations aux autres. Il est sensible aux ambiances rassurantes et souhaite instaurer une certaine complicité avec son interlocuteur. Le consensuel est orienté sur l’humain. C’est un spécialiste de l’écoute combinant la réserve et l’empathie dans ses relations avec autrui. Le consensuel est l’opposé du commandeur. Vous l’atteindrez grâce à une approche personnalisée, amicale et chaleureuse.
Comment le reconnaître ?
En retrait, à l’écoute, doux, tranquille, informel et empathique. Le consensuel est quelqu’un d’ouvert, disponible et plutôt discret. Vous noterez que son intonation est douce, qu’il parle doucement, lentement et peu. Le consensuel se positionne en retrait et apparait comme quelqu’un de calme, posé et à l’écoute de son interlocuteur.
Comment fonctionne-t-il ?
Ce qui frappe toutes les personnes travaillant ou ayant des relations professionnelles avec le consensuel est sa recherche permanente du consensus. Il privilégie le compromis et le dialogue à l’affrontement frontal.
Comment vous adapter au mieux à ce profil ?
S’adapter en laissant le temps au temps. Avec un consensuel, oubliez le fameux proverbe selon lequel « le temps, c’est de l’argent ». Avec ce profil, prenez votre temps, ne le pressez pas, mais suggérez lui plutôt doucement d’agir.
S’adapter en montrant votre intérêt
Intéressez-vous à ses sentiments et à tout ce qui l’anime en ayant une approche personnalisée. Soyez attentif aux relations importantes pour lui. Parlez de tout et de rien au début, en étant proche de lui et de ses valeurs. Interrogez-le sur sa vie et son environnement dès l’introduction du rendez-vous.
S’adapter dans l’entretien
Deux maîtres mots : douceur et convivialité. Créez un bon climat de confiance, mêlant partage et complicité. Posez-lui des questions et faites-le parler de lui, de ses proches, de sa vie… Engendrez un contexte d’échange interpersonnel.
Vous : « Bonjour Mr Dupont, comment allez-vous ?… Comment s’est passé la rentrée scolaire de votre fils. Il entre au collège cette année ? C’est une nouvelle étape, un changement pour votre fils ? ».
M. Dupont : « Oui, en effet, il était assez anxieux. Mais au final il est revenu satisfait de sa première journée… ».
Vous : « Et votre nouvelle stagiaire, Eloise… »
Il est important de vous rappeler des noms, titres ou projets liés à son environnement personnel et professionnel. Et surtout, n’hésitez pas à lui parler de vous également :
M. Dupont : « Et vous, comment va votre femme, Michelle ? »
Vous : « Très bien, je vous remercie, elle a pris ses nouvelles fonctions au sein de son entreprise, tout se passe bien et nous essayons maintenant de concilier notre vie en fonction. Avec notre petit garçon, Jules, qui entre à la maternelle cette année, nous devons planifier la semaine… »
S’adapter à son mode de décision
Sachez créer une « atmosphère » ! Ayez un ton conversationnel détendu, chaleureux, bienveillant, attentif. Ne le pressez pas de questions « invasives » trop directes telles que : « venons-en à notre projet », le consensuel n’osera pas vous dire que vous vous y prenez mal et vous irez dans l’impasse. Ayez une approche la plus douce possible :
Vous : « Nous avions abordé, lors de notre dernier échange, votre projet. Comment se passe l’avancement ?… Où en êtes-vous ?… Avez-vous consulté ?… »
Le consensuel apprécie les conseils et l’accompagnement. Il fera appel, en général, à son entourage.
M. Dupont : « Oui, nous avons bien avancé, j’ai déjeuné avec mon collègue qui m’a conseillé… Qu’en pensez-vous ? »
Le consensuel s’appuie sur les opinions des autres et souhaite minimiser les risques. Impliquez-vous personnellement !
Vous : « Effectivement, vous avez été bien conseillé, nous avons l’habitude de travailler sur ce genre de projet. D’ailleurs, Mr Panot de la Société Panot nous a consultés dernièrement sur un projet ressemblant et nous l’avons accompagné sur telle action et sur telle démarche… Voilà ce que nous lui avons proposé… »
Fournissez des garanties en référence, des exemples de réussite. Montrez que toute une équipe travaille ensemble derrière son produit ou son projet. Engagez votre parole ! Votre crédibilité en tant que personne est votre meilleur soutien de vente. Estompez au maximum les risques ! Rassurez-le !
S’adapter à son mode d’engagement
Le consensuel est un indécis de nature. Entre choisir un pantalon bleu ou blanc, il prendra soit les deux, soit rien ! Aidez-le en lui faisant prendre des microdécisions. Engagez-vous en donnant votre avis ou en faisant des recommandations : « Par rapport à tout ce que vous venez de me décrire, voilà ce que je vous propose… Si j’étais à votre place, voilà ce que je ferais… ». Aidez-le à prendre les décisions, voire prendre la décision à sa place. Pour l’aider dans sa prise de décision finale, fonctionnez étape par étape, microdécision par microdécision, jusqu’à l’engagement total.
Guidez-le sans le brusquer ! Le consensuel appréciera fortement cette démarche. En dernier lieu, il ne vous restera plus qu’à lister les microdécisions que vous venez de valider ensemble, et à conclure votre vente dans une attitude décontractée et amicale.
Vous : « Comme nous venons de le voir ensemble, nous pourrions vous proposer telle action, qu’en pensez-vous ?
M. Dupont : « Oui, c’est une bonne idée »
Vous : « Pour ce produit, nous vous conseillons cette approche, est ce que cela vous convient ? »
M. Dupont : « Je ne sais pas, quoique…, non, je ne sais pas… »
Vous : « Je comprends, je vous propose en option d’avancer sur ce niveau… »
M. Dupont : « Oui, je préfère, c’est mieux. »
évitant…
… l’autoritarisme, la pression pour obtenir le changement, la bureaucratie, les attitudes distantes et les gens non disponibles, les demandes de résultats sous la pression, les deadlines ainsi que le manque de compassion.
Le mot du coach par Eva Marechal, psychologue clinicienne
Faites en sorte de développer la confiance avec votre interlocuteur et de créer un climat convivial.
Dans le cas de ce profil de personnalité, il est très important de prendre le temps de mettre à jour les critères de votre interlocuteur, à savoir ce qui est important pour lui. Centré sur les personnes, il sera d’autant plus facile à convaincre que vous nouerez avec lui une relation personnelle. Il s’agit de faire naître la confiance et l’intérêt. C’est d’autant plus agréable de mettre en avant vos talents de communiquant : l’écoute (que vous centrerez sur la découverte des critères propres à votre interlocuteur), la reformulation et la mise en place d’un cadre d’accord. Vous pourrez même utiliser vos fragilités ou vos défauts pour renforcer vos liens.
Il s’agira de bien gérer les émotions de sorte que l’entretien se passe de façon agréable et conviviale : l’important dans ce cas est le contexte avant même le contenu. Gardez le contact visuel avec votre interlocuteur et maîtrisez votre rythme respiratoire. Ici, l’important est de montrer que vous êtes fiable. Enfin, n’oubliez pas de prendre le temps car il en faut pour que naisse une relation vraie.
Savoir bien négocier : les 10 commandements
1 La négociation tu prépareras
Comme dans une compétition sportive, une bonne préparation augmente les chances de victoire. Préparez votre négociation en rassemblant des informations sur votre interlocuteur et son entreprise.
2 Tes objectifs tu clarifieras
Difficile d’avancer si on ne sait pas où l’on va ! Attention à définir des objectifs atteignables.
3 Aucune faiblesse tu ne montreras
N’évoquez pas vos contraintes ou les difficultés que rencontre votre entreprise car votre interlocuteur les utiliserait contre vous.
4 Le silence tu utiliseras
Car parfois un silence peut être plus efficace sur l’interlocuteur qu’une parole.
5 Tranquille tu resteras
Ne montrez pas trop votre enthousiasme ou votre énervement. Restez toujours neutre dans la discussion.
6 Les points sur lesquels tu peux faire des compromis tu définiras
Toute négociation oblige chaque partie à lâcher du lest sur certains points.
7 à tout tu t’attendras
Soyez prêt à réagir à n’importe quel scénario. N’attendez rien afin d’aborder la négociation avec une totale ouverture d’esprit.
8 Le comportement de l’autre bien tu observeras
En observant bien l’interlocuteur, ses mimiques et ses mouvements, vous comprendrez facilement ce qu’il est en train de penser.
9 De diplomatie toujours tu useras
Garder une attitude calme et positive, vous évitera les situations de blocage de la négociation.
10 Bien conseillé tu seras
Si une négociation se fait en général en tête à tête, il vaut mieux s’appuyer sur un avis extérieur pour bâtir ses propositions.