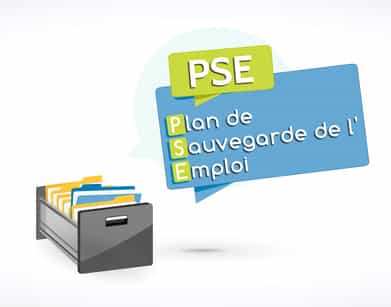Interview du fondateur des sites Vivastreet, Appartager et Oudormir. Ce pionnier du business web nous raconte son parcours tortueux et fait de rebondissements, jusqu’au succès international.
Vous développez Vivastreet depuis les états-Unis, comment a commencé le « rêve américain » pour vous ?
En sortant de mon école de commerce, un ami m’a proposé de le suivre en stage 6 mois en Californie. Pour moi c’était le rêve ! Je me suis retrouvé à vivre dans une énorme maison de millionnaire surplombant Los Angeles et qu’on me prêtait. Je me suis dit que je voulais vivre toute ma vie comme ça ! Alors j’ai commencé à chercher quels produits français fonctionneraient bien aux états-Unis et je suis tombé sur l’idée des croissants. J’ai contacté toutes les entreprises françaises de viennoiserie pour leur proposer de développer un business aux états-Unis. Finalement le PDG de La Croissanterie m’a convoqué pour me donner ma chance. Sauf qu’il me proposait de faire livreur en étant payé au SMIC ! Mais j’ai dit banco !
Comment votre situation a-t-elle alors évoluée ?
J’ai passé 6 mois à livrer des crackers dans des supermarchés du fin fond de la banlieue new-yorkaise ou à travailler dans des usines décrépies. Comme le directeur qui dirigeait la boite me détestait, il me faisait faire les pires jobs ! Au bout de 6 mois, j’étais sur le point de tout lâcher, quand le PDG m’a appelé. Il m’a annoncé qu’il me nommait directeur à la place de l’américain car le business ne décollait pas.
Là, l’entreprise a fini par décoller. Comment avez-vous fait ?
J’ai eu l’idée de ne pas placer nos crackers dans le rayon dédié et où il n’y avait pas de place pour nous. J’ai accepté de céder une marge plus importante pour pouvoir vendre nos crackers sur les stands traiteur qui faisaient leur apparition dans les supermarchés. être là où personne ne nous attendait a été l’idée qui nous a permis de faire décoller les ventes. à partir de là, la boite a explosé et nous avons pu ouvrir 12 croissanterie dans le pays.
Mais vous n’êtes pas resté très longtemps dans l’entreprise ?
Je considérais que, pour avoir eu toutes ces idées géniales, du haut de mes 25 ans je devais être le plus intelligent du monde ! Le problème c’est que le PDG français se disait de son côté que toutes ces idées magnifiques n’étaient dues qu’à son talent ! Finalement je suis parti de l’entreprise.
C’est là que vous avez monté votre première entreprise ?
Oui, j’ai essayé de partir sur le même concept qui avait fait mon succès : vendre un produit là où on ne l’attend pas. J’ai commercialisé des cosmétiques pour femmes portant des lentilles chez les opticiens. Et là, je me suis planté : première grande leçon d’humilité !
Que vous a appris cet échec ?
Outre le fait d’apprendre que je n’étais pas plus intelligent que ça, j’ai compris que, dans une création d’entreprise, la chance joue un grand rôle. Si l’on pense qu’on est le plus intelligent et que donc tout va marcher, c’est le début de l’échec !
Vous avez vite rebondi après cet échec ?
J’avais 40 ans et plus un sou ! Mais j’ai vite retenté ma chance. C’était en 1998 et il y avait un buzz énorme autour du phénomène Internet. J’ai donc lancé mon premier site, Easyroommate, et sa version française Appartager. Toutes les startups web réussissaient à lever de l’argent, sauf moi ! Je pense que je ne passais pas bien vis-à-vis des américains car je n’avais pas assez d’ambition. Ça a donc été plus long et difficile pour nous de réussir que pour les autres car nous n’avions pas d’argent.
Vous avez lancé le site sur le marché américain ?
Nous nous nous sommes vite aperçus que nous n’arrivions pas à percer sur le difficile et gigantesque marché américain. Alors nous avons décidé de lancer Appartager dans les pays d’Europe, puis en Amérique Latine. Ensuite, lorsque nous avons vu le succès du site Craig’s List aux états-Unis, nous avons développé un site similaire, Vivastreet, toujours sur plusieurs pays en même temps. Enfin nous avons développé le site Oudormir qui fonctionne très bien aussi. Aujourd’hui nous sommes numéro 5 du marché des petites annonces au niveau mondial et numéro 2 dans beaucoup de pays.
Comment managez-vous vos équipes ?
Je fais confiance à mes équipes qui gèrent de manière autonome le business dans le pays dont ils sont responsables. Comme j’ai appris que je n’ai pas la science infuse, la prise de décision est assez collégiale dans le groupe. Les salariés ont énormément de liberté, je ne suis pas sur leur dos. C’est peut-être un état d’esprit qui vient de la culture anglo-saxonne, mais en tout cas c’est un élément fort de l’ADN de l’entreprise. Je regarde seulement les résultats obtenus et n’interviens pas plus que ça. Moi je suis là pour régler les problèmes, c’est tout !
Vous encouragez la création d’entreprise par vos salariés je crois, expliquez.
Oui, à titre personnel, j’aide financièrement mes salariés qui veulent se lancer. Je trouve ça complètement normal qu’un jour mes collaborateurs aient envie de monter leur propre boite. Alors j’investis dans leur projet et je ne leur fais pas subir les mêmes conditions que les fonds d’investissement ! Cet engagement permet de complètement casser la friction qu’il peut y avoir entre le patron et les salariés. S’ils souhaitent devenir patron eux aussi, je les soutiens dans ce projet. L’entreprise devient une sorte d’incubateur à projets. Ce qui est sûr c’est que tous les projets d’investissement, à côté du développement de ma propre entreprise, me permettent de garder un intérêt intellectuel.
Les 5 conseils
- Innovez ! Ne cherchez pas à copier ce que font les autres.
- Ne vous découragez pas. Même quand tout est perdu, on peut toujours trouver une solution. Il ne faut jamais abandonner et essayer de trouver des issues au problème. Cet état d’esprit doit être permanent chez l’entrepreneur.
- Sachez changer d’idée rapidement. Parfois on croit tellement fort dans son projet qu’on ne voit pas que c’est une mauvaise idée ! Il faut donc être ouvert à la remise en question et au changement.
- Comprenez qu’il n’y a pas de projet où c’est vous qui avez toutes les bonnes idées. La meilleure façon d’avancer c’est de travailler sur un mode collaboratif, en équipe. Si chacun tire dans son coin, personne n’y arrive.
- Faites en sorte que tout ce que vous faites ou créez ait un sens pour les gens à qui vous vous adressez. Il faut écouter le marché que vous visez et ne pas suivre simplement son idée ou son produit.