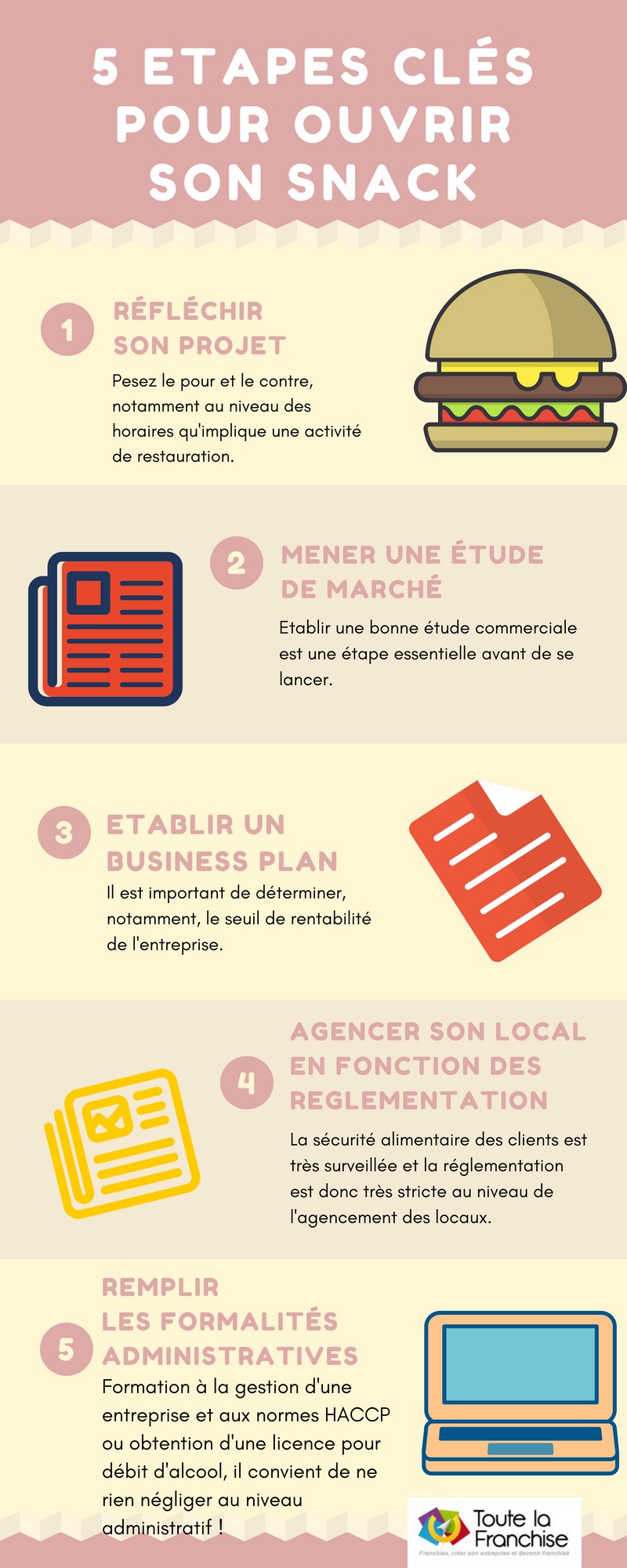Les TPE PME peu rodées aux marchés publics sont souvent perdues lorsqu’elles prennent possession des pièces de la consultation. Où trouver les informations pour se repérer dans les marchés publics ? Petit tour d’horizon des 5 catégories de pièces constituant un dossier de consultation des entreprises (DCE)…
Informations pour se repérer dans les marchés publics :
Le Règlement de Consultation (RC) :
Il s’agit en quelque sorte de la « règle du jeu » pour répondre et se préparer au marché public. En effet, ce document régit la passation du marché, c’est-à-dire toutes les étapes depuis la publication du marché public jusqu’à la désignation du titulaire et la notification du marché.
Ce document n’est d’ailleurs pas contractuel : aucune clause n’ayant vocation à s’appliquer au cours de l’exécution du marché.
Le règlement de consultation présente la particularité d’être facultatif : toutes les mentions contenues dans cette pièce pourraient tout à fait être regroupées au sein d’une publicité. Ainsi, généralement, le règlement de consultation reprend les mentions de la publicité, et les précise.
Le candidat a un marché public y trouvera donc principalement les rubriques suivantes :
- Les coordonnées de l’acheteur public et l’objet du marché
- L’intitulé des lots, le cas échéant : chaque lot constitue une unité autonome et indivisible : cela signifie que le candidat qui décide de répondre à un lot doit y répondre intégralement. Quant au pouvoir adjudicateur, il a l’obligation d’analyser chaque lot séparément.
- Des éléments sur la durée du marché, sur les éventuelles reconductions du contrat, et/ou la date prévisionnelle de commencement d’exécution du marché
- Des informations sur les variantes : pour le candidat, remettre une variante consiste à proposer à son initiative une solution alternative au cahier des charges. En amont, le pouvoir adjudicateur peut accepter ou refuser les variantes. S’il les accepte, il fixe généralement les conditions à respecter et les spécifications techniques minimales exigées.
- La liste des pièces à produire tant au stade de la candidature qu’au stade de l’offre. Le candidat doit veiller à bien distinguer les pièces relevant de la candidature (DC1, DC2,…) des pièces relevant de l’offre (Acte d’engagement, mémoire technique…). En effet, par le biais de la candidature, le pouvoir adjudicateur apprécie la situation juridique du candidat, et ses capacités techniques, professionnelles et financières du candidat. Il n’analysera que les offres des candidats dont il aura estimé que les capacités sont suffisantes pour l’exécution du marché.
- Les critères de sélection des candidatures et des offres, en vue de l’attribution du marché. Les critères de sélection des offres les plus fréquemment exploités sont le prix, la valeur technique et le délai, mais le pouvoir adjudicateur est libre du choix de ces critères d’attribution, dès lors qu’ils correspondent à l’objet du marché
- Le formalisme à respecter pour la présentation et la remise du pli : nombreux sont les candidats évincés d’un marché public pour cause de non respect du formalisme de réponse. Les modalités explicitées dans cette rubrique concernent tant une remise par « voie papier » qu’une remise par « voie dématérialisée ».
- Les renseignements complémentaires : ils indiquent aux candidats comment contacter le personnel administratif et technique en charge de la procédure, afin de leur demander des précisions, ou de les alerter sur des incohérences du cahier des charges par exemple
- La date et l’heure limite de réception des offres : elle est impérative ! Contrairement à l’administration fiscale, qui prend en considération la date d’envoi, en matière de marchés publics, c’est la date et l’heure de réception qui comptent, et ce, quelque soit les circonstances rencontrées par le candidat (grève…).
L’Acte d’Engagement (AE) :
c’est la pièce maîtresse du marché public. Il constitue en quelque sorte le « contrat », car c’est ce document qui est signé des deux parties (titulaire du marché et pouvoir adjudicateur).
Au stade de la remise de l’offre, sa signature par le candidat est donc impérative. Il s’agit donc d’un document obligatoire. Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur ne remet pas de modèle, le candidat peut recourir au formulaire cerfa DC3 (disponible sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances).
Ce document est peu volumineux au regard des autres pièces composant le cahier des charges : il comporte principalement les coordonnées des deux parties, l’objet, le prix et la durée du marché, les coordonnées bancaires et la signature du candidat, un cadre de signature pour le pouvoir adjudicateur, puis renvoie aux autres pièces du DCE.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) :
Son aspect rébarbatif en fait le document le plus souvent négligé par les candidats. Il est pourtant particulièrement important car il régit les aspects administratifs au cours de l’exécution du marché.
Il est généralement rédigé en complément du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).
Le pouvoir adjudicateur peut se reporter à n’importe lequel des cinq CCAG en vigueur, en fonction de l’objet du marché :
- CCAG Fournitures courantes et services (CCAG – FCS)
- CCAG Travaux
- CCAG Prestations intellectuelles (CCAG PI)
- CCAG Technologies de l’information et de la communication (CCAG TIC)
- CCAG Marchés industriels (CCAG MI)
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut déroger au CCAG, à condition de l’avoir expressément mentionné dans le corps du CCAP, ainsi que dans le dernier article, qui constitue un récapitulatif de ces dérogations.
Le candidat y trouvera notamment :
- la clause sur les révisions de prix : selon la durée et la nature du marché, le pouvoir adjudicateur peut prévoir une révision des prix, généralement sur la base des indices INSEE, dans les conditions et suivant une formule paramétrique figurant dans le CCAP
- les conditions de règlement des prestations : le délai de paiement est fixé à 30 jours pour l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs (à l’exception des hôpitaux : 50 jours), à condition toutefois de respecter les exigences fixées par le CCAP !
- les conditions d’exécution des prestations : le CCAP règle les problématiques liées aux lieux et aux moyens d’exécution, ainsi que les modalités de stockage, d’emballage, etc.
Pour les marchés de prestation intellectuelle et de technologies de l’information et de la communication :
- le CCAP fixe le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats. En particulier 2 types de régime peuvent s’appliquer : l’option A, qui s’applique par défaut, est la concession au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés par le marché, à titre non exclusif, du droit d’utiliser ou de faire utiliser les prestations intellectuelles fournies dans le cadre du marché. L’option B, plus rare, est la cession au pouvoir adjudicateur, à titre exclusif et dans son intégralité, des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats
- Les opérations de vérification et d’admission (réception, ajournement, réfaction, rejet) de la prestation. Au terme de ces opérations, en cas d’admission de la prestation, le transfert de propriété s’opère et le délai de garantie démarre dans les conditions prévues au CCAP
- La résiliation du marché : les conditions de résiliation du marché peuvent être très variées.
- Enfin, les pénalités : il s’agit de l’article du CCAP qui déroge le plus souvent au CCAG. En effet, avant la résiliation du marché, il s’agit de l’outil à disposition du pouvoir adjudicateur le plus efficace pour contraindre le titulaire du marché.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP):
C’est en quelque sorte le « cahier des charges » à proprement parler. Ce document exprime les besoins du pouvoir adjudicateur en régissant les aspects techniques au cours de l’exécution du marché.
Par conséquent, le volume et le contenu de cette pièce sont extrêmement variables d’un marché à l’autre.
Le CCTP est parfois fusionné avec le CCAP : il est alors intitulé « Cahier des Clauses Particulières » (CCP) ou « Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières » (CCATP).
Les pièces financières : Selon la forme du marché, il peut être remis au candidat un Bordereau des Prix unitaires (BPU), un Devis Quantitatif Estimatif (DQE), et/ou une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Le DQE accompagne le BPU dans les marchés à bons de commande. Le pouvoir adjudicateur recourt aux marchés à bons de commande lorsqu’il ne connaît pas avec précision l’étendue exacte de ses besoins. En contrepartie, il garantit au titulaire l’exclusivité des commandes pour la durée globale du marché (ex. marché de fournitures de bureau ; marché de denrées alimentaires).
Dans cette hypothèse, le candidat doit compléter intégralement les deux documents :
- Le BPU contient les prix unitaires sur chaque poste du marché : cette pièce deviendra contractuelle.
- Le DQE reprend les mentions du BPU ; il contient en outre les quantités estimées poste par poste. Ces quantités ne sont pas contractuelles; elles doivent toutefois guider le candidat pour la détermination de ses prix, et permettent au pouvoir adjudicateur de départager les candidats sur une base pondérée.
Erreur fréquemment commise par les candidats, les mêmes prix unitaires doivent être indiqués au sein du BPU et du DQE.
La DPGF est fournie dans les marchés conclus à prix forfaitaires (ex. construction d’un bâtiment ; réalisation d’un audit) Comme son nom l’indique, ce document a vocation à expliquer au pouvoir adjudicateur le détail du montant global forfaitaire sur lequel s’engage le candidat pour réaliser le marché.
Certains pouvoirs adjudicateurs construisent la DPGF en reprenant les clauses du CCTP.
La DPGF peut prévoir des quantités, ou laisser le soin aux candidats de les compléter par eux mêmes.
D’autres pièces peuvent être communiquées par le pouvoir adjudicateur : plans, analyses, études… En tout état de cause, il incombe au candidat de vérifier qu’il est en possession de l’intégralité du DCE, la liste récapitulative des pièces figurant au sein d’un article du règlement de consultation !
Article par Sylvain LE TURCQ