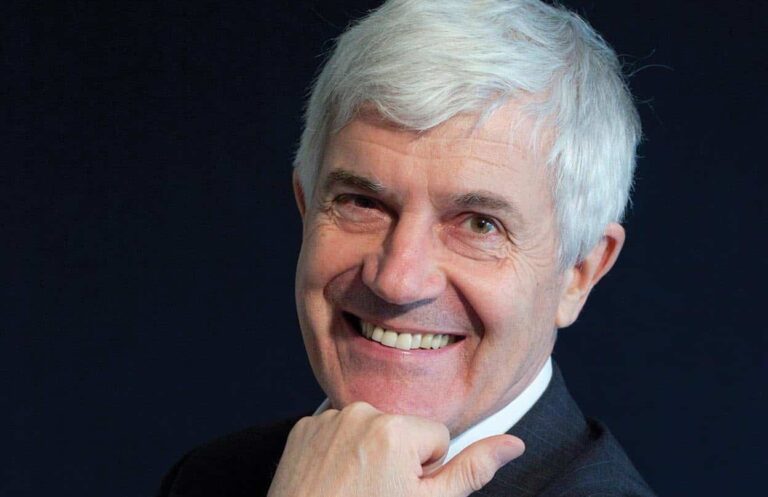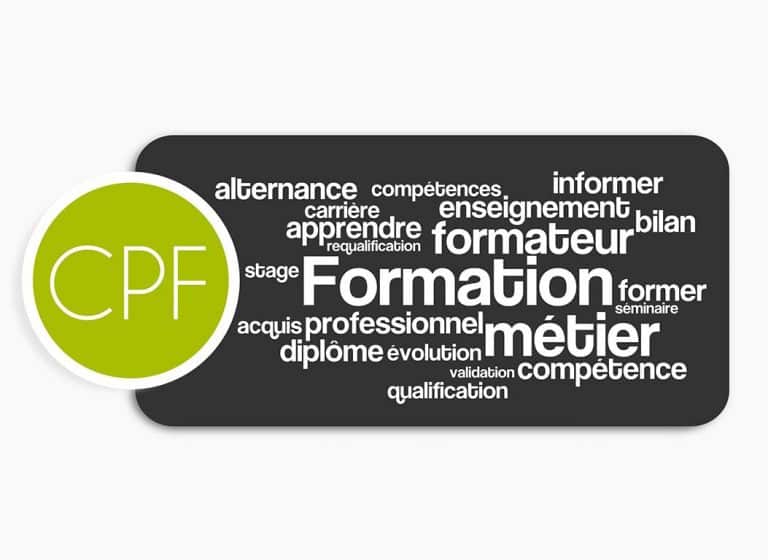Entretien exclusif avec Renaud Guillerm, cofondateur du site de vente en ligne Videdressing.com, passionné de mode, d’entrepreneuriat et par ailleurs Business Angel.
Comment en êtes-vous arrivé à l’entrepreneuriat ?
Mes études en gestion et finance à Dauphine m’ont amené à passer 5 ans dans le cabinet d’avocat Ernst & Young, puis 7 ans chez Ipsen, un groupe pharmaceutique français, en tant que directeur fiscal. J’ai ensuite vécu une première expérience d’entrepreneur en 1999, à 25 ans. à l’époque, tous mes amis créaient des entreprises, car la bulle internet n’avait pas encore éclaté. J’observais cet écosystème de l’extérieur lorsqu’un de mes amis m’a proposé d’investir dans sa start-up, Equesto, devenue Wcube, puis Publicis Modem. J’ai pu ainsi vivre l’aventure entrepreneuriale par procuration. En l’occurrence, j’ai eu de la chance, car la boîte a traversé la crise et a été revendue au groupe M6. Cette première expérience m’a donné envie de me lancer, ce que j’ai fait en 2009 avec Meryl Job pour créer Videdressing.com.
Pourtant, de fiscaliste à entrepreneur, on a l’impression qu’il y a un monde…
Bien sûr, ce sont deux métiers qui n’ont rien à voir. Mais la fiscalité ne constitue pas un univers si poussiéreux ! En tant que directeur fiscal, je me suis retrouvé au cœur de toutes les opérations essentielles à l’entreprise. Je ne définissais pas la stratégie à proprement parler, mais je la voyais passer devant mes yeux ! L’entrepreneur, quant à lui, réalise des tâches qu’il n’a jamais eu l’occasion de faire. Lorsque vous possédez 10 ans d’expérience, vous commencez à réaliser les tâches avec plus de confort, alors qu’un entrepreneur ne se sent jamais à l’aise à ses débuts ! Il travaille à la fois dans le domaine du service client, du marketing et du web. Ce n’est pas facile de jongler entre tous ces éléments mais une fois que la structure commence à se solidifier, cela va mieux.
Pourquoi avoir sauté le pas ?
L’entrepreneuriat me parlait. Cela faisait dix ans que je faisais de la fiscalité, mais j’avais du mal à me projeter. Je ne voyais pas vraiment comment allait s’articuler mon avenir, si ce n’est que je me destinais à un poste de directeur fiscal dans une entreprise du CAC40. C’était donc le bon moment dans ma vie pour entreprendre. Le second élément déclencheur a été l’idée de départ. Le time-to-market était parfait pour se lancer ! Fin 2008, les bloggeuses de mode ont commencé à créer leur blog de vide-dressing, suivies de près par des milliers de lectrices. Le marché français de la mode et du luxe était mûr, ce qui nous a incités à faire le grand saut.
Le concept initial a-t-il évolué ?
Non ! Nous avons de la chance, car nous n’avons pas pivoté. Videdressing reste le premier site d’achat-vente entre particuliers de vêtements et accessoires de mode, véritable lieu de rendez-vous pour les passionnés qui se retrouvent pour vendre et acheter en toute confiance. Tous les produits qui circulent sur le site sont modérés par une équipe de juristes. Au total, nous prenons 10 % de commission sur les transactions. Le modèle fonctionne, nous l’avons donc conservé !
Comment êtes-vous parvenus à vous faire connaître ?
Nous nous sommes lancés en partenariat avec les bloggeuses de mode, qui prescrivaient notre solution à leurs lectrices. Cela nous a permis de toucher notre cœur de cible dès le départ. Mais nous avons surtout bénéficié de l’effet « Capital », puisque M6 nous a sollicités pour leur émission en mars 2011. Un reportage d’une dizaine de minutes nous a été entièrement consacré. C’est à partir de ce moment-là que l’activité a véritablement décollé. Depuis, nous nous appuyons sur deux piliers en matière de communication : les relations presse et le référencement naturel de l’autre.
En 2013, l’entreprise est passée de 12 à 80 collaborateurs en 18 mois. Comment gère-t-on une croissance si soudaine ?
C’est très compliqué. Vous passez d’une structure qui ne demande pas beaucoup d’organisation pour que l’information et la cohésion s’effectuent correctement, à un système complètement inverse ! L’inconvénient, c’est que quand la croissance s’effectue trop rapidement, vous mettez du temps à appréhender ce qui ne fonctionne pas. Il existe une période de flottement où les équipes ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer. En tant qu’entrepreneur, il faut se préparer à cela, prendre régulièrement le pouls des collaborateurs, discuter avec ses amis entrepreneurs pour prendre exemple sur ceux qui sont aussi passés par là. Mais j’ai conscience que cela demeure plus facile à dire qu’à faire, car un créateur reste préoccupé par le quotidien, le chiffre d’affaires… Si c’était à refaire, j’aurais mis des processus en place plus vite !
En plus de vos fonctions, vous continuez à être un Business Angel actif…
Je suis un passionné d’entrepreneuriat. Dans ce milieu, il existe un esprit et une fraîcheur que l’on ne retrouve pas ailleurs. Lorsque vous écoutez un entrepreneur parler de son projet, vous prenez un bon bol d’air frais ! Aujourd’hui, j’ai investi dans une quinzaine de start-up, principalement dans le web car il s’agit d’un domaine que je connais bien. J’aime discuter de leur projet, de leurs problématiques. J’aime rencontrer des individus passionnés.
Quels conseils donneriez-vous aux porteurs de projet ?
J’assimile souvent l’entrepreneuriat à une course d’obstacles, dans laquelle il vous faudra successivement franchir des murs de plus en plus imposants. Un entrepreneur peut gravir ces obstacles car il se dit qu’il n’a pas réalisé tous ces efforts pour arrêter en cours de route. Alors qu’en réalité, s’il avait pu observer le parcours d’obstacles dans son ensemble, il ne se serait probablement jamais lancé… Il faut donc rester persévérant et se donner du temps pour réussir, c’est essentiel ! Parfois, l’activité ne fonctionne pas comme vous l’aviez écrit dans le business plan, ce n’est pas grave. Mon second conseil serait de s’organiser pour faire durer l’aventure.
Financièrement, il existe en France des aides à ne pas négliger, comme celles de Pôle Emploi, qui permettent de lancer un projet tout en touchant le chômage pendant un an et demi ! C’est important car si en plus du stress, de la charge de travail et des risques que l’entrepreneuriat implique, vous vous retrouvez contraints à manger des pâtes en restant chez vos parents, vous allez vite vous décourager… Enfin, dernier conseil clé : n’hésitez pas à solliciter votre entourage pour lever de l’argent. Vous vous sentirez soutenu par des personnes qui s’intéressent à vous et à votre projet. En 2009, un couple d’amis avait investi dans Videdressing. Ils me demandaient tous les quinze jours ce qu’ils pouvaient faire pour l’entreprise. C’est sympa et cela motive !