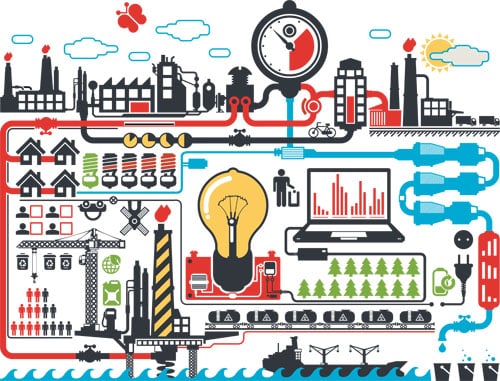Les financements sont le nerf de la guerre pour développer les projets ou les entreprises. Décrocher des subventions s’avère un excellent moyen pour compléter le capital d’une entreprise. Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de bénéficier des subventions !
Les subventions sont des aides financières publiques non remboursables à la différence des prêts bancaires classiques. Elles sont principalement destinées aux entreprises, aux associations et aux collectivités. Ce sont les pouvoirs publics locaux (communes, communautés d’agglomérations, communautés de communes, départements, régions), l’état par le biais de structures décentralisées et l’Europe qui peuvent intervenir en attribuant des subventions. Il ne faut pas non plus négliger les fondations qui peuvent aider une entreprise à se développer notamment pour ce qui est des problématiques liées à l’économie sociale et solidaire.
Une base de données, mise à jour régulièrement et accessible gratuitement, recense plus de 1600 aides financières, classées par besoin, par zone géographique ou encore par secteur sur le site Aides-entreprises.fr
Les subventions aussi pour les petites entreprises
Les subventions sont encore peu utilisées. Plusieurs a priori subsistent : une grande majorité pense que les subventions sont des aides publiques uniquement destinées aux grandes entreprises et spécifiquement celles en crise alors que toute entreprise peut y avoir accès sous conditions d’éligibilité. Le contrôle fiscal est aussi une grande crainte des porteurs de projets qui pensent à tort qu’en cas de subventionnement ils seront davantage contrôlés. Pour qu’une entreprise ait ce genre de contrôle, il faut notamment que ces responsables aient volontairement mal utilisés les fonds obtenus.
1600 subventions à votre disposition
Il est possible de faire subventionner une multitude de projets. Les institutions peuvent intervenir soit dans le cadre d’appels à projets temporaires, soit dans le cadre de programmes annuels de financement (candidatures pouvant être déposées à tout moment). Elles peuvent venir en aide dans des domaines très variés (actions collectives – coopération inter-entreprises, artisanat – commerce, cinéma – audiovisuel – édition littéraire, création – reprise d’entreprise, économie sociale et solidaire, emploi, environnement – maîtrise de l’énergie, études – conseils, export – développement commercial, formation, fonctionnement, hôtellerie – restauration – tourisme, immobilier d’entreprise, investissement matériel, innovation – R&D…).
Sélectionner avec rigueur les subventions
Pour réussir à obtenir des financements, il faut avant tout savoir au mieux les cibler. Pour cela, une veille financière adaptée devra être mise en place notamment pour ce qui est des appels à projets. Dès lors qu’une subvention a été ciblée, il est ensuite nécessaire d’intégrer les étapes-clé de la procédure de demande. Il faudra tout d’abord identifier les structures publiques afin d’obtenir le dossier de candidature adéquat ainsi que le document d’explication du programme de subvention. La connaissance des circuits et des acteurs décisionnels du programme est un plus car elle permet d’une part d’optimiser les chances de réussite et d’autre part de planifier au mieux son projet.
Ensuite, les porteurs de projets devront préparer un projet au moins 5 à 6 mois à l’avance en lien avec leurs conseils. La rédaction d’une fiche projet est essentielle. Elle présentera de manière synthétique le projet en respectant les parties du dossier de demande de subvention. Sa rédaction facilitera par la suite le montage du dossier officiel.
Connaître les rouages de l’écriture administrative
Le projet ainsi pré-rédigé officiellement ne devra pas être trop technique. L’instructeur formulant les avis n’est la plupart du temps qu’un généraliste et non un technicien. En plus de définir un projet solide répondant aux critères d’éligibilité, il est aussi nécessaire de se conformer aux conditions dites officieuses. Pour cela, il est conseillé de définir un projet percutant en corrélation avec les objectifs sociaux et économiques du programme de subvention. Il est aussi important de mettre en avant une méthodologie de suivi et d’évaluation qualitatif/quantitatif du projet.
Dans le cadre du montage, le porteur de projets devra se conformer aux obligations administratives en respectant les formes rédactionnelles demandées, en renseignant notamment les formulaires fournis. Si des partenaires sont demandés, ils devront être en lien avec le projet présenté et devront accompagner avec le dossier d’une lettre de soutien.
La présentation du budget demande une préparation minutieuse
La partie budgétaire est la plus complexe à rédiger. Il faut d’une part présenter un budget équilibré, détaillé et exprimé en euros et d’autre part présenter des cofinancements percutants privés et/ou publics. Il est aussi conseillé à ce qu’un minimum d’autofinancement soit présenté pour démontrer la motivation du porteur de projets à financer son projet. L’institution n’interviendra jamais dans l’intégralité du financement, le taux d’intervention étant en général compris entre 20 et 80 %.
Lors du dépôt du dossier de demande de subvention, il est vivement recommandé de gérer efficacement son suivi. Pour cela, suivre son cheminement est essentiel en se constituant un fichier de contacts et en créant des fiches de suivi pour les procédures d’évaluation du projet. Il faut aussi rappeler qu’il est important d’avoir de bons rapports avec son instructeur en lui prouvant sa motivation à conduire le projet déposé. Les rapports humains sont d’une grande importance, d’autant plus que la plupart du temps, ce sera le même instructeur qui fera le suivi des engagements financiers du porteur du projet.
Dans tous les cas, avec l’instructeur il faudra argumenter sur l’utilité de son projet (ex. économique, sociale, territoriale et environnementale) et sur les orientations budgétaires prises. Il est également possible que soient demandés des documents complémentaires.
En période de morosité économique, les fonds publics permettent de rassurer bon nombre d’acteurs participants aux financements classiques des entreprises comme les banques. Bien qu’ils soient encore peu utilisés, ils permettent un soutien non négligeable au développement des entreprises.
A savoir : 6 Aides Financières Simplifiées de la CARSAT relancées en janvier 2018.
Les CARSAT ont réactivé 6 Aides Financières Simplifiées depuis janvier. Elles interviennent sous forme de subvention. Elles financent l’acquisition de matériels et équipements permettant de réduire les risques professionnels visés :
- Air Bonus est destinée aux centres de contrôle technique. Elle vise la réduction de l’exposition de leurs salariés aux gaz et fumées d’échappement,
- Bâtir + est destinée à prévenir les risques professionnels dans les entreprises du BTP de moins de 50 salariés,
- Fimeuse + soutient financièrement les actions de prévention des risques associés au filmage manuel des palettes,
- Stop Amiante vise la réduction des expositions aux fibres d’amiante au niveau le plus bas possible lors des travaux d’entretien et/ou de maintenance. Elle concerne les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du bâtiment, des travaux publics, du nettoyage et de la maintenance,
- TMS Pros Diagnostic soutient les entreprises de moins de 50 salariés dans la mise en oeuvre d’une démarche de prévention du risque TMS (Troubles Musculo-Squelettiques),
- TMS Pros Action finance l’acquisition d’équipements et matériels permettant de diminuer les contraintes physiques.
Attention !
Ces 6 aides financières simplifiées sont à réserver avant le 31 décembre 2018.
Article par THIBAULT NIVIERE | CONSULTANT | CABINET NIVIERE |