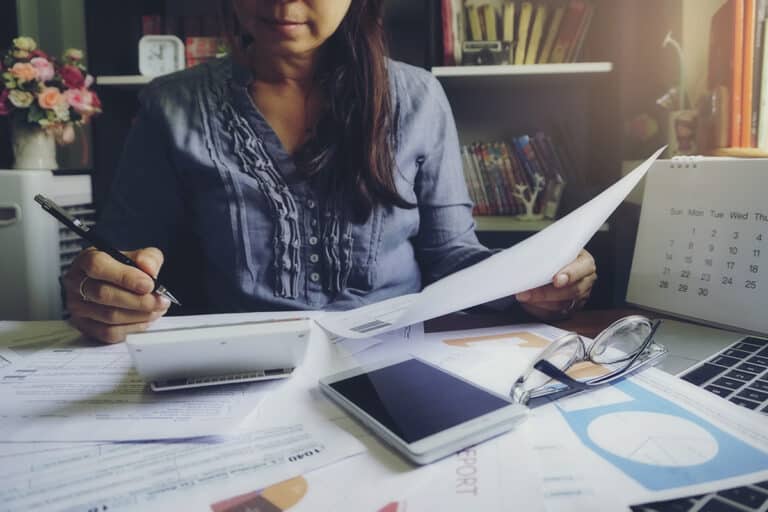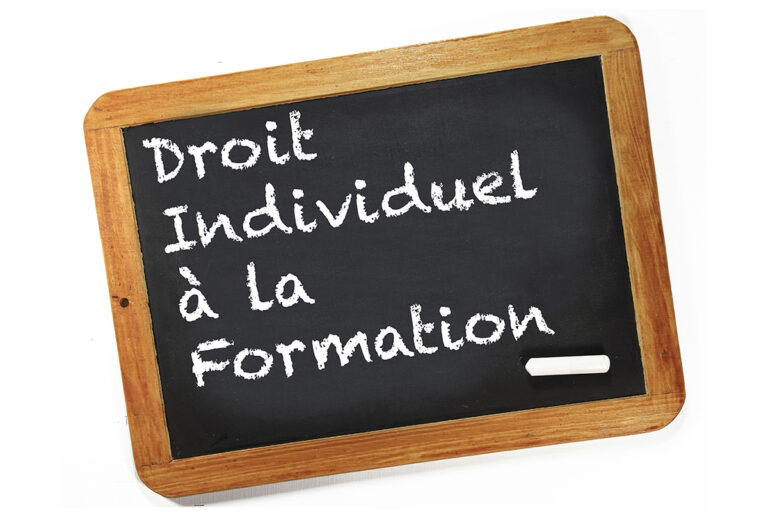Lorsqu’un retraité se mue en créateur ou repreneur d’une entreprise, les revenus tirés de sa nouvelle activité peuvent influer sur sa pension retraite, le cumul de ces deux ressources n’étant pas toujours autorisé.
Départ en retraite
En principe, la personne désireuse de partir à la retraite est tenue de cesser l’activité du régime au titre duquel elle demande la liquidation de sa retraite. Cette règle ne lui interdit pas de reprendre ultérieurement une activité rémunérée mais ce cumul peut avoir des conséquences sur le versement de sa pension. À noter que, dans le cas d’un retraité fonctionnaire, la reprise d’une activité privée sera sans incidence sur sa pension de retraite.
S’il s’agit d’un salarié
Dans ce cas, il est tenu de rompre tout lien professionnel avec son dernier employeur. Une dérogation peut jouer si l’intéressé exerce une activité littéraire ou scientifique accessoire ou une activité de faible importance. Si au moment de la liquidation de sa retraite l’intéressé exerçait une activité non-salariée, il peut continuer à l’exercer s’il ne demande pas à bénéficier de ses droits à la retraite au titre du régime des travailleurs indépendants.
S’il s’agit d’un travailleur non-salarié (TNS)
Dans ce cas, il doit en principe cesser toute activité professionnelle pour percevoir une pension de retraite. Tel n’est pas le cas s’il est artisan ou commerçant. Il peut alors percevoir sa pension de retraite de base sans avoir à cesser son activité indépendante si ses revenus professionnels ne dépassent pas la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (qui correspond à 17 310€ en 2010) ou, s’il exerce son activité en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en zone urbaine sensible (ZUS), alors que ses revenus professionnels ne dépassent pas le plafond annuel de sécurité sociale (qui correspond à 34 620€ en 2010).
Cumul libre
Les bénéficiaires d’une pension de retraite peuvent sans limitation la cumuler avec les revenus générés par une nouvelle activité si l’intéressé a liquidé toutes ses pensions de vieillesse, est âgé d’au moins 60 ou 65 ans et justifie d’une durée d’assurance qui ouvre droit à une retraite à taux plein. Cette règle vaut pour les retraités du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole, du régime social des indépendants et de l’assurance vieillesse des professions libérales.
Afin de bénéficier du cumul libre et en cas de reprise d’activité indépendante relevant du régime général, le retraité relevant dudit régime doit adresser à son dernier organisme d’affiliation les noms et adresses du ou de ses nouveaux employeurs avec la date de la poursuite d’activité et à sa ou ses caisses de retraite une attestation sur l’honneur qui signale qu’il est entré en jouissance de toutes ses pensions de retraite et mentionne les régimes de retraite dont il a relevé.
Afin de bénéficier du cumul libre et en cas de reprise d’une activité relevant du régime social des
indépendants, le retraité relevant dudit régime doit adresser une déclaration précisant la nature de l’activité reprise et une attestation sur l’honneur qui signale qu’il est entré en jouissance de toutes ses pensions de retraite et mentionne les régimes de retraite dont il a relevé.
À noter que ces différents documents doivent être délivrés dans le mois qui suit l’exercice d’une nouvelle activité ou au cours du mois de l’entrée en jouissance des pensions de retraite en cas de poursuite d’une activité.
Dans le cas où le retraité reprend une activité qui relève d’un régime de retraite autre que celui qui verse sa pension de retraite, il peut là aussi cumuler l’intégralité de sa pension si cette nouvelle activité professionnelle relève d’un régime social différent de celui qui lui verse ladite pension.
Cumul plafonné à un montant de revenu
Même s’il ne remplit pas les conditions du cumul libre, le retraité créateur ou repreneur d’une entreprise peut tout de même cumuler sa pension de retraite avec les revenus générés par une nouvelle activité indépendante dans les conditions suivantes.
S’il est un artisan ou commerçant retraité et qu’il reprend une activité artisanale ou commerciale
Il bénéficiera du maintien de ses pensions de retraite de base et complémentaire si ses revenus
professionnels ne dépassent pas la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (qui correspond à 17 310€ en 2010) ou, s’il exerce son activité en ZRR ou en ZUS, alors que ses revenus professionnels ne dépassent pas le plafond annuel de sécurité sociale (qui correspond à 34 620€ en 2010). En cas de dépassement de l’un de ces plafonds, le versement de ses pensions de retraite de base et complémentaire sera suspendu.
S’il est un professionnel libéral retraité qui reprend une activité artisanale libérale
Il bénéficiera du maintien de sa retraite de base si ses revenus professionnels ne dépassent pas le plafond annuel de sécurité sociale (qui correspond à 34 620€ en 2010). En cas de dépassement de ce plafond, le versement de sa pension sera suspendu.
En revanche, sa pension de retraite complémentaire sera maintenue. De même, aucune minoration ne sera a priori effectuée. S’ils transmettent leur entreprise entre 60 et 65 ans, les dirigeants ne sont pas soumis au non-cumul durant les 6 mois suivant le premier jour du mois qui suit la date de la transmission.
Si le retraité salarié reprend une activité salariée ou assimilée
Tel peut être le cas s’il crée une entreprise où il relève du régime général de la sécurité sociale. Sa pension de retraite de base sera maintenue à la condition que ses ressources ne dépassent pas le montant de son dernier salaire brut d’activité ou un plafond qui correspond à 160% du SMIC. Sur ce dernier point, la caisse de retraite retiendra le plafond le plus favorable au retraité salarié.
S’agissant de sa pension de retraite complémentaire, son versement pourra être suspendu ou son montant minoré en fonction des revenus générés par son activité. Toutefois, la pension vieillesse des dirigeants non assujettis au versement d’assurance vieillesse est maintenue en intégralité. Concrètement, ce dernier dispositif concerne les associés commanditaires, les gérants minoritaires ou égalitaires non rémunérés de SARL et les associés non rémunérés qui ne travaillent pas dans la société, le président directeur général, le directeur général ainsi que les membres du directoire des SA qui ne perçoivent aucune rémunération.
Régime social en cas de cumul retraite/activité professionnelle
Au regard des cotisations sociales, le retraité créateur d’une entreprise est en principe redevable des
allocations familiales ainsi que de l’assurance vieillesse et maladie.
Toutefois, les cotisations d’allocations familiales ne sont pas dues en cas de faibles revenus, soit moins de 4 670€ en 2010.
Pour les cotisations au régime d’assurance maladie, elles sont simultanément dues au titre du régime dont relève sa retraite et du régime dont dépend son activité professionnelle. Au choix de l’intéressé, le droit aux prestations n’est ouvert que pour l’un de ces régimes. Toutefois, la cotisation minimale n’est due que si le retraité bénéficie des prestations maladie du régime général.
Même en l’absence de revenus imposables, les cotisations au titre de l’assurance maladie sont dues. Il est alors fait application des cotisations minimales à moins que le retraité ne bénéficie du régime micro-social de l’auto-entrepreneur.
Au regard de la protection sociale, le retraité relève pour ses prestations sociales du régime social de son activité principale.
S’agissant des cotisations versées dans le régime de retraite de base ou de retraite complémentaire, tout dépend du régime d’affiliation de la nouvelle activité.
Si le régime qui verse la pension de retraite est différent du régime auquel le retraité est affilié dans le cadre de sa nouvelle activité, les cotisations versées pour la retraite de base et la retraite complémentaire sont productives de droit.
Si le régime qui verse la pension de retraite est le même que le régime auquel le retraité est affilié dans le cadre de sa nouvelle activité, les cotisations versées pour la retraite de base et la retraite complémentaire ne sont pas productives de nouveaux droits.