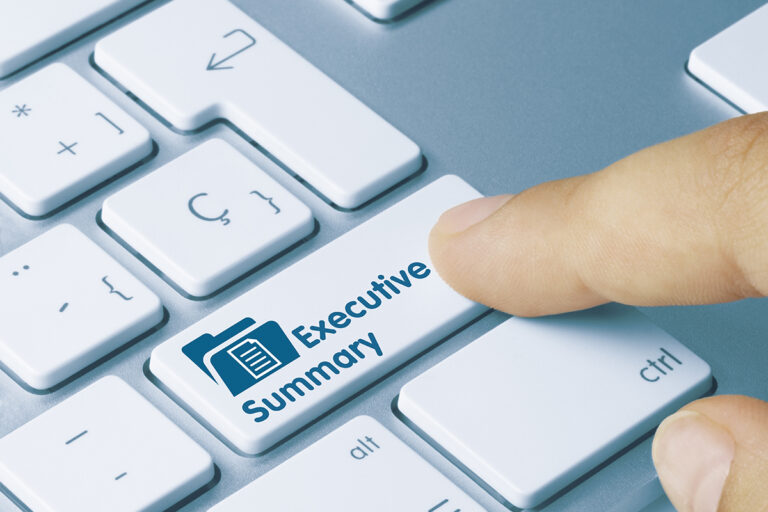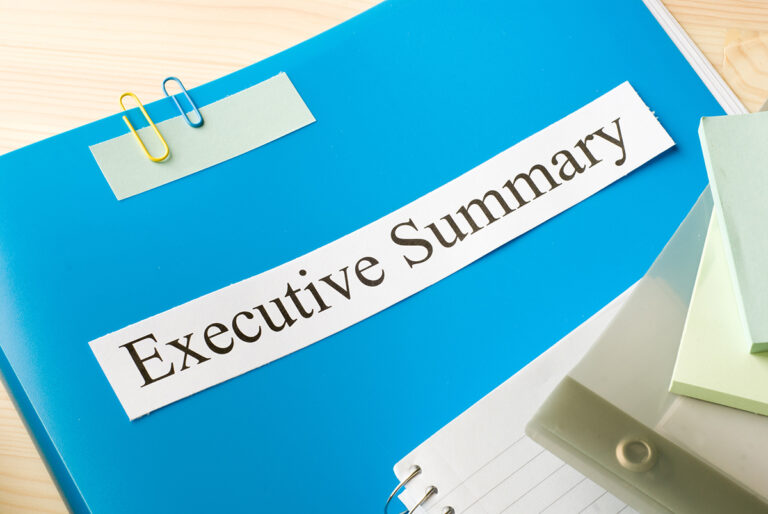Pour fixer le salaire d’un futur collaborateur, il convient avant tout de se poser les bonnes questions. De quelle ressource avez-vous besoin pour votre croissance ? Pour quel poste ? Un débutant, une première expérience, un expert, un diplômé, à temps plein, mi temps… ? Une fois le profil défini, cela vous permettra d’allouer une fourchette de salaire dans votre budget prévisionnel. Cependant il faut respecter certaines conditions légales régies par le code du travail et la convention collective dont vous dépendez.
Soyez cohérent, juste et attractif
Il faut prendre en compte plusieurs paramètres afin d’être cohérent avec votre stratégie de développement et votre équipe existante. Le salaire rétribué correspond à un travail fourni. Il est déterminé dans un contrat établi à l’embauche et signé des deux parties. Il se fixe en fonction du poste défini, de l’expérience requise, de la formation demandée ou pas et des collaborateurs occupant déjà le poste dans l’entreprise.
Respectez les éléments du salaire
Le montant du salaire est librement choisi par l’employeur à condition de respecter le minimum requis (Smic, la convention collective et les dispositions légales applicables aux heures supplémentaires). Le SMIC : c’est le salaire minimum de croissance versé mensuellement pour un travail effectué. Il peut se calculer en temps, à la pièce, au forfait… Il s’applique à tous les salariés sauf les VRP, apprentis, personnels des hôtels et restaurants, jeunes travailleurs… Un complément de salaire peut être prévu et est obligatoire s’il est stipulé dans le contrat ou la convention collective. Il sera versé sous forme de primes, pourboires ou avantages en nature : nourriture, logement, véhicule, téléphone, ordinateur…
La convention collective : territoriale ou professionnelle. Définis par votre code APE, le code du travail et les lois relatives au contrat de travail peuvent être complétés par des accords de branches professionnelles avec les syndicats de salariés où sont négociés les conditions de travail et des garanties sociales. Son champ d’action territorial ou professionnel peut définir un salaire minimum plus favorable que le SMIC, des heures supplémentaires, de la durée de la période d’essai, de la durée du préavis et des indemnités de licenciement.
L’employeur doit respecter la durée légale journalière (pas plus de 10h/jour) et hebdomadaire du travail (48h ou 44h sur 12 semaines consécutives selon certaines conditions). Les heures supplémentaires sont fixées par la convention collective et donnent droit à un complément de rémunération ou à un repos compensateur.
La négociation de salaire
Votre futur collaborateur peut renégocier son salaire à l’entrée. Si son profil est rare, réfléchissez et repositionnez-le dans votre contexte, vous trouverez ainsi un compromis gagnant / gagnant. Ne laissez pas passer un talent ou bien c’est la concurrence qui en bénéficiera.
Conseil
Motivez et valorisez vos collaborateurs. Pensez à faire évoluer leur salaire car cela représentera la récompense d’un travail réalisé avec succès et de fidélité à l’entreprise. Fixer le salaire d’un collaborateur demande une réflexion qui doit se prévoir en amont dans sa stratégie de développement. Suivez le guide…
Article par VÉRONIQUE RIVERA | DIRECTRICE | VERINIS SOLUTIONS RECRUTEMENT | WWW.VERINIS.FR