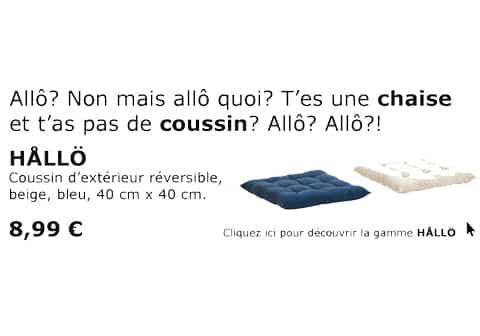La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) est encore aujourd’hui trop souvent assimilée à des préoccupations environnementales, surtout pour les petites entreprises, malgré une prise de conscience assez spectaculaire ces dernières années. Elle représente pourtant une occasion unique pour l’entreprise de revisiter sa politique sociale et managériale: la RSE permet clairement d’enrichir la gestion des Ressources Humaines, très souvent mise à mal ces derniers temps mais elle permet surtout de remettre les salariés au cœur de la performance de l’entreprise.
La RSE, une petite révolution pour une grande politique sociale
En tout premier lieu, la RSE redonne la possibilité à l’entreprise de revoir son mode de management, encore trop souvent top down et uniquement descendant : révolutionnaire par son approche, elle permet d’aborder le management de façon un peu plus collaborative et participative avec les salariés sans toutefois abandonner le squelette directif et hiérarchique absolument nécessaire…
Force est de constater que nombre d’entreprises engagées dans des démarches de RSE et ayant associé leurs salariés pour solliciter leurs idées et alimenter leur stratégie et actions phares sont toutes ravies des résultats. le Écoutons édifiant de Mathieu Boullenger, dirigeant de la société Plus que Parfait, société de nettoyage de 160 salariés implantée en Seine-Saint-Denis : « 1 fois par an, nous envoyons un courrier aux salariés pour les associer aux rencontres que nous faisons avec nos fournisseurs afin de revoir les référencements produits et matériels et mieux répondre aux besoins émergents du terrain… ».
Et au niveau du processus de gestion des RH, quels impacts ?
Pour les entreprises de taille moyenne, la RSE donne une occasion unique de revoir le processus RH, et d’en faire une réelle structure centrale de relai et de soutien aux managers de proximité : acteurs stratégiques et opérationnels du déploiement de la démarche RSE, les DRH sont les garants d’un management de terrain qui soit responsable. Enfin, un moyen de remettre cette gestion RH au cœur de son rôle premier : permettre aux salariés de donner le meilleur d’eux-mêmes et de travailler dans le même sens pour servir avant tout les valeurs, la mission et les objectifs que s’est fixés l’entreprise…
Pour les plus petites entreprises, sans politique RH structurée ni DRH interne, disons que la RSE est avant tout un moyen pour redonner cette bouffée d’oxygène et ce nouvel élan nécessaire pour mobiliser les collaborateurs autour d’un projet d’entreprise porteur de sens et de valeurs fortes.
Ceci dit, ne nous leurrons pas, soyons réalistes…sur le terrain, la démarche de RSE commence parfois tout simplement par engager des actions basiques de RH généralistes mais qui n’ont pas été mises en place, faute de temps et de moyens : au four et au moulin, 98 % des dirigeants ne touchent pas terre dans les 5 premières années…et la gestion des RH s’en ressent…beaucoup de petites entreprises n’ont ni entretiens professionnels, ni formations… « Savoir bien recruter, réussir son sourcing, avoir une politique de recrutement non discriminante, avoir les bons outils de management, n’est pas tellement chose courante dans les entreprises, surtout dans notre secteur de la propreté ». Mathieu a donc commencé par des actions qu’il nomme basiques en recrutant un responsable RH à temps partagé puis une fois les fondations mises en place, la politique de RSE qu’il a déployé accompagné de la FEP et de la CCI de Paris Seine-Saint-Denis, lui a permis d’aller beaucoup plus loin : ambition, innovation, participation,respect, reconnaissance, appartenance, volonté, sont ses maîtres mots.
Tenez, prenons par exemple le sujet de l’innovation : les consultants qui accompagnent les petites entreprises ont d’ailleurs à cœur de traiter ce sujet de la RSE dans leurs accompagnements : écoutons Marie Hélène Joron du cabinet MHJ Conseil : « La croissance d’une entreprise se trouve essentiellement dans sa capacité à innover, c’est encore plus prégnant dans une PME. Au niveau RH, l’innovation peut se traduire par l’introduction de nouveaux modes de management, par la mobilisation de ses salariés autour d’un projet qui intègre des qualités comme le partage, la confiance, la sincérité, la responsabilité ; autant de comportements humains mis en avant par une grande majorité de salariés, notamment des jeunes générations, et qui s’inscrivent dans les valeurs de la RSE. En matière de process RH, cette innovation peut se concrétiser de nombreuses manières à travers de nouvelles pratiques de recrutement engageant des partenariats avec des écoles de proximité et des associations d’insertion ou l’adoption de nouvelles organisations du travail tenant compte davantage des aspirations des salariés. On se rend compte souvent qu’introduire plus de souplesse et de liberté horaires ne vient pas forcément contrarier l’équilibre et le bon fonctionnement de l’équipe ; tout au contraire, les salariés se sentent responsabilisés, ils sont reconnaissants de la confiance qui leur est témoigné et s’approprient le projet plus aisément et de manière plus profitable à l’entreprise ». Profitabilité pour l’entreprise, nous dit Marie-hélène Joron.
Allons voir de plus près les bénéfices…
Quels thèmes traités pour quels bénéfices ?
Que ce soient en termes de diversité, d’employabilité, de formation, de santé-sécurité, d’égalité des chances, d’éthique des affaires, d’engagement sociétal des salariés, de nouvelles politiques de rémunération,tous les sujets de RH sont scrutés et scannés par la politique RSE. Tous ces thèmes ne peuvent pas nécessairement être traités tous en même temps, l’important est encore une fois de rentrer dans une démarche de progrès et de comprendre ses enjeux prioritaires en fonction de la stratégie que s’est fixée l’entreprise en matière de RSE.
Mais encore une fois, ces enjeux sont sectoriels et dans certains secteurs, il est plus prégnant et légitime d’axer sa politique RH sur les risques psycho-sociaux (harcèlement, agression, violences, pour les convoyeurs de fonds, la pharmacie ou même l’hôtellerie, mais aussi risque de stress et d’isolement pour les salariés dans le secteur du nettoyage) et dans d’autres sur les politiques de recrutement (risque de recours abusif aux contrats précaires dans le secteur du BTP ou de la restauration) ou encore sur l’égalité professionnelle hommes-femmes (écarts de salaires entre hommes et femmes importants dans les activités financières, les services aux entreprises et le commerce).
Une chose est sûre, c’est que des salariés considérés, remotivés autour d’un projet porteur de sens comme la RSE, et plus intégrés globalement, sont plus productifs. Une étude de la CCI Région et Réseau Alliances qui a interrogé 800 chefs d’entreprises de la région Nord Pas de Calais qui ont intégré la RSE dans leur business model montre que parmi un certain nombre de bénéfices, l’amélioration de la cohésion interne ressort pour 36 % d’entre elles.
Une compilation de plus de 200 travaux de recherche portant sur plus de 250 000 personnes, extraite du livre « The Happiness Advantage », a montré que les salariés qui se sentent heureux sont plus productifs, ont des meilleures performances commerciales et sont de meilleurs managers. Une étude a en effet montré un écart de performance de 30% en faveur des équipes dont les managers se montrent positifs et encourageants.
Sans tirer de conséquences hasardeuses directes entre bonheur des salariés et RSE, il est quand même fort à parier que cette dernière y contribue et en est même une condition essentielle…
La liste des bénéfices est donc sans fin… : renforcement du lien et du dialogue social, amélioration du bien-être et de la convivialité, amélioration des conditions de travail et du management, et au final augmentation de la productivité et de la performance…
Regardons à nouveau de plus près les actions mises en place par la société Plus que Parfait, et les bénéfices qui sont absolument édifiants eu égard au secteur de la propreté pas toujours reluisant en termes de conditions de travail. Ecoutons-le à nouveau « Nous recrutons des personnes en situation de handicap et éloigné de l’emploi, nous avons un fort dialogue social et des réunions avec l’ensemble des salariés 2 / an, nous travaillons sur la conciliation de la vie privée et professionnelle en mettant en place des forfaits jours ce qui permet à nos salariés de récupérer des jours de repos, nous avons une politique de formation très ambitieuse allant bien au-delà de la réglementation ». Et les résultats parlent d’eux-mêmes, 1 seul passage au prudhomme en 8 ans avec 160 salariés quand la moyenne de la profession engage 5 % de la masse salariale et une fidélisation des clients exceptionnelle, moins de 10 clients perdus en 8 ans, imbattable ou presque dans ce secteur. Pas étonnant selon Mathieu qui rajoute : « nos salariés sont fiers de travailler pour notre entreprise de propreté et la relation avec les clients s’en ressent, aujourd’hui, nos salariés sont clairement au cœur de la performance de notre entreprise ».
Un sujet sensible à manier avec précaution
Attention toutefois à ne pas tomber dans un monde utopique, surtout en temps de crise…
L’entreprise fait souvent ce qu’elle peut dans des marchés qui se resserrent sur du très court terme et tente contre vents et marées aujourd’hui de sauvegarder ses emplois.
La crise ne doit pas cependant être un prétexte pour ne rien faire, elle a le mérite de poser les bonnes questions sur les politiques sociales des entreprises.
Dans tous les cas, il est essentiel d’adapter l’approche sociale RSE au mode de fonctionnement de l’entreprise, à la réalité de son marché, à son histoire et à sa culture au risque de créer des tensions entre les salariés et la direction: une entreprise décennale très paternaliste n’abordera pas le sujet de la même façon qu’une start-up innovante…l’important c’est de comprendre ses marges de manœuvre, d’aller à son rythme et de se poser les bonnes questions.
Et un dernier maître mot, mais qui est capital, point de crédibilité dans une démarche sociale de RSE sans exemplarité ni cohérence : dirigeants et entrepreneurs, à vos bâtons de pèlerins…