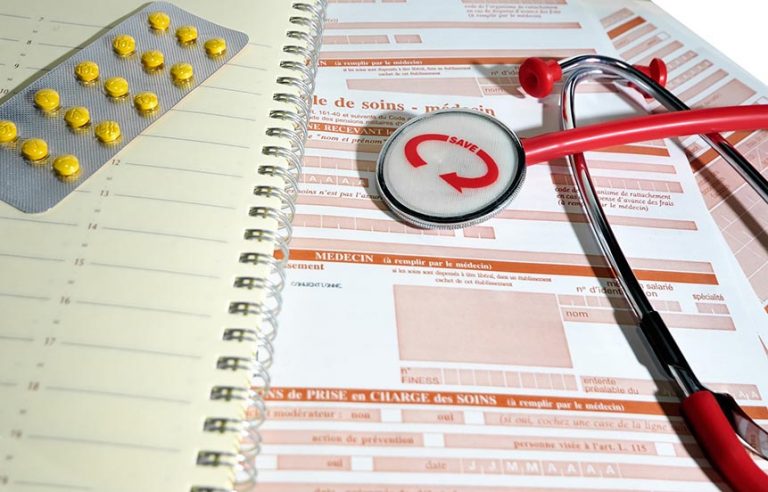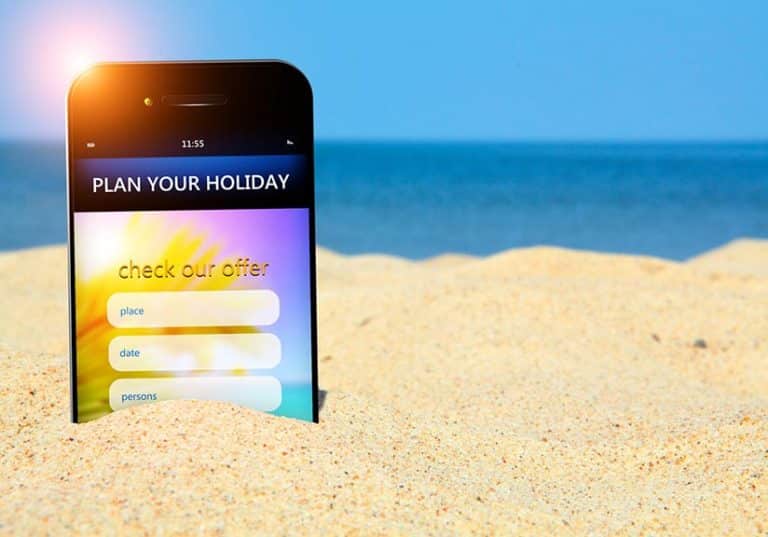A côté des géants tels que Nestlé ou Danone, il y a de la place pour de jeunes entreprises innovantes et créatives qui proposent des produits surprenants. Le secteur de l’agroalimentaire représentant 640 milliards d’Euros en Europe, obtenir une toute petite part de ce gros gâteau semble déjà quelque chose de très intéressant. La preuve avec ces quelques start-up qui triomphent dans le domaine.
Une pionnière, Michel et Augustin
Les trublions du goût sont nés en 2004 dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Tout est parti de nombreux essais de réalisation de petits sablés dans la cuisine du petit appartement d’Augustin Paluel-Marmont. Lui et son acolyte Michel de Rovira sont partis à la conquête de la capitale, démarchant dès 2005 cordonniers, épiciers, kiosquiers et Point Soleil, puis la Grande Epicerie de Paris, les cafés Bert’s, Colette, Monop, Carrefour et Monoprix. Depuis, leur entreprise n’a cessé de se développer, multipliant ses produits et augmentant son chiffre d’affaires, lequel atteignait 30 millions d’euros en 2014, soit une croissance de 38% par rapport à l’année précédente. Persévérance, ténacité et culot sont les maîtres mots de leur réussite.
Prêt à pousser et ses kits de champignons
En 2013, deux jeunes entrepreneurs ont l’idée de collecter le marc de café auprès des bistrots parisiens pour y faire pousser des champignons en kit. Lauréat du réseau Entreprendre du 95, ils commencent seuls leur production dans leur atelier à Montmagny. Mais il apparaît que les pleurotes ne se plaisent guère dans le marc de café. Les deux fondateurs changent alors de produit, faisant appel à un prestataire pour leur fournir de la sciure de bois recyclée, à la fois naturelle et efficace. En six mois, ce sont plus de 20 000 bottes de pleurotes qui sont vendues. Aujourd’hui, ils tentent de lever des fonds pour se développer, en conquérant des marchés européens et en ajoutant un nouveau produit autour des plantes aromatiques. Le web est un vecteur essentiel de leur développement, permettant la vente et le contact direct avec les clients. Ils ont ainsi plus de 18 000 fans sur leur page Facebook.
Kalios, une huile grecque familiale
Passionné de cuisine, Pierre-Julien Chantzios s’engage avec son frère Grégory en 2010 dans l’aventure de l’huile d’olive, reprenant le flambeau de leurs parents, décidant de distribuer l’huile d’olive grecque familiale aux restaurateurs franciliens. Ils partent alors sillonner la capitale en scooter après la récolte, pour faire goûter leur huile aux chefs et racontent l’aventure familiale. En deux mois, ils écoulent 30 bidons de 5 litres, 18 pots de pâte d’olive et 12 pots d’olives de 2 kilos. Ils séduisent de grandes maisons comme Le Mandarin Oriental, Thoumieux, Rostang, Gagnaire, 39 V, Colliot, la Cantine du Troquet. Aujourd’hui, ce sont plus d’une centaine de restaurants qui achètent leur huile. Pour Pierre-Julien Chantzios, la qualité doit être privilégiée par rapport au prix, qui demeure le cheval de bataille de la grande distribution.
Matahi, une start-up innovante du secteur
Pour Raphaël Gorardin et Alexandre Giora, fondateurs de Matahi, la clef du succès réside dans le lancement de produits innovants, qui ont toutes les chances de damer le pion à des produits présentés comme démodés. C’est pourquoi ils ont lancé une nouvelle boisson énergisante, contenant de l’eau, de la pulpe de fruit de baobab, du sucre de canne, de la caféine et de la vitamine C. Après avoir obtenu un référencement chez Colette, Eatme ou encore Causses, ils sont en pleine négociation avec une grande enseigne, visant un chiffre d’affaires de 1,3 millions d’euros en 2015.
Nomad Yo, une start-up dans le domaine du yaourt
Christophe Favot, ingénieur agronome et docteur en microbiologie, a décidé de surfer sur la tendance du « sans lait de vache » et du « sans gluten » dans le secteur des yaourts, en créant un produit à base de riz, de sarrasin et de millet, végétaux fermentés pour obtenir un produit crémeux. Loin d’une production industrielle massive, il mise tout sur une multiplication des petits ateliers, à proximité immédiate des points de vente, visant à terme une double centaine de « micro-yaourteries » réparties sur toute la France.