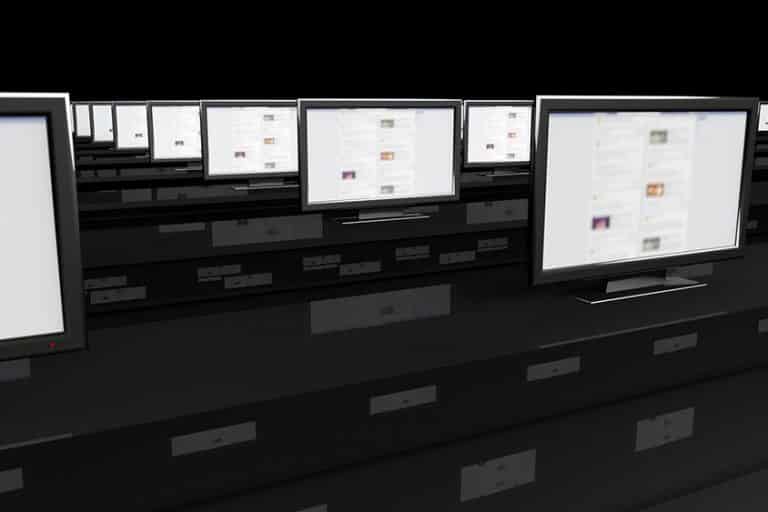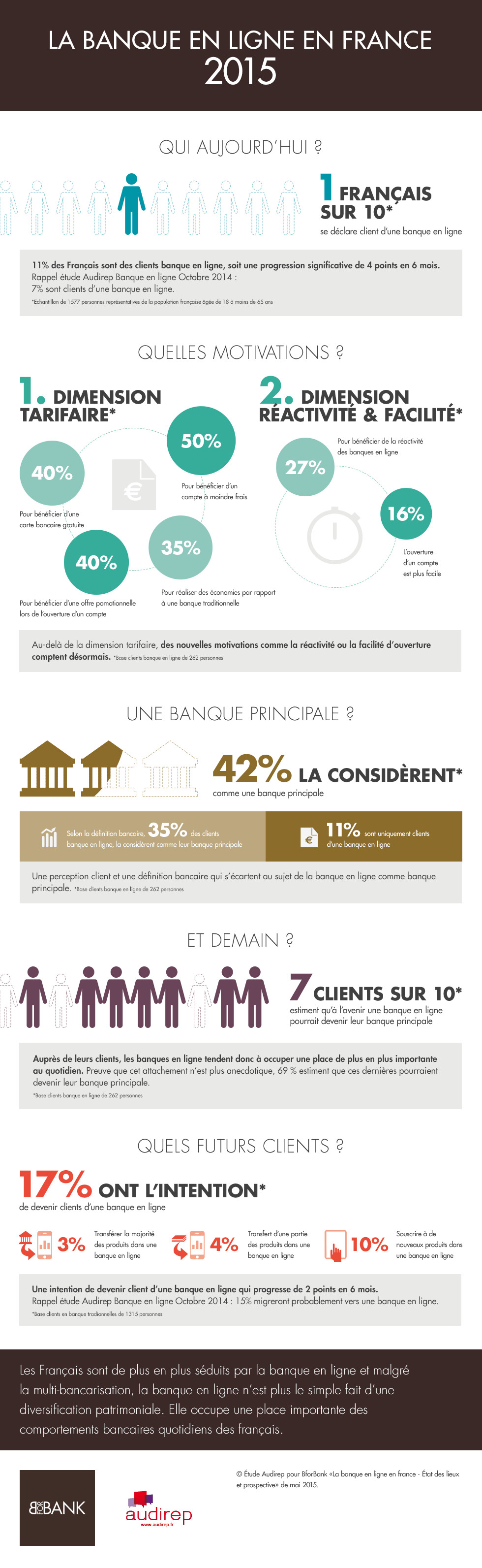Avec l’avènement des technologies du numérique et de l’information, de nombreuses start-up françaises et internationales développent des applications et des objets connectés insolites et innovants. Facilitant le quotidien des particuliers, ces objets connectés sont souvent originaux. Dotés de différentes applications destinées au grand public, ils permettent également aux start-up de financer des projets ambitieux.
Xiaomi et son purificateur d’eau connecté
Précurseur dans le domaine des smartphones, des bracelets connectés ou encore des baskets connectées, le géant Xiaomi va lancer prochainement un purificateur d’eau connecté ! La start-up chinoise créée en 2010, avec 7 500 salariés et 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires, veut en effet conquérir les marchés asiatiques et indiens avec un purificateur d’eau connecté au réseau électrique domestique, chargé de purifier l’eau et d’envoyer les données sur un terminal. Vendu au prix de 200 euros, l’appareil n’est pour l’instant pas destiné au marché européen.
Mother, le capteur polyvalent
Après Nabaztag, le lapin connecté qui renseignait les particuliers sur la météo et changeait de couleur à la réception d’un mail, l’inventeur indien Rafi Haladjian innove avec Mother. Cet objet numérique polyvalent permet alors de surveiller plusieurs activités via des capteurs appelés cookies. Vous pensez souffrir de troubles du sommeil ? Disposez un Motion Cookie sous votre matelas qui analysera votre repos nocturne. Vous n’êtes pas sûr de vous hydrater convenablement ? Placez un Motion Cookie sur votre bouteille d’eau et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin !
L’accessoire connecté par Sevenhugs
Sevenhugs, une start-up française, a levé près de 1,5 million d’euros pour concevoir des objets connectés inédits. Née en 2014, elle a alors conçu un accessoire qui analyse le sommeil de ses utilisateurs. Dans un souci de bien-être, l’appareil est également muni de capteurs multi-usages qui mesurent le taux d’humidité, la qualité de l’air ou encore les écarts de température dans chaque pièce.
Les lunettes ORA d’Optinvent
Autre start-up française innovante et basée à Rennes, Optinvent est déjà à l’origine des lunettes connectées ORA, qui souhaitent ni plus ni moins concurrencer Google et ses lunettes 3D connectées. Sa campagne a permis de récolter plus de 100 000 euros grâce aux lunettes connectées polyvalentes dédiées aux activités sportives, à la photo, aux vidéoconférences ou encore à la logistique.
Netatmo et son projet Welcome
Récompensée depuis 3 ans par le CES Innovations Design and Engineering Awards dans toutes les catégories, la start-up française Netatmo ne cesse d’innover depuis ses débuts. Lancée en 2011, la société vient de commercialiser son nouveau projet d’objet connecté : Welcome. Cette caméra unique en son genre possède une technologie de reconnaissance faciale et se connecte directement depuis un smartphone. Capable de reconnaître aussi bien les habitants d’une maison que les intrus, Welcome est compatible avec iOS et Android et est commercialisé au prix de 199 euros.
La Smart Helmet de LifeBEAM
La start-up israélienne LifeBEAM spécialisée dans les capteurs de haute technologie est soucieuse de la sécurité. Son casque connecté Smart Helmet est alors destiné aux cyclistes et sert à mesurer la fréquence cardiaque, la vitesse, ou encore le nombre de calories brûlées.
Entièrement compatible via les systèmes iOS et Android, le casque connecté est également compatible avec différentes applications sportives comme Runastic et Mapmyrun, qui permettent de retracer son parcours depuis un GPS et d’évaluer ses performances.