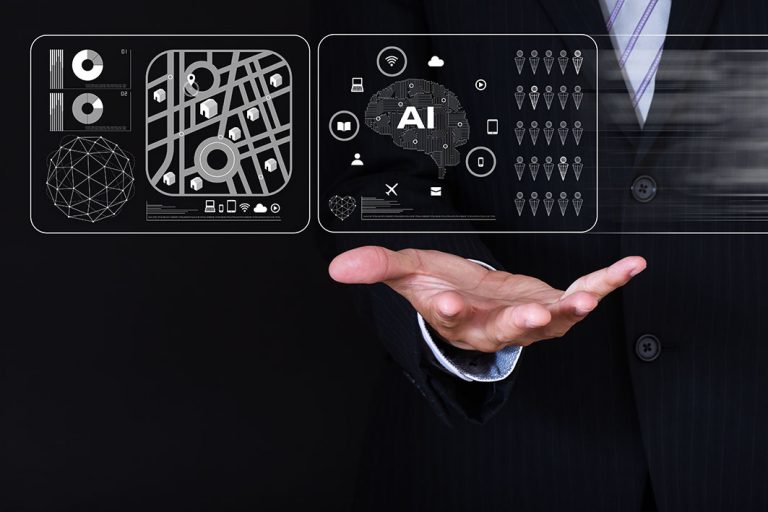Parce que l’essentiel du management repose sur le bonheur des salariés, les « petits plus » qui participent au bien-être et à la santé des salariés sont mis à l’honneur. De la simple corbeille de fruits aux ateliers détente, en passant par le recrutement d’un CHO (Chief Hapiness Officer), tous confèrent aux salariés de quoi se sentir bien.
Des ateliers de gestion du stress
Si le contexte du travail se révèle parfois source de stress pour les salariés, certaines activités sont propices à la détente et à la relaxation. Souvent mis en place au sein des entreprises où il fait bon vivre, des ateliers dits détentes sont proposés aux salariés au cours de leur journée de travail. Ceux de gestion du stress demeurent, sans doute, les plus fréquents au sein de ce type d’entreprises, à raison d’une fois par semaine en moyenne. Suivant cette même logique, des ateliers de yoga sont organisés. Par le biais d’une série d’exercices de respiration ou d’assouplissement, cette activité confère à la fois des bienfaits physiques (souplesse, renforcement de la musculature ou de la colonne vertébrale), psychologiques (gestion du stress, relaxation, concentration, amélioration de la qualité du sommeil) et spirituels (relaxer son mental, faire circuler l’énergie au niveau des chakras). Fort appréciés des salariés mais aussi du dirigeant, des ateliers de massages peuvent aussi être instaurés.
S’entretenir tout en restant au bureau
Mis à part les ateliers de gestion du stress, des aménagements spécifiques sont quelques fois établis au sein des entreprises. Pour entretenir son corps, se défouler, évacuer le stress ou tout simplement se vider la tête, mettre à disposition une salle de sport au bureau s’avère idéal. Avant ou après leur journée de travail, les salariés pourront venir en profiter à leur convenance, sans avoir à se déplacer ou à payer des prix trop élevés, appliqués dans des espaces dédiés, hors entreprise. Si faire du sport au bureau se présente comme une bonne idée, prévoir également une douche l’est davantage. Disposer de tels aménagements dans ses locaux procure à vos salariés le plaisir de pouvoir se doucher au bureau après avoir fait leur jogging pour y venir, et dans le cas où vous disposez d’une salle de sport, de se rafraîchir avant de reprendre le labeur, ou tout simplement après une dure journée de travail de se préparer pour aller à une soirée. Une raison de plus pour donner envie à vos salariés de passer du temps au travail.
Prendre soin de la santé de ses salariés
À la fois destinées au bien-être et à la santé de vos salariés, certaines idées peuvent être mises en œuvre. Pour manger ses cinq fruits et légumes par jour, quoi de mieux qu’offrir quotidiennement une corbeille de fruits à vos salariés. Ils pourront alors se servir à leur guise et seront davantage incités à consommer ces produits bons pour leur santé. Autre idée : les fontaines à eau. Plutôt que boire de l’eau du robinet, bénéficier d’eau filtrée, fraîche, tempérée ou chaude, reste un avantage non négligeable. Des boîtes de thé ou de tisanes seront tout autant appréciées, particulièrement en hiver. De temps à autre, faire venir un nutritionniste pour ceux qui le souhaitent peut également contribuer au fait de maintenir vos salariés en bonne santé en faisant attention à leur alimentation. Concernant le mobilier, des chaises confortables spécifiques les préserveront d’éventuels maux de dos liés à une mauvaise position. Bien entendu, tout ceci comporte un coût et il reste primordial d’évaluer en amont le budget dont vous disposez avant de vous lancer dans toutes sortes de frais.
Recruter un responsable du bonheur
Né dans la Silicon Valley, le métier de Chief Happiness Officer (CHO) ou Responsable du bonheur est de plus en plus présent au sein des entreprises françaises. Sa mission est simple : s’assurer que les salariés sont heureux ou du moins, qu’ils se sentent bien dans leur entreprise. Ce concept repose sur l’idée que les salariés heureux seraient plus impliqués et plus efficaces au travail. Le rôle principal d’un CHO demeure de réunir des conditions de travail où les salariés se sentent bien. Il peut s’agir de l’organisation d’évènements, d’assurer une communication interne claire et transparente, de trouver des solutions aux problèmes individuels ou de s’impliquer dans les évolutions de l’entreprise. Pour remplir cette fonction, optimisme, empathie, enthousiasme, humour et énergie constituent des qualités indispensables. Certaines entreprises seront tentées de renommer leur Responsable de communication interne ou leur DRH en CHO. Il s’agit de métiers très différents même si certaines réalités se recoupent. Le Responsable du bonheur doit s’attacher au bien être des salariés en premier lieu et doit, de préférence, être directement rattaché au dirigeant.