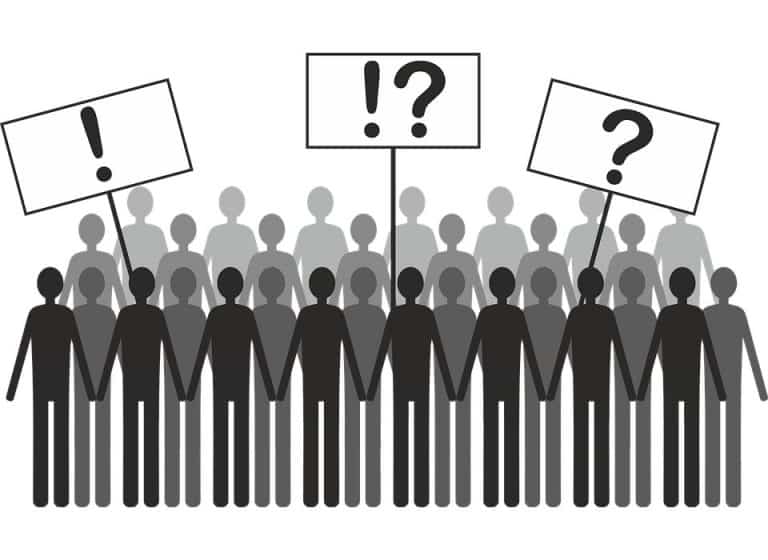Si les réseaux sociaux présentent de nombreux avantages, ces derniers impliquent néanmoins un certain nombre d’exigences à respecter. Des paramètres tels que le type de contenu, la fréquence de publication ou encore le choix de mots-clés se doivent d’être définis à l’avance. Parce que les réseaux se révèlent avant tout des médias, qui diffusent à large échelle, avant de se lancer, mieux vaut savoir les utiliser.
Pour bien comprendre l’intérêt de faire bon usage des réseaux sociaux, partons d’un exemple. Imaginez que l’un des grands titres de la presse politique quotidienne (peu importe son nom), publie un numéro sans respecter sa ligne éditoriale : le contenu mêlerait football, cuisine, mode…, rien à voir avec de la politique. Le journal paraît et les lecteurs fidèles se trouvent décontenancés par le contenu. Si ces derniers ont pour coutume d’acheter ou de s’abonner à ce quotidien et non à un autre, c’est parce qu’ils estiment qu’il correspond à leurs attentes. Ces lecteurs paient pour un contenu de nature politique ainsi que pour une publication journalière. Bouleverser le contenu sans avoir pris le soin de prévenir vos lecteurs, changer de rythme et passer d’un quotidien à un hebdomadaire risque de les détourner de votre journal. Ce cas de figure s’applique à vous et votre entreprise lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux. Vous ne détenez peut être pas de journal mais vous proposez un produit/service et revendiquez des valeurs ainsi qu’une ADN, qui forment votre image. Vos clients ou prospects s’attendent donc à retrouver, à travers vos publications, une certaine cohérence avec celle-ci. Autrement, ils pourraient se sentir trahis ou trompés et changer de page…
Définir sa ligne éditoriale
Qu’il s’agisse de la presse ou des médias sociaux, la ligne éditoriale indique l’orientation à suivre. Véritable fil conducteur, elle présente la manière dont l’on souhaite communiquer en précisant les règles à respecter pour l’ensemble des publications. Globalement, la ligne éditoriale définit le ou les thèmes à aborder en fonction de sa cible, le ton et le vocabulaire à employer, la fréquence de publication, les formats adaptés (textes, photos, vidéos ou liens),… Son objectif principal demeure de conférer à l’entreprise une forme de cohésion et de clarté dans la publication de ses contenus. Elle permet également d’acquérir une identité qui lui est propre et de fidéliser. Vous devez néanmoins garder à l’esprit que, pour chaque type de réseau utilisé, créer une ligne éditoriale unique demeure essentiel. Selon vos objectifs : développer votre notoriété, élargir sa base de données clients ou faire de nouveaux partenariats, par exemple, le choix de votre réseau et donc celui de votre ligne éditoriale varient. Pour trancher, il vous incombe de connaître vos priorités.
S’adapter à chaque type de réseau social
Pour savoir comment utiliser chaque réseau, commencer par identifier leur fonction fait partie des fondamentaux. Prenons l’exemple de Facebook, Twitter et Google+.
- Le premier, Facebook, se place plutôt comme un média de divertissement alliant humour et créativité. Les contenus publiés se doivent d’être relativement courts et concis. Si la promotion directe est à utiliser avec modération, les interactions avec sa communauté sous la forme de quizz, jeux ou questionnaires s’avèrent les bienvenus. En clair, faites-la participer ! Ce média social constitue également un bon moyen pour communiquer sur vos évènements ou sur ce que la presse dit sur vous. Rebondir sur l’actualité et proposer des conseils permet, dans le même temps, de se différencier de la concurrence.
- Du côté de celui au logo du petit oiseau bleu, on a tendance à le catégoriser comme un média d’information. À consonance plus sérieuse et professionnelle, notamment pour les entreprises, une URL renvoyant vers un article ainsi qu’un tweet accompagné d’une photo s’avèrent plus appropriés. Inutile de trop en faire, allez à l’essentiel ! Vous pouvez tout aussi bien rebondir sur l’actualité de façon générale ou celle de votre entreprise, retweeter, faire la promotion de vos produits/services, donner des conseils, offrir des réductions à vos followers,…
- Enfin, Google+, à mi-chemin entre l’information et le divertissement, regroupe humour, sérieux et discussion. Des images, infographies, liens ou vidéos informatives comme des tutoriels sont à privilégier. S’il n’est pas possible d’organiser des concours sur la plateforme (Google l’interdit, ndlr), poser des questions à sa communauté et susciter le débat est permis voire encouragé.
Ces plateformes étant complémentaires, sachez que vous pouvez très bien en utiliser plusieurs afin d’élargir votre diffusion et maximiser vos chances d’atteindre votre cible.
Proposer du contenu à forte valeur ajoutée
Comme on l’a déjà évoqué précédemment, les médias sociaux, dont le potentiel de diffusion se révèle considérable, peuvent toucher un grand nombre d’internautes. Retenez néanmoins ce point : ce n’est pas parce que vous disposez d’un site internet où vous y publiez régulièrement des contenus que vous devez impérativement tous les poster sur les réseaux, bien au contraire. Ceci pour deux raisons. Premièrement, publier l’intégralité des contenus parus sur son site web ne présente pas nécessairement d’intérêt, mieux vaut ne poster que ceux susceptibles d’avoir une longue portée. Secundo, dans le cas d’un réseau type Facebook, publier des articles ou autres n’ayant touché, au final, que peu de personnes engage des pénalités en termes de trafic. L’enjeu demeure de faire valoir uniquement les contenus à forte valeur ajoutée. S’il n’est pas toujours évident de les différencier des autres, comparer le nombre de vues ou partages qu’ils génèrent sur votre site constitue un bon indicateur.
De la justesse dans le choix des mots
Écrire sur le web et sur les réseaux implique de choisir les mots justes. On parle alors de « mots-clés ». Ces derniers renvoient aux mots ou expressions saisis par les internautes dans la barre d’un moteur de recherche comme Google. Plus vos contenus contiennent de mots-clés, plus vous optimiserez votre référencement naturel et génèrerez de trafic. Lorsque vous publiez un contenu sur un média social, privilégiez ainsi l’utilisation de mots-clés. Pour les dénicher, des outils tels que Google Trend permettent d’afficher les dernières tendances des internautes, notamment en ce qui concerne leurs thématiques de recherche. Autrement, il s’agit de se mettre à la place de votre cible et de se demander quels mots-clés elle taperait dans la barre de recherche pour trouver du contenu en lien avec le vôtre (et tomber par la suite sur celui-ci !).
Choisir LE bon moment pour publier
Publier du contenu au bon moment et sans trop en faire détient son importance. Pour s’assurer de l’impact de ses posts/tweets, nombreux sont ceux qui se demandent à quelle heure vaut-il mieux faire paraître un contenu sur un réseau social donné. En réalité, il n’existe pas de règle universelle mais plusieurs études ont été menées sur le sujet. Sous la forme d’une infographie, Hubspot (logiciel d’inbound marketing et de vente, ndlr) en compile une dizaine.
- Selon l’étude, mieux vaut publier, sur Facebook, entre 12 heures et 13 heures le weekend. Concernant les horaires de la semaine, si les lundis et mardis semblent à proscrire, les mercredis entre 15 heures et 16 heures ainsi que les jeudis et vendredis entre 13 heures et 16 heures, se révèleraient un bon timing.
- Pour Twitter, privilégié pendant les temps de pauses, les weekends ne semblent pas convenir alors que, du lundi au vendredi, entre 12 heures et 15 heures, l’impact serait important. Entre 17 heures et 18 heures le mercredi, notez qu’un pic de connexion aurait également lieu.
- À propos de LinkedIn, du mardi au jeudi, les périodes entre 7h30 et 8h30, les pauses déjeuners ou les fins de journée vers 17 heures, seraient propices.
- En ce qui concerne Pinterest, que l’on soit en semaine ou en weekend, l’idéal serait de poster la nuit, entre deux heures et quatre heures du matin (des outils permettent toutefois de programmer à l’avance les épingles) ! Après le travail, l’infographie présente néanmoins un pic de 20 heures à 23 heures.
- Du côté d’Instagram, les connexions seraient plus régulières : toute la journée du lundi au jeudi, sauf de 15 heures à 16 heures.
Notez que cette infographie est à suivre dans le cas où votre cible s’avère grand public et ne fonctionnera pas forcément si vous vous adressez à des étudiants, freelances, femmes au foyer,… Pour vous assurer de l’efficacité de vos posts/tweets, faites des tests en publiant à des heures et jours différents un même type de contenu. Grâce à des outils statistiques, mesurez-en ensuite l’impact par rapport au timing choisi afin de trouver les horaires pour lesquels votre cible sera susceptible d’être le plus connectée et augmenter votre visibilité.
À chacun son rythme… ?
La fréquence de publication sur les réseaux sociaux fait partie des paramètres à prendre en compte et varie en fonction du type de média visé. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que la « durée de vie » d’une publication n’est pas la même selon le réseau choisi. N’abusez pas non plus des publications, au risque de vous faire pénaliser par les plateformes en question. À titre d’illustration, pour Twitter, dont l’instantanéité reste le maître-mot, la durée d’un tweet se révèle d’environ quatre heures. En ce sens, publier environ une dizaine de tweets par jour semble judicieux. Pour le réseau professionnel LinkedIn, elle s’étend sur douze heures : poster son contenu le matin s’avère fortement conseillé. Facebook, quant à lui, détient l’avantage de pouvoir rallonger la durée de vie d’une publication, qui peut ainsi continuer de paraître quatorze heures après avoir été postée. Un voire deux posts quotidien(s) constitue(nt) une bonne moyenne pour ce réseau. La plateforme YouTube est toutefois à placer dans les cas particuliers : la durée de vie des publications parues sur celle-ci dépend essentiellement de la manière dont elles ont été promues par les autres réseaux comme Facebook ou Twitter. Respecter les critères liés à la fréquence de publication permet de rapporter un maximum d’engagements (propension d’un consommateur ou internaute à interagir avec une marque ou une entreprise, ndlr).
L’achat de bannières publicitaires et de fans, quel intérêt ?
S’enquérir de bannières (ou espaces publicitaires) sur les réseaux sociaux peut s’avérer une bonne idée pour faire connaître un nouveau produit / service, une nouvelle offre ou réaliser une campagne de pub. Deux conditions entrent toutefois en ligne de compte : un budget plus ou moins conséquent et surtout, choisir les bons médias de diffusion. Rien ne sert de payer le prix fort pour afficher une publicité sur un réseau qui n’intéresse pas votre cible. Une fois le réseau cerné, vous pouvez vous aider d’outils tels que Google AdWords pour créer vos propres annonces. Ce programme de publicité en ligne de Google présente l’avantage de lier vos annonces aux mots-clés utilisés dans les requêtes. Pour calculer le coût que cela représente, il faut prendre en considération des critères tels que le nombre de fois où la bannière sera affichée, le temps passé sur le site, le nombre de clics ou la nature de la cible. Autre possibilité : acheter de « faux likes » ou fans sur Facebook, des tweets sur Twitter, des vues sur YouTube,… Certes, cela permet d’augmenter son trafic mais l’intérêt demeure de toucher sa cible afin d’acquérir des prospects qualifiés. Avoir 10 000 fans mais aucun intéressé par son produit ou service ne sert, finalement, pas à grand-chose… L’engagement des fans compte avant tout.