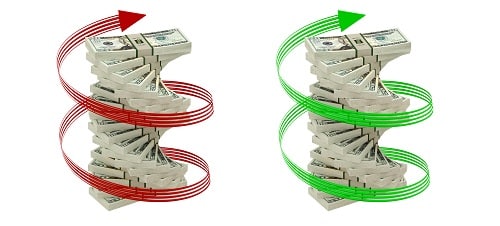Les principes du développement durable prennent une place de plus en plus importante dans la stratégie des entreprises, que ce soit d’ailleurs par simple opportunisme ou par conviction profonde d’une nécessité de changer nos modes de production et de consommation. Dans ce premier article consacré à la notion de d’écoconception, nous allons voir de quoi il en retourne réellement et quels peuvent être ses principaux avantages.
Mais qu’entend-on par écoconception ?
L’écoconception vise à prendre en compte les impacts environnementaux d’un produit tout au long des étapes de son cycle de vie, du « berceau à la tombe », depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination des déchets, en intégrant l’ensemble des parties prenantes concernées dans le cycle du produit. Selon la norme iso 14006, l’écoconception est une démarche qui vise à l’intégrer l’environnement dans la conception du produit avec une vision sur l’ensemble du cycle de vie. Pratiquement, « Il s’agit d’une démarche d’ouverture à 360 degrés qui permet de faire les choix les moins nocifs pour l’environnement en identifiant les principaux impacts » comme le précise très bien Philippe Schiesser du cabinet Ecoeff, spécialisé en écoconception.
Une démarche globale et complexe à première vue !….Allons donc voir de plus près ce qui pousse ces entreprises à aller dans ce sens…
Des moteurs de motivation diverses et variés
Le contexte actuel est en tout premier lieu très incitatif ; d’après l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), environ 70% de la contribution des ménages français à l’effet de serre sont imputables aux produits que nous consommons. Produire et consommer des produits à moindre impact sur l’environnement constitue donc un enjeu primordial. Du point de vue des consommateurs, les écolabels, l’étiquette-énergie, et bientôt, l’affichage environnemental sur les produits de grande consommation, sont là pour éclairer leurs choix et les orienter dans la voie d’une consommation plus responsable. L’Union Européenne veut d’ailleurs promouvoir la qualité écologique des produits, des textes existent déjà dans ce sens (la PIP, politique Intégrée des Produits, est une politique européenne visant à faciliter le développement du marché des produits écologiques, etc.), d’autres sont à l’étude… et engager une démarche d’écoconception permet quelque part d’anticiper ce déluge de textes réglementaires à venir…
Prenons notamment l’exemple des produits électriques et électroniques, la directive ERP (Energy Related Product), dont on attend la prochaine version fixe notamment un cadre en la matière sur les produits consommateurs d’énergie : elle fixera des normes de consommation électrique mais définira aussi certainement les contraintes écologiques du produit tout au long de son cycle de vie…
L’application du principe pollueur payeur dès la conception du produit à travers la mise en place de la REP (Responsabilité Elargie du Producteur qui vise à rendre le fabricant responsable de l’élimination du déchet issu de son produit en fin de vie) est sans conteste aussi un levier incitatif qui va pousser les entreprises à aller vers la conception de produits écologiques et donc vers l’écoconception.
De plus, il est aujourd’hui capital de travailler sur les enjeux environnementaux importants pour répondre au défi du développement durable : pour ne pas rentrer dans un discours hypocrite et mensonger, il est donc de plus en plus urgent d’avoir des méthodes fiables capables d’identifier où nous devons axer nos efforts. D’ailleurs, pour se prémunir des dérives de greenwashing et répondre aux attentes d’une société aux aguets sur les problématiques de développement durable, un reporting RSE solide et crédible est exigé désormais des grosses PME (plus de 500 employés) : cette exigence va sans nul doute accélérer le mouvement de ces démarches d’écoconception basées sur des indicateurs de performance fiables et précis, et pourvoyeuses de plus de transparence avec les parties prenantes.
Néanmoins, les leviers réglementaires ne sont pas les seuls à inciter l’entreprise à se lancer dans une démarche d’écoconception : selon une étude de 2008 du Pôle Ecoconception de la CCI de Saint-Etienne, la politique volontariste de l’entreprise convaincue du bien–fondé d’une démarche RSE est la première source de motivation, loin devant la réglementation et les attentes du marché. La réduction des coûts dans une logique d’optimisation des process est bien aussi souvent un des moteurs du lancement de la démarche. Et comme le souligne Philippe Schiesser, « Bien souvent, même en B to C, l’entreprise ne s’engage pas forcément dans une démarche d’écoconception pour communiquer ou simplement bénéficier d’un avantage marketing différencient, elle pilote plutôt sa démarche par des changements technologiques, une entrées stratégique, de l’ingénierie ou bien encore dans une logique d’innovation ». En effet, il faut savoir que 53 % des brevets déposés sont liés à des écotechnologies.
Il est vrai que la période de crise ralentit aujourd’hui les démarches d’écoconception qui demandent des compétences et capacités internes importantes : de plus, l’écoconception étant souvent portée par les sous-traitants, la crise a réduit drastiquement les budgets de R&D nécessaires à cette démarche d’innovation.
L’innovation, maître mot de l’écoconception ? Allons creuser le sujet…
Une réelle façon d’innover
Il faut savoir que les démarches d’écoconception ont été initiées dans les années 90 par des analystes qui cherchaient avant tout à diminuer les impacts environnementaux du cycle de vie du produit via une analyse environnementale poussée : mais à l’époque, ces démarches d’écoconception, déconnectées du business de l’entreprise et concernant quelques experts seulement, ne parlaient pas forcément aux entreprises portées avant tout par la création de valeur ajoutée pour le client : depuis quelques années, cette approche s’est heureusement démocratisée pour renforcer le lien avec le business en intégrant l’environnement dans le développement du produit impactant ainsi l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Aujourd’hui, de plus en plus de démarches d’écoconception amènent les entreprises à éco-innover, l’environnement devenant alors le levier pour créer de nouvelles fonctionnalités pour le client : en plaçant le bénéfice client au cœur de la démarche et l’éco-innovation au cœur de leur stratégie,les entreprises peuvent même aller jusqu’à remettre en cause leur business model où l’environnement devient une source de nouvelle valeur ajoutée et de créativité , et non pas relégué au seul statut de réduction d’impacts . Citons pour preuve le cas de l’entreprise Notox qui a développé des planches de surf éco-conçues à base de fibres de lin qu’elle parvient à vendre plus chère compte tenu des performances techniques supérieures qu’elles apportent au client.
En gros, dans le premier cas, l’entreprise fait une analyse environnementale classique sur le cycle de vie et diminue ses impacts en veillant bien à ne pas créer de transferts de pollution. « Elle fait la même chose avec moins tous simplement », comme l’explique très bien Samuel Mayer du Pôle Ecoconception de la CCI de Saint-Etienne.
Dans l’autre cas, elle ne se focalise pas sur des réductions d’impacts mais part de l’amélioration fonctionnelle du produit, et Samuel Mayer conclue dans ce cas « l’entreprise fait autrement, et l’environnement lui permet d’innover ».
Pour exemple, la société Malongo, leader historique du café issu du Commerce équitable pour la France a su parfaitement utiliser la démarche d’éco-innovation pour répondre aux attentes des clients et parler au consommateur autrement. Malongo a inventé la machine Ek’oh, une machine expresso conçue pour durer, utilisant des matériaux high-tech. Ek’Oh c’est aussi un ensemble de modules assemblés par clips, facilement démontables et remplaçables, une machine éthique et fabriquée en France, argument auquel sont sensibles les consommateurs. Ek’Oh propose une crème encore plus onctueuse et savoureuse pour les papilles des consommateurs ! Cette machine est le fruit du travail main dans la main de plusieurs savoir-faire de pointe français, avec un SAV total en plus proposé aux clients. Bref, un produit innovant et éco conçu qui apporte une réelle valeur ajoutée au client.
La suite dans un prochain article, consacré cette fois à la mise en place et la stratégie !