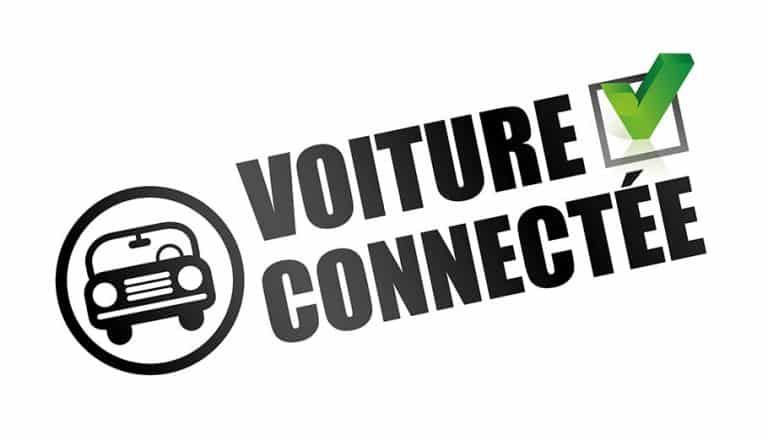La sécurité d’un système ou d’une application est encore, en 2016, négligée par de trop nombreuses entreprises. Ce manque d’attention, cette négligence plus exactement, peut être à l’origine de sévères déconvenues allant de l’indisponibilité d’un site internet au vol de données en passant par l’installation au sein de votre système de scripts permettant à des hackers d’intercepter les données envoyées par des visiteurs, qui sont aussi souvent des clients ! Cette dernière pratique est particulièrement pernicieuse puisqu’elle est « invisible »: le fonctionnement du site n’est pas affecté et la détection du problème peut intervenir plusieurs semaines après son début !
Pensez la sécurité de votre application avant son lancement
La sécurité d’une application ou d’un système doit être pensée avant même le lancement d’un site internet. Le choix de l’architecture et des moyens pour le sécuriser doivent être tout autant pris en compte que le service qu’offrira le site internet.
Une fois le système choisi, sa configuration est tout aussi essentielle. Une erreur fréquente est par exemple d’installer un système d’exploitation et de laisser actifs des services inutiles. Ces services pourront être utilisés par des pirates pour s’introduire dans votre système. Un autre exemple d’erreur fréquente est de laisser des ports ouverts (qui permettent au serveur de communiquer avec le réseau) alors qu’ils ne sont pas utilisés par l’application ou le système. Les logiciels malveillants apprécient particulièrement ces portes pour entrer en toute discrétion puisqu’elles ne sont pas utilisées et souvent pas surveillées.
La sécurité doit rester une priorité tout au long de l’existence de votre site
Une fois l’installation et la configuration du serveur effectuées, la sécurité doit rester un élément prioritaire. Le système d’exploitation choisi et l’application installée (qui peut être par exemple Prestashop, WordPress, Joomla) vont être de moins en moins sécurisés avec le temps.
Les systèmes et les applications sont effet, malgré la grande attention apportée par les développeurs, sujets à des bugs ou pire encore à des failles de sécurité. Ces failles sont heureusement très rapidement identifiées et sont tout aussi rapidement corrigées.
Les auteurs de logiciels malveillants suivent de très près ces corrections et développent leurs logiciels en s’appuyant sur ces failles. Après avoir écrit un logiciel malveillant, le pirate cherche, par l’intermédiaire de robots, des systèmes ou des applications qui n’ont pas encore été mis à jour. Pour ne pas laisser la porte ouverte à ces logiciels, il faut maintenir en permanence son système et son application à jour !
Par méconnaissance, de nombreux propriétaires de sites préfèrent conserver des systèmes d’exploitation et des applications dans le même état qu’après leurs installations en pensant qu’une mise à jour ne peut rien apporter à l’exception de problèmes de compatibilité. Cette devise met donc en péril la sécurité d’un site internet et n’est plus aujourd’hui aussi vraie que par le passé. La compatibilité entre versions est devenue centrale pour les développeurs. De plus, si une modification est à effectuer pour rétablir le fonctionnement d’une application, dans la majorité des cas, cette modification permet de résoudre un problème majeur de sécurité ou de performance.
L’infogérance pour déléguer les mises à jour système
Amen vous permet de déléguer la sécurité système de votre serveur à des experts grâce à l’infogérance ou service de serveurs gérés. Vous pouvez dès la création de votre projet faire appel à l’un de nos conseillers pour choisir l’infrastructure idéale à mettre en place.
Une fois ce choix effectué, nos experts vont installer et configurer votre système. Comme vu précédemment, la configuration d’un serveur est un élément clé pour la sécurité d’un serveur.
De plus, nos experts prendront également en charge la mise à jour de votre système.
L’infogérance vous apportera également d’autres services comme l’installation de l’outil Plesk. Ce logiciel permet de gérer un serveur et ses sites internet avec une interface graphique. Le serveur infogéré bénéficie aussi d’une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.