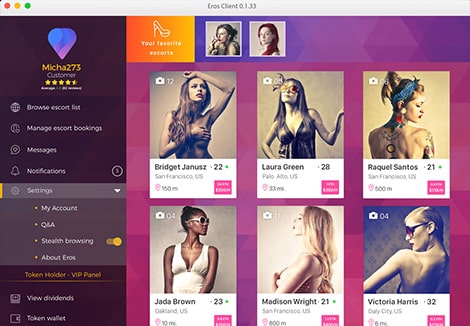Aujourd’hui, de plus en plus de Français travaillent à leur propre compte et à domicile. Organiser son bureau cà domicile demande méthode, rigueur et discipline. Pour travailler en toute tranquillité mais rester efficace, il faut instaurer quelques règles simples dans son quotidien. Voici quelques conseils utiles pour organiser son espace de travail.
Délimiter votre espace de travail
Il ne semble pas toujours facile de concilier vie professionnelle et vie de famille. Que vous habitiez dans une maison ou dans un appartement, vous devez créer un cadre totalement consacré à votre travail, cela vous permettra s’exposer vos produits sans nuire à la décoration de la maison. Pour cela, deux solutions s’offrent à vous: soit vous optez pour une pièce exclusivement dédiée à votre activité, soit vous optez pour un pan de mur si vous ne disposez pas de l’espace suffisant.
Si vous travaillez avec un collaborateur, préférez un agencement de vos bureaux bien distinct, plutôt qu’un agencement côte à côte, ce qui permettra d’avoir chacun votre espace. La délimitation de l’espace professionnel de celui personnel est primordiale, cela favorisera votre efficacité, mais surtout vous permettra de bien définir votre temps de travail. Chose moins évidente, si vous le faites sur votre canapé où vous serez distrait par de multiples façons et par conséquent vous ne serez pas dans une optique de bureau.
Délimiter votre temps de travail
De la même façon qu’il faille délimiter son espace, aménager ses horaires est aussi très important. Pour cela, la meilleure solution est de commencer vers 9 heures comme la plupart des entreprises, cela vous oblige à avoir un vrai rythme et à vous préparer en temps et en heure pour commencer à travailler toujours à la même heure. Cela permet une vraie discipline qui structurera vos heures de travail et permettra de délimiter votre vie professionnelle de votre vie personnelle. Il est important de vous octroyer une heure de déjeuner comme si vous étiez en entreprise, cela permet au cerveau de faire une pause pour être efficace l’après-midi et pouvoir prendre de la hauteur sur vos projets en cours.
Aménager un espace de travail convivial
En plus d’être bien aéré, votre bureau doit comporter au moins une fenêtre (une source de lumière extérieure est préférable pour le moral.) Vous devrez ensuite équiper votre espace professionnel avec du mobilier et des outils de base à savoir (un bon siège, un bureau, un ordinateur, une imprimante et une bonne connexion internet.) L’essentiel, c’est de vous sentir à l’aise dans votre espace de travail. En ce qui concerne votre ordinateur, il devra avoir un usage purement professionnel et non familial. L’éclairage de votre bureau est aussi une chose capitale à ne pas négliger. Un mauvais éclairage peut nuire à votre santé en provoquant fatigue, maux de tête et irritation oculaire.
Mettre en place un système de classement des documents
Le côté administratif de votre métier générera de la paperasse. Si vous n’y mettez pas de l’ordre, vous risquez d’être rapidement submergé. Une mauvaise gestion des documents administratifs entraîne souvent une perte de temps et d’argent (à titre s’exemple, il serait dommage d’être pénalisé pour un retard de paiement de facture.) Il est donc important de mettre en place un système de classement de vos documents.
Investir dans des fournitures de bureau
Pour avoir un vrai espace professionnel, il ne faut rien négliger. Achetez tout ce qu’il vous sera utile à votre activité (tout ce dont vous aurez besoin pour vos factures, devis et lettres.) Investissez aussi dans des fournitures un peu plus basiques (agrafeuse, stylo, crayon, bloc-notes et une clé USB professionnelle.)
Installer une ligne téléphonique pour votre activité
Imaginez que votre enfant décroche l’appel d’un client, cela peut se révéler plutôt contrariant. C’est pourquoi, il est recommandé d’installer une ligne téléphonique dédiée uniquement à son activité. Par exemple, vous pouvez opter pour un abonnement qui permet de recourir à un répondeur téléphonique et l’affichage du nom de l’appelant afin de mieux filtrer les appels.
Avoir un espace de réunion pour vos clients (facultatif)
Dans le cas où vous avez opté pour une pièce spécialement dédiée à votre activité, pensez à un inclure quelques fauteuils et une table basse qui feront office d’espace de réunions, dans le cas où vous faites venir vos clients chez vous. Préférez une pièce un peu en retrait du reste de votre maison afin que vos clients n’entrent pas dans votre sphère privée.
Organiser votre travail
Lorsqu’on travaille tout seul de chez soi, on a tendance à se laisser envahir par de multiples distractions. Vous devez donc adopter une méthode de travail qui vous permettra de vaincre l’oisiveté et vous devrez faire preuve de rigueur et d’organisation. Faites un planning de toutes les tâches que vous devez réaliser au cours de la semaine. Ainsi, vous n’aurez pas de difficulté à faire face aux exigences de votre métier et cela vous donnera l’impression d’avancer et de ne pas ressentir un sentiment d’inutilité commun aux activités de télétravail.
Ne pas repousser vos tâches professionnelles
Comme mentionné ci-dessus, l’entrepreneur à domicile sera distrait de diverses manières. Les raisons seront multiples (fatigue, envie de faire une activité plus attrayante…), mais il ne faut surtout pas repousser au lendemain, ce que l’on peut faire le jour même car on ne sait jamais de quoi demain est fait et du jour au lendemain vous pourrez passer du simple au double de travail. Mieux vaut anticiper !
Sortir de chez vous dans la journée
Afin de ne pas vivre en vieux loup solitaire, il est primordial de vous astreindre à une promenade journalière, le mieux serait à l’heure du déjeuner pour couper votre journée en deux et vous octroyer une pause. Vous pouvez en profiter pour voir du monde et vous aérer l’esprit. Cela vous permettra de faire le vide et d’entamer une après- midi en toute productivité.