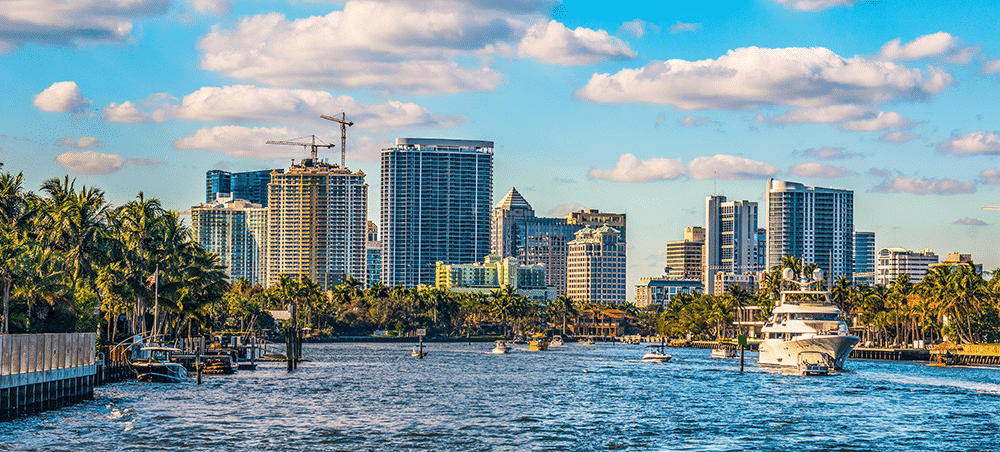A la veille de Noël, on peut se demander quelles sont les tendances des français en termes d’achats de Noël. Un récent sondage OpinionWay pour Rakuten réalisé auprès d’un échantillon de 1003 Français âgés de 18 ans et plus, nous en dit plus notamment sur les habitudes de revente des cadeaux.
L’achat en magasin domine toujours.
Premier constat : l’achat continue de se faire majoritairement en magasin avec 34% des sondés contre 20% sur Internet essentiellement. Cette dernière part est plus élevée de 11% chez les 18-24 ans alors que l’achat en magasin atteint 48% chez les 65 ans et plus. Les habitudes ont donc une influence sur la manière d’acheter les cadeaux. A noter tout de même que l’utilisation des deux canaux restent le schéma de prédilection. 44% déclare d’ailleurs le faire autant en magasin que sur internet.
Les motifs de la revente de cadeaux de noël
Ce n’est pas une grande surprise de voir que le premier motif de revente d’un cadeau est qu’il ne plaît pas pour 45% des sondés et qu’il manque d’utilité pour 39%. Suit juste après le fait que les personnes préfèrent le revendre plutôt que de le jeter (26%). Le manque de coordination dans l’achat de cadeaux entre les différents acheteurs entraîne aussi la revente. 23% déclare ainsi revendre car ils ont reçu deux fois le même cadeau. D’autres raisons externes comme le besoin d’argent (14%) ou le fait de s’acheter ce qui fait vraiment plaisir (14%) clôture les motifs de revente.
Les moyens de revente des cadeaux de Noël
Il est clair que la revente par internet domine. En effet, 49% des sondés passeraient par un site de petites annonces du type le Bon coin et 19% par des sites dédiés comme Rakuten ou Amazon. Les anciennes méthodes comme la mise en vente dans des brocantes / au marché aux puces, la revente à des personnes de l’entourage ou encore le fait de passer de vendre dans des boutiques physiques de type Cash Converters arrivent loin derrière avec 10% pour chaque méthode.
Les freins à la vente de cadeau de Noël
Si les gens hésitent encore à revendre leur cadeau de noël, c’est avant tout pour des questions de scrupules (42%) ou encore qu’ils préfèrent le donner plutôt que le vendre (35%). D’autres freins comme l’apparente difficulté (20%) ou encore l’oubli (15%) et la perte de temps (12%) clôture cette liste. Ceci pourrait constituer une idée de service pour les entrepreneurs qui souhaitent diminuer les freins à la revente ou une piste d’amélioration pour les différentes méthodes de revente.
Les Français plus compréhensifs qu’on ne le pense
Il est tout de même à noter que 30% des français comprendraient que l’on revende leur cadeau. 6% seraient même amusés. Attention tout de même car 19% se déclarent vexés voire tristes (16%) dans le cas où ils apprendraient que vous revendez leur cadeau alors que 12% seraient surpris. Il ne faut donc pas trop se vanter de vendre les cadeaux reçus. A noter que 49% des Français préfèrent les stocker quelque part chez eux plutôt que de les revendre. 31% préfèrent les donner à des gens qui en ont l’utilité et 22% à des associations. Fait amusant 8% d’entre eux attendent le Noël suivant pour les offrir à quelqu’un d’autre.