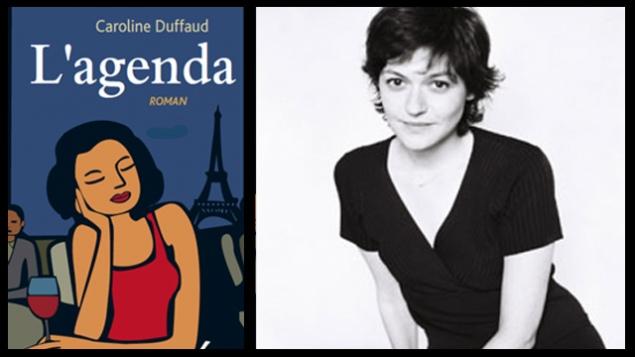Interview de Gaï Assouline. Après deux années d’études d’économie à l’université de Tolbiac, il entre à l’ESJ, l’école Supérieure de Journalisme. Il travaille ensuite dans la production cinématographique et télévisionelle et produit un certain nombre d’émissions pour Paris première. De fil en aiguille, il va passer de directeur de production à directeur de l’agence. Cependant, les challenges le poussent à créer, il y a 6 ans, Idé Prod, qui produit du spectacle vivant, de la publicité et des courts métrages deviendra l’Agence Divine, spécialisée dans la publicité.
Pouvez vous nous parler de votre activité. Avec quel type de clients travaillez-vous ?
Je travaille avec deux types de clients. De très grandes entreprises en tant que producteur, dont le plus important est le fabriquant de cigarettes Winston, du groupe GTI, mais également pour le Crédit Agricole, le groupe Accord, Sofitel, ainsi que Kawasaki, Nike et Lipton. Et à coté d’elles, j’ai aussi de très petits clients pour lesquels l’Agence Divine assure essentiellement la partie création comme les métiers du théâtre. Ce sont donc de très petits budgets avec lesquels nous essayons de faire des miracles, de les faire émerger du paysage de la communication. J’ai aussi un client appelé Skaaz, appartenant à la structure Virtuooz dont nous avons fait la publicité. Avec eux nous avons tout pris en charge, de la création à la diffusion, avec M6.
Pour les néophytes, en quoi consiste le marketing viral ?
Le marketing Viral consiste à faire en sorte que l’internaute soit le vecteur de communication de la publicité et non le média en lui-même. Ce n’est pas une chaîne de télé qui diffusera votre publicité, ce n’est pas une radio ni une bannière web mais ce sera l’internaute. Donc on glisse du média traditionnel à ce qu’on appelle le « 5e pouvoir » ; c’est à dire le pouvoir de l’internaute. Le marketing viral sert à développer une forme de communication qui soit transmise, comme un virus, c’est à dire en cascade. On part d’une dizaine ou centaine de personnes, et cette centaine de personnes se transforme en 200. Puis cela devient exponentiel comme un virus, la communication se développe, grâce à l’internaute.
Est-ce que c’est une publicité cachée aux internautes ?
Il existe deux types de marketing viral : une communication en Buzz qui consiste à laisser croire quelque chose dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants et le marketing viral de base qui consiste juste à laisser se propager un film ou une blague qui soit un peu décalé, que les gens se transmettent entre eux, et de fil en aiguille, cela devient une communication de masse.
Quels sont les facteurs pour que cela plaise ?
Le principal facteur, c’est l’humour, c’est toujours l’humour qui prédomine. C’est l’un des vecteurs principaux de communication. En fait, l’idée c’est de se démarquer de toutes les censures télévisuelles des grands médias. Le marketing viral aujourd’hui, c’est l’ anti-censure. Il faut absolument être décalé, choquant, pousser les curseurs de l’humour très très loin. Alors qu’en télé on met beaucoup de gants, il faut rester dans le consensus et toucher en un instant le plus grand nombre de personnes. Dans le marketing viral, c’est l’inverse, il ne faut surtout pas être consensuel sinon cela ne marche pas. Les gens ne voient pas l’intérêt d’envoyer une publicité à leurs contacts, qu’on pourrait voir à la télévision. Il faut qu’ils puissent s’identifier à elle, que ce soit du rire, une émotion. A partir de là seulement l’acte de transmettre la publicité peut se faire.
Il y a encore des tabous ?
Je pense que la pédophilie est un gros tabou. Mais c’est un tabou légitime. C’est normal. Je pense que les tabous ont presque tous sauté aujourd’hui.
On prétend souvent que le marketing viral est la publicité des pauvres. Aujourd’hui, même les plus grandes entreprises y ont recours. Quelle est votre opinion sur ce point ?
Pour moi, il n’existe pas de publicité de pauvre ou de riche, il y a le meilleur moyen pour toucher sa cible. La communication c’est l’art de toucher sa cible. Les très grosses structures ont de plus en plus de mal à toucher leur cible et s’aperçoivent qu’une partie de leur cible leur échappe c’est à dire les jeunes internautes, à savoir les 15-25 ans, se détournent de la télévision : le temps passé devant leur ordinateur a dépassé celui passé devant leur télévision. Ce n’était jamais arrivé et cela ne devrait pas s’arrêter. Or, sur internet, on ne communique pas de la même manière que sur un spot télé. Elles sont donc obligées d’utiliser les même moyens que tous les petits annonceurs qui ont compris cela depuis longtemps et qui ont tout de suite identifié leur cible.
Beaucoup de gens en ont assez de la publicité, saturent, comment est ce qu’on peut les toucher ?
Avant il y avait 6 médias. Mais il y a eu une explosion de l’espace communicationnel. Avec internet, de nouvelles chaînes sont apparues, l’espace s’est complètement dilaté, comme un élastique et du coup, on s’aperçoit de plus en plus qu’on à du mal à toucher les gens. C’est un grand écart, parce qu’aujourd’hui pour aller toucher les gens et bien il faut aller les toucher en vrai. La solution alternative c’est le hors média. C’est aller à la rencontre des gens pour communiquer sur le produit. Aujourd’hui, vous avez un groupe de rock, qui a mis des codes barre sur leurs affiches placées sur des feux rouges. Si tu photographies le stickers et l’envoies par texto, et bien en retour tu reçois la vidéo du groupe de rock. Cette communication touche les gens à la source.
Le marketing viral ne sert-il qu’à toucher que des marchés de niche ?
Les grands annonceurs ont l’impression de perdre du temps à faire du marketing viral parce qu’ils ne savent pas qui a vu la publicité. Ils n’ont aucun outil d’analyse. Le seul outil qu’ils possèdent c’est le nombre de cliques sur leur site. Mais en dehors de ça on ne sait pas qui est venu ni par qui s’est passé. Donc, il est très difficile de maîtriser une campagne de marketing viral. Cependant, le rapport entre le coût et le bénéfice en terme de connexions est plus intéressant sur du viral que sur du non viral. Fort de cette efficacité, les petits annonceurs l’utilisent allégrement ; les petits annonceurs nichés. C’est une chance d’être niché car on sait précisément qui on veut toucher. Une bouteille de lait on peut la vendre à des jeunes, des vieux, des gens qui ont des chats etc.
mais si on vend des skateboards on sait à qui on s’adresse. A priori les personnes âgées ne sont pas consommatrices etc. La cible va donc des 14 à 18 ans essentiellement. On sait où ils sont, on sait où les toucher.
Quel est l’avantage de travailler également dans la production ?
L’avantage c’est de maîtriser toute la chaîne de conception de la campagne média, de la création à la diffusion en passant par la production, de limiter les interlocuteurs pour être beaucoup plus efficace, de diminuer les coûts pour l’annonceur.
Quelles sont les étapes de la réalisation d’une publicité ?
C’est déjà de comprendre la problématique de notre client. L’annonceur vient vous voir pour toucher une cible. Il faut donc s’imprégner du domaine de l’annonceur que souvent l’on ne maîtrise pas. Par exemple, en ce moment on communique pour une société qui fait du Web, et je ne connaissais pas ce qu’était un agent conversationnel (avatar, ndlr).
Pour comprendre la problématique, il faut cerner le marché. Pour cerner le marché il faut l’analyser, regarder comment les concurrents communiquent. Qu’est-ce qui est bon en matière de communication ? Est-ce que les concurrents arrivent à communiquer, pourquoi ils y arrivent. Et enfin comment on peut mieux faire.
A partir du « comment on peut mieux faire », on décide de tracer une direction et de définir la problématique à travers un brief. Cela peut passer par un dessin, un slogan, une histoire etc.
Au final on arrive à un petit script qu’on soumet à l’annonceur et qu’on affine avec lui jusqu’à la réalisation du story board, le script pour arriver à la phase de production et de réalisation de la publicité. Pour revenir sur les étapes, parmi les personnes qui interviennent sur la publicité, c’est d’abord le directeur de création, ensuite, le directeur artistique sous sa direction. C’est le bras armé du DC. Ensuite le concepteur rédacteur et éventuellement le ruffman qui va faire des dessins etc. ou le story border pour finir par le réalisateur.
N’existe-t-il pas un paradoxe entre dire que le marketing viral n’a pas de tabou et travailler pour de grands annonceurs qui eux se fixent énormément de limites à la télévision ?
Et bien déjà on peut être beaucoup plus créatif en viral car on n’est pas limité par le temps. Un spot télé c’est 30 secondes. Or le viral permet de s’étendre, de créer des petites histoires en épisodes. La marge de manœuvre est donc plus grande dans le marketing viral.
Comment cela se passe pour des entreprises comme Winston qui ne peuvent pas communiquer autour de leur produits ?
Ils ne peuvent pas communiquer sur le net. Pour Winston on travaille sur 23 pays (Russie, Allemagne etc…). Ils communiquent dans les aéroports, les duty free et les espaces fumeurs des aéroports, par exemple.
Quel est l’échelle de temps que peut prendre un projet ?
Autant de temps que le client souhaite que cela prenne. Si le client ne valide pas, s’il est lent ou qu’il ne sait pas précisément ce qu’il veut diffuser cela peut prendre énormément de temps. S’il sait ce qu’il veut, qu’il « flashe », cela peut aller très vite. Mais en moyenne cela prend de 4 à 6 mois.
Et en terme de budget ?
Tout dépend le format de tournage de la vidéo, mais globalement on peut réaliser des films à très petit budget, moins de 10 000 euros. Et en terme de gros budgets, ils peuvent atteindre jusqu’à 400 000 euros.
Vous appartenez à un réseau d’entrepreneurs. Pouvez-vous nous en dire plus ?
J’appartiens au centre des dirigeants des jeunes entreprises, le CJD. Il existe depuis 1938, et son credo c’est l’engagement moral, en terme de valeurs écologiques, sur la conception de manager son entreprise. Le coeur du CJD c’est la force de l’engagement et des valeurs au service de l’entreprise. C’est une vision très humaniste de l’entreprise. C’est un réseau d’échange entre les entrepreneurs. Ce n’est pas du tout un club d’entrepreneurs. C’est un réseau de pensées et d’échanges. Un club d’entrepreneurs c’est un endroit dans lequel chacun essaye de se servir du club pour maximiser ses ventes au travers du club, ce qui n’est pas le cas du CJD. C’est un organe de réflexion, un lobby. Pendant les élections par exemple, ils sont intervenus très fortement auprès de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. J’y trouve un avantage intellectuel.
Quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans les métiers de création et de production de publicité ?
Soyez très curieux, lisez beaucoup, soyez à l’affût de tout. La clé, c’est la curiosité. Pour pouvoir donner, il faut engranger des choses à donner. Et pour cela il faut être curieux. Il faut lire, rencontrer des gens, leur parler, susciter leur attention, s’enrichir des autres et écouter. D’une manière ou d’une autre l’entrepreneur doit avoir des choses à dire. C’est une vision, l’entreprise. C’est une volonté d’exister et de s’exprimer. Si on est très content dans son entreprise, qu’on à toute la marge de manoeuvre qu’on souhaite, en général on ne crée pas d’entreprise.
Vous saviez dès le départ que vous seriez entrepreneur un jour ?
Oui, depuis toujours je savais que j’allais créer ma société.
Et avez-vous rencontré des difficultés ?
J’ai créé deux sociétés. La première a déposé le bilan il y a un an et demi. Elle marchait bien mais j’ai connu des difficultés de trésorerie, des difficultés de gestion de croissance. J’ai mal géré mes finances, et mon association aussi. Je me suis associé avec les mauvaises personnes et cela a précipité la chute de la société qui s’est fait de manière très classique, sans planter personne. Mais ce fut pour moi l’occasion de rebondir et de tirer tous les enseignements de 5 ans d’expérience pour créer une société complètement différente avec une nouvelle façon de gérer. Je souhaite à tous les entrepreneurs de se planter au moins une fois. Le plus bel enrichissement qu’on peut avoir c’est de se relever d’un coup dur.
Comment bien choisir ses associés selon vous ?
Je pense qu’il faut garder la tête froide quand on les choisit car on a tous peur de la solitude quand on démarre une aventure. Etre jeune entrepreneur c’est être seul. On est seul face à ses handicaps à ses incompétences. Car on ne peut pas être bon et acquérir des compétences en comptabilité, en juridique, en commercial etc. On ressent donc le besoin de s’associer. Une association doit se faire parce qu’elle a du sens. Sans complémentarité dans une association, à moins d’une entente unique, je n’y crois pas. Il y en a toujours un qui travaille plus que l’autre et celui qui travaille n’a pas le temps de s’énerver tandis que l’autre qui ne fait rien a tout le temps pour critiquer. Il faut un équilibre. C’est un mariage l’association. Chacun doit amener quelque chose, soit du temps, soit de l’argent, soit des idées.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune entrepreneur ?
Tenez bon. C’est avant tout une histoire de persévérance. Et surtout, ne dépensez pas l’argent que vous n’avez pas car si votre société se retrouve bloquée par la banque, elle ne peut plus avancer. Anticipez les dépenses et soyez très vigilant.