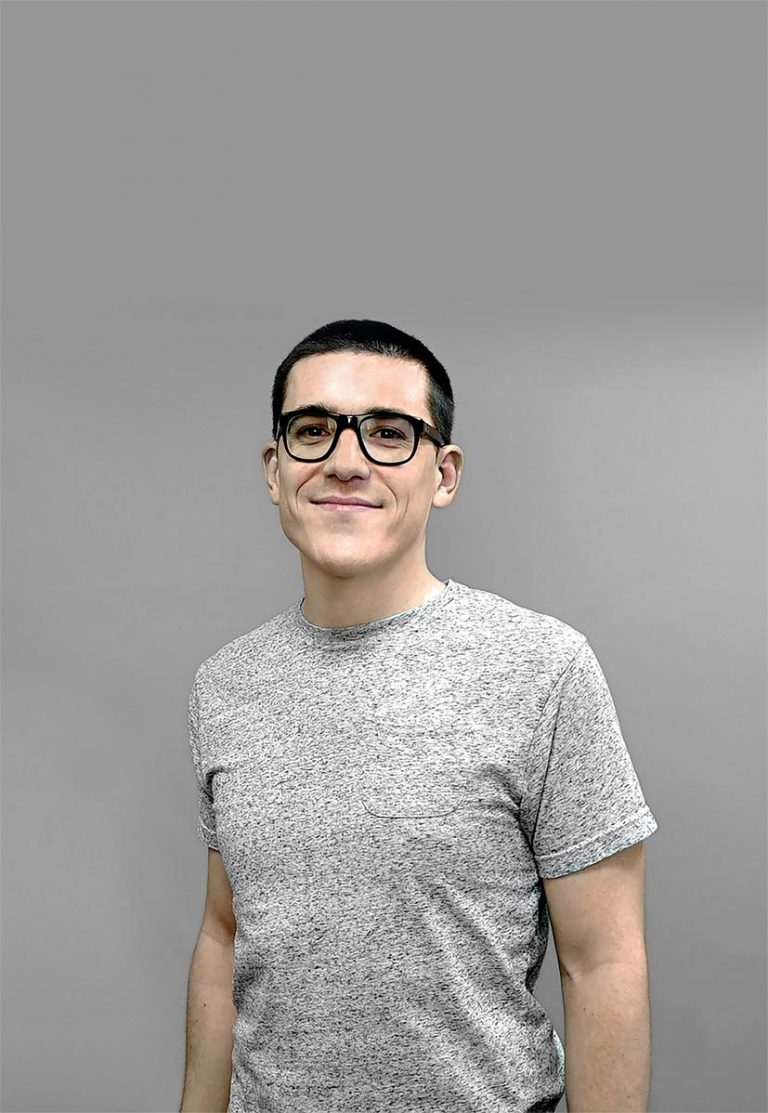À seulement 30 ans, William Eldin n’a qu’une idée en tête : « augmenter l’Homme de demain ». Bio-inspiré, l’ex-associé de Coyote (assistant à la conduite communautaire), s’est lancé, avec son ami d’enfance, Damien Mulhem, dans un projet qui lui tient à cœur, XXII Group. Deux ans après sa création, l’entrepreneur ne cache pas son optimisme et ses ambitions.
Vous vous êtes lancé dans l’entrepreneuriat à l’âge de 18 ans. Racontez-nous…
J’ai grandi à Nanterre. Lors de mes années lycée, j’allais peu en cours car j’avais monté, en parallèle, un groupe de musique avec un ami devenu mon associé actuel, Damien Mulhem. J’obtiens, malgré tout, un bac STI Électronique à 10,03 et intègre une radio. Damien, lui, entre chez Apple. Le projet de musique est abandonné mais nous gardons contact. Au bout d’un an et demi, tout ne se passe pas comme prévu à la radio. Je découvre un univers hyper concurrentiel où le contenu, loin d’être transparent, n’est pas libre. Je décide d’entreprendre autre chose et, passionné de motos et d’automobiles, lance un petit magasin à thème, boulevard de Clichy.
Au même moment, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, installait des radars un peu partout sur le territoire. Je crée ARP (Anti Radars Service, ndlr), orienté pour contourner les radars. Je me rends aux forums auto, fréquente les rassemblements du vendredi soir et constate que, malgré la multiplication des radars, on continue de rouler vite. J’ouvre alors, progressivement, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième magasin. La société fonctionnant bien, j’établis un site internet et deviens l’un des plus gros revendeurs avec Darty, Boulanger et Feu Vert.
Comment en êtes-vous arrivé à vous associer dans Coyote ?
En 2008, je rencontre l’un de mes fournisseurs, Fabien Pierlot, qui avait créé et diffusé la première version de Coyote (un assistant à la conduite communautaire, ndlr) deux ans auparavant. Nous décidons donc de nous associer pour créer un réseau de magasins pour la sortie de la deuxième version du système. Le réseau de ventes d’ARP est converti pour alimenter Coyote, qui est en pleine croissance avec un axe de développement grand public. Un an plus tard, un fonds d’investissement prend part au capital de la société et, en 2011, l’interdiction des avertisseurs de radars nous oblige à changer de stratégie. Nous nous battons et parvenons à contourner la difficulté mais Waze (une application de trafic et de navigation communautaire, ndlr) arrive sur le marché. Second coup dur pour notre croissance…
Au même moment, Fabien rachète les parts du fonds d’investissement. Je lui demande de quitter l’aventure car la stratégie envisagée ne correspond pas à ma vision : je voulais m’occuper des technologies innovantes dans leur ensemble, c’est-à-dire l’évolution du monde entier et de ses moyens de communication. D’un commun accord, ils me rachètent mes actions, je les quitte en 2015.
Vous retrouvez ensuite Damien Mulhem et cofondez, ensemble, XXII GROUP en 2015. Comment cela s’est-il fait ?
Le groupe de musique que nous avions créé, Damien et moi, alors que nous n’avions que quinze ans, s’appelait, en réalité, XXII. Ce nom est une référence à la synchronicité. À l’époque, nous regardions une horloge et elle indiquait 22h22, une adresse portait le numéro 22, idem pour une plaque d’immatriculation… Nous avons décidé d’écouter tous ces signes et avons opté pour « XXII » (abréviation de « XXII Group », ndlr), un peu comme un chiffre porte-bonheur. Pour l’anecdote, le jour de mon mariage, Damien vient me voir, me regarde dans les yeux et me dit : « Tu n’en as pas assez de travailler pour autre chose que XXII ? ».
Nous nous sommes lancés le défi de faire l’entreprise la plus grosse au monde, technologiquement parlant, du moins, que nous allions essayer. Nous n’avons pas envisagé d’en faire une start-up, un cas d’utilisation que nous allions revendre demain. Globalement, nous, notre passion, c’est comprendre les transformations, l’évolution et, au-delà de cela, essayer de l’instruire. Nous entamons donc le projet et, en 2015, XXII est recréée. À ce moment-là, nous savons que nous ne sommes pas plus intelligents que les autres mais nous savons aussi que nous avons de la détermination et de l’énergie à revendre.
Concrètement, qu’est-ce que c’est XXII GROUP ?
Aujourd’hui, un studio d’innovation. Demain, un gros du software et, après-demain, une société qui aura permis de relier la biologie à la technologie. En clair, un tout-en-un. Nous essayons de travailler pour la télévision 4.0 comme pour les véhicules de demain en tentant de capter la vague de l’Intelligence Artificielle (IA) et des neurosciences. Il va y avoir des changements incontournables dans ces domaines-là et nous essayons d’être des précurseurs. Nous croyons dans le fait que la communication va s’accélérer et que les ordinateurs et téléphones portables sont voués à disparaître. La question reste de savoir ce qui va prendre le relais afin de pouvoir nous y investir.
Avec XXII, nous nous appuyons sur des technologies phares, celles les plus scalables et propices à l’évolution numérique du moment. Notre stratégie est, en grande partie, portée sur du contenu, c’est-à-dire sur de la formation et du gaming en virtuel mais également sur de la communication autour des marques et des sorties produits. Nous sommes un peu comme une usine à POC (proof of concept, littéralement « preuves de concepts » en français, ndlr), destinée à intéresser les gens à notre recherche scientifique et de software. Nous créons du contenu pour montrer à tout le monde nos technologies. On ne peut pas débarquer chez monsieur X du CAC 40, les mains dans les poches, et lui dire : « Nous faisons ça, ça et ça. Que voulez-vous acheter ? » L’idée demeure de pouvoir montrer à de grandes entreprises qu’il est possible de réaliser quelque chose, chez eux, de très, très novateur.
Vous dites vouloir « AUGMENTER l’Homme de demain ». Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
La technologie est, aujourd’hui, parallèle à la biologie. Au fur et à mesure que notre conscience évolue, la puissance de calculs aussi. Si on regarde le passé, on constate que tout a été miniaturisé et révolutionné. Et, à chaque fois, de plus en plus rapidement. L’enjeu reste d’augmenter les sens de l’être humain, c’est-à-dire sa capacité à regarder, à comprendre, à réfléchir, à se souvenir, à se déplacer… Tout ce qui se trouve autour de nous, aujourd’hui, va, possiblement et sûrement, évoluer. Demain, les technologies seront intégrées à la biologie. Pour parler de manière concrète, la télépathie pourrait devenir scientifique. Notre cerveau acquerra des nouvelles méthodes d’utilisation.
Nous pourrions apprendre à nous servir de notre cerveau pour en comprendre ses lobes. Cela fait partie des ambitions, sur le long terme, de XXII. Nous collaborons déjà avec des docteurs spécialisés en IA et en neurosciences, avec des laboratoires très avancés sur le sujet et travaillons sur le BCI (Brain Computer Interface, soit l’interprétation de charges électromagnétiques du cerveau, ndlr). En résumé, nous menons des recherches sur une nouvelle méthode de développement de l’IA, non assujettie au Big Data. On ne remet pas un dictionnaire à un enfant pour qu’il apprenne à parler. On lui dit tout, petit à petit, et de manière méthodologique. Nous sommes bio-inspirés.
Un défi de taille donc. Comment faites-vous pour ne rien lâcher ? Le fameux « Never give up »…
Ce sont plein d’ingrédients qui font que je suis une personne de bon sens et qui a beaucoup d’ambition. Je me sens capable d’y aller. Autrement dit, pour ne rien lâcher, il faut de la détermination et une énergie hors du commun. Toujours lancer la balle un peu plus loin et ne pas se dire qu’il y a des barrières car elles n’existent pas. Ne jamais abandonner, si on le dit en français (rires) ! La règle est de ressentir les choses, d’être, en permanence, en alerte et de faire attention à tout. Au-delà d’un simple conseil, il s’agit d’un état d’esprit. Si on ne trouve pas un poulet le dimanche car les deux boucheries du coin sont fermées, c’est qu’il faut aller en chercher une autre, ouverte, un peu plus loin ! Si on parvient à tout cela, on obtient, forcément, des résultats.
Quelle est, pour vous, votre plus grande réussite ? Et à l’inverse, votre plus grande difficulté ?
Ma plus grande réussite, c’est de réaliser mes rêves. Comme le disait Jacques Brel, le plus important, dans cette quête de succès, est d’arriver à ce qu’on s’est fixé. Là où je pense que, moi, je réussis, réside dans le fait que je fais ce que j’aime. Ensuite, il est vrai que l’argent est, plus ou moins nécessaire, pour vivre bien. Mais l’essentiel reste de faire quelque chose que l’on aime.
En ce qui concerne ma plus grande difficulté, elle se traduit par le fait d’apprendre à comprendre l’humain, de connaître ses capacités et de ne pas en demander plus que ce qu’il est possible de donner. En d’autres termes, il faut être un grand thermomètre de ses équipes afin de percevoir jusqu’où elles peuvent aller. Il ne faut pas non plus se dire que tout le monde va comprendre ce que l’on pense mais penser plutôt à donner ce que les gens sont capables d’aller chercher. Finalement, la plus grande difficulté est de se comprendre entre êtres humains.
Comment faites-vous pour maintenir l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ?
J’ai divorcé trois fois ! Je plaisante, bien sûr (rires). D’abord, les plaisirs se trouvent dans mon entreprise donc je ressens, de moins en moins, le besoin de m’en écarter en allant chercher une activité extérieure. Ensuite, j’ai rencontré ma femme au collège alors que j’avais tout juste quinze ans. Elle sait comment je suis fait étant donné que je suis resté comme cela depuis mon adolescence, et même avant. Elle a signé avec ce cahier des charges. D’un autre côté, j’essaie d’être à 100 % avec les personnes avec lesquelles je me trouve. Lorsque je rentre à la maison, par exemple, je suis à 100 % avec ma femme et mon fils d’un an, même le weekend.
Le secret est, là encore, une histoire de sensibilité. Il faut essayer de percevoir ce qu’il se passe dans le coeur de l’autre pour savoir à quel niveau psychologique il se trouve. Si je m’aperçois que je manque, je m’efforce d’être un peu plus présent. L’avantage d’être chef d’entreprise demeure que, mine de rien, il est possible de prendre des jours à droite, à gauche, un peu quand on veut. Autre élément clé : ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. J’ai la chance de ne dormir qu’entre quatre et cinq heures par nuit. Lorsque ma famille dort, je peux donc continuer de travailler.
Si vous aviez un message à faire passer aux entrepreneurs. Quel serait-il ?
Il serait lié à la notion d’ADN de l’entreprise. Le bonheur est de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, qui pensent à peu près la même chose que nous et avec qui l’on passe de bons moments. Je pense que l’ADN de XXII c’est, justement, d’être en présence de personnes qui sont, plus ou moins, dans le même état d’esprit, avec, à peu près, les mêmes ambitions et un niveau d’énergie similaire. Notre ADN met, fortement, l’accent sur l’humain et, au sein de cette société, je m’efforce de faire respecter certains points comme le fait qu’il y ait du plaisir au travail.
Pour que cela puisse fonctionner, j’essaie de réaliser de bons recrutements. Qui l’on recrute demeure hyper important et essentiel. Cette étape constitue la source du fleuve qui va être créé. Pour cette raison, je mets un point d’honneur au recrutement et à l’aspect humain que possèdent les personnes qui postulent chez nous. Je veux des personnes sensibles, bien élevées, productives, qui repoussent les barrières, tout. Je recherche une certaine catégorie de personnes qui soient des obstinées.
5 conseils de de William Eldin
- Avec le cœur ou rien. Tout ce qu’on ressent, il faut le faire et le reste, l’abandonner.
- Cultiver son énergie, qui optimisera, derrière, le résultat.
- Croire en tout le monde mais se méfier de tout.
- Dépasser les limites de la recherche et fonctionner en autodidacte. Allez apprendre de vous-même et ne vous arrêtez jamais. Les barrières n’existent pas. Dépasser, dépasser et dépasser ses limites et ne jamais rien lâcher.
- Écouter les autres pour apprendre et, non pas, pour répondre.
« On ne remet pas un dictionnaire à un enfant pour qu’il apprenne à parler. On lui dit tout, petit à petit, et de manière méthodologique. »