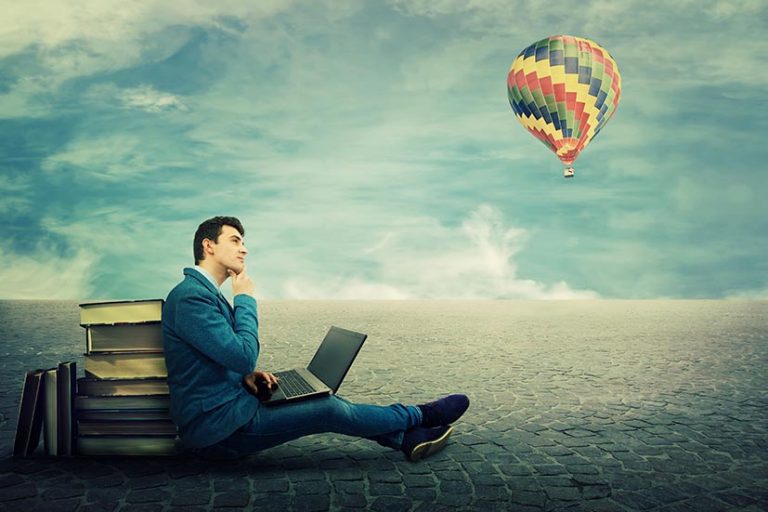Pendant longtemps, le marché du cinéma a exercé un monopole sur le divertissement. Mais avec l’arrivée des nouveaux formats comme le streaming et les services de vidéo à la demande, il a été contraint de s’adapter. Les salles obscures tentent alors de se moderniser avec la projection numérique et offrent une qualité d’image à l’écran supérieure et du son immersif. De leur côté, des start-up cherchent à transformer le secteur du cinéma en proposant aux cinéphiles des expériences inédites par le biais des nouvelles technologies. Découvrez sans plus attendre ces entreprises novatrices.
Le marché mondial du cinéma a produit, en 2017, 39,92 milliards de dollars de recettes, selon Comscore (société américaine d’analyse publicitaire, ndlr). L’Amérique du Nord tire son épingle du jeu avec des sommes supérieures à 11 milliards, tandis que la Chine progresse de plus en plus avec 8,5 milliards de dollars. Dans l’Hexagone, l’an dernier, la fréquentation des salles de cinéma s’élevait à 209,2 millions d’entrées, troisième meilleur score depuis cinquante ans, conformément au CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée, établissement public rattaché au ministère de la Culture, ndlr). Mais, en parallèle, des start-up françaises et étrangères se lancent dans le marché du cinéma pour offrir aux spectateurs de nouvelles expériences et sensations. Des projections de films à la demande, à la salle de cinéma digitale, en passant par une application de réalité virtuelle, l’innovation ne manque pas.
Muvix et ses projections à la demande
Créée en 2016 par Alon Cohen, la startup israélienne Muvix révolutionne les salles obscures en proposant une technologie de vidéo à la demande. Objectif : rivaliser avec la VOD (« Video On Demand », en anglais, qui signifie « Vidéo À la Demande », en français, ndlr) en ligne et les services de diffusion à domicile, mais aussi proposer une nouvelle façon de consommer au cinéma. Grâce à sa technologie qui permet le visionnage de plusieurs canaux de contenu comme des films, des émissions de télévision, des événements sportifs ou des concerts, l’entreprise propose à ses clients des projections variées. Via une application mobile, ils peuvent commander une mini salle de cinéma afin d’accueillir un groupe d’amis ou leurs proches. C’est à l’intérieur d’un multiplex intitulé « Muvix Concept » à Tel Aviv que la technologie est principalement utilisée avec quatorze emplacements, aptes à accueillir, pour certains, jusqu’à une vingtaine de personnes. Chaque pièce se compose d’une grande télévision à écran plat, de meubles, d’un canapé, d’un fauteuil, voire de grands lits pour lui conférer un esprit « comme à la maison ». Les téléspectateurs peuvent choisir le film qu’ils souhaitent regarder parmi une liste d’une centaine de long-métrages récents et classiques, le débuter à tout moment et dans différentes langues en même temps via une paire d’écouteurs branchés à leur Smartphone. Un service de livraison de nourriture est disponible afin de profiter au maximum de la projection. La start-up a également testé son produit dans des espaces publics comme sur une plage, dans un parc ou sur un toit, créant un cinéma éphémère par le biais d’un petit boîtier décodeur, qui gère la communication avec les téléphones des cinéphiles.
e-cinema et sa salle de cinéma digitale
Fondée en 2017 par Roland Coutas, Bruno Barde et Frédéric Houzelle, la start-up e-cinema propose une plateforme de SvoD (« Subscription video on Demand », en anglais, soit « Service de vidéo à la Demande par abonnement », en français, ndlr) qui se veut être la première salle de cinéma digitale. Chaque vendredi, elle propose aux téléspectateurs un film inédit non diffusé dans l’Hexagone et accessible durant douze semaines. Pour 3,99 euros, ils pourront le louer ou bien acheter un abonnement à 5,99 euros par mois afin de visionner en illimité tout le catalogue d’ouvrages cinématographiques primés dans plusieurs festivals internationaux. Tout cela, depuis leur télévision, ordinateur, tablette ou Smartphone via internet et Apple TV. Une émission entière dédiée au cinéma est également diffusée gratuitement et présentée par la journaliste Audrey Pulvar le vendredi à 14 h pour discuter du film de la semaine avec des spécialistes du secteur. La start-up souhaite, actuellement, proposer ses services depuis des box et négocie auprès d’opérateurs de télécommunications comme SFR et Free pour y parvenir.
Cinémur et son application de réalité virtuelle
Lancée en 2013 par Julien Nicault et Olivier Chatel, la start-up Cinemur spécialisée dans les services de vidéo à la demande, présente depuis fin 2017, une application de réalité virtuelle intitulée « CineVR ». Le concept : amener les spectateurs dans une salle de cinéma sans les faire bouger de leur maison. Installée sur Smartphone et sur ordinateur, cette solution permet aux utilisateurs de regarder différents contenus comme des bandes-annonces, des vidéos en trois dimensions ainsi que des films et séries en simultané avec neuf amis ou membres de leur famille, même s’ils se trouvent de l’autre côté de la Planète. Pour l’utiliser et s’immerger pleinement, un téléphone portable, un casque de réalité virtuelle de type Oculus Rift, HTC Vive ou encore Samsung GearVR, ainsi qu’un casque audio sont nécessaires. Les personnes sont alors plongées dans une salle de cinéma virtuelle 3D à 360 degrés, disposant de 275 places et reproduisant à l’identique la sensation visuelle et sonore des salles obscures, avec des effets de lumière et un son spatialisé. Tout en regardant l’immense écran devant eux, ils peuvent interagir avec les autres vocalement ou par le biais d’émoticônes, chacun étant représenté dans la pièce par un avatar personnalisé. Des plateformes de vidéo à la demande comme FnacPlay ont déjà recours à la technologie de la start-up.
Ces entreprises tentent ainsi de mettre en lumière le cinéma du futur. Le septième art cherche à se différencier et à s’adapter aux nouvelles technologies afin de lutter contre un secteur qui prend progressivement de la place, celui du service de vidéo à la demande par abonnement, comme Netflix. Dans l’Hexagone, le poids économique de ce marché a atteint 249 millions d’euros en 2017 et l’entreprise américaine de diffusion de films et de séries en est le leader reconnu, devant Amazon Prime Video, Canalplay et SFR Play. Selon une étude commune du CNC et du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, ndlr), dévoilée en mai dernier, elle représente 70 % de parts de marché du secteur et dispose de plus de 3,5 millions d’abonnés en France.