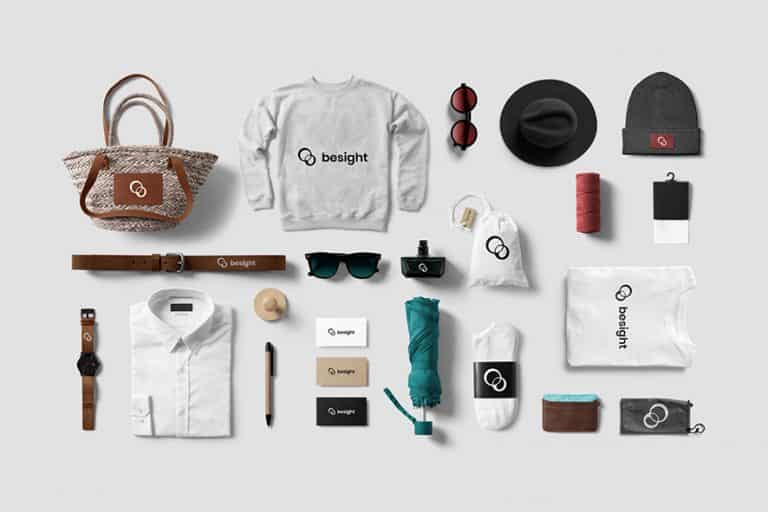À 58 ans, Éric Duval fait partie de la génération des entrepreneurs formés sur le tas. Il a fait ses premiers pas dans l’entreprise familiale et aujourd’hui, il est à la tête d’un groupe de plus de 3 500 salariés, réalisant plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires. Spécialisé dans l’immobilier depuis sa création, en 1994, le Groupe Duval ambitionne de faire de ses sociétés les leaders de leurs marchés. Et le pari semble en passe d’être relevé.
Qu’est-ce qui vous a conduit à entreprendre ?
Je suis originaire de Rennes (préfecture de la région Bretagne, ndlr). En 1978, mon père détenait une entreprise de BTP et avait, en parallèle, créé une petite structure nommée Maisons de Bretagne, qui existe toujours et s’occupe de biens individuels au coup par coup. À cette époque-là, les entrepreneurs se formaient sur le tas. Il m’a alors proposé d’abréger mes études afin de le rejoindre. Ainsi, peu de temps après mon bac, je suis allé apprendre le métier sur les chantiers de l’entreprise de construction.
Deux ans plus tard, je reprends la structure familiale, qui œuvrait essentiellement dans le BTP, avant de m’orienter vers les métiers de la promotion immobilière, secteur dans lequel je me sentais plus à l’aise. Et en décembre 1994, je décide de fonder mon propre groupe, de façon autonome, d’abord sous le nom de la holding Financière Duval puis, du Groupe Duval, formé autour du métier de l’immobilier. Au départ, j’étais seul. Aujourd’hui, nous sommes 3 500 salariés en France. J’ai toujours souhaité entreprendre et je continue !
Le Groupe Duval exerce, aujourd’hui, plusieurs métiers autour de l’immobilier. Lesquels ?
Nous avons organisé le groupe en plusieurs divisions. D’abord, nous sommes promoteurs. Nous nous occupons de la construction de centres commerciaux, de l’immobilier d’entreprise, qu’il s’agisse de bureaux, de plateformes logistiques ou encore d’usines, et de logements vendus en bloc aux bailleurs sociaux ou à la découpe aux particuliers. Aujourd’hui, notre métier de promoteur affiche un carnet de commandes de 2,5 milliards d’euros répartis sur une dizaine d’agences sur l’ensemble du territoire français, y compris dans les D.O.M.-T.O.M. (départements et territoires d’outre-mer, ndlr).
Nos équipes multidisciplinaires nous permettent de proposer aux collectivités des opérations mixtes de cœur de ville, qui intègrent toutes les problématiques de l’immobilier. Nous sommes également « property managers » (gestionnaires d’actifs immobiliers, ndlr) et gérons près de 20 milliards d’actifs en France, essentiellement dans le secteur de l’immobilier d’entreprise et commercial.
Parallèlement à cela, nous sommes assistants maîtres d’ouvrage grâce à ALAMO, un outil technique qui conçoit, livre et fabrique des immeubles pour le compte du groupe mais aussi pour d’autres opérateurs. Enfin, nous sommes aussi propriétaires d’actifs, qui représentent environ 1,8 milliard d’euros. En résumé, lorsque nous allons voir une collectivité ou un opérateur quel qu’il soit, nous pouvons à la fois nous positionner comme un fabricant, un gestionnaire et un propriétaire ou copropriétaire d’immeubles. Autant de raisons pour lesquelles, quand nous nous engageons sur une opération, nous nous engageons, généralement, sur le long terme.
Quatre ans après la création, vous rachetez Odalys, spécialisée dans le tourisme. Pourquoi ce choix ?
Au-delà de nos activités de promoteur immobilier et de gestion de patrimoine, nous détenons une partie « exploitation », qui implique les métiers de moyen terme. Odalys entre dans cette catégorie. Alors qu’elle n’était encore qu’une entreprise naissante, nous l’avons rachetée en 1998 car elle allait nous permettre de générer des revenus récurrents. Disons que c’était un pied de plus à notre tabouret, de sorte à ce que le groupe devienne plus solide et plus stable financièrement.
Lors du rachat, pas mal d’acteurs nous ont critiqués en nous reprochant de trop nous diversifier et de nous disperser. Au final, nous avons eu raison, d’une part, parce que nous avons bien réussi dans ces métiers-là : en démarrant avec 8 000 lits, nous sommes passés à 138 000 lits et sommes devenus, grâce à Odalys, le numéro deux européen de la résidence de tourisme. Mais surtout, tous les autres groupes nous ont copiés. Ils ont, au bout du compte, eux aussi, créé des structures d’exploitation comme des résidences d’affaires, pour seniors ou encore pour étudiants.
Comment percevez-vous le marché de l’immobilier actuellement ?
Très bon. Il n’y a qu’à regarder les chiffres ! Tout le monde est satisfait. Nous restons toutefois très prudents à l’égard du risque de surchauffe du marché. Auparavant, il était assez mauvais mais, depuis quelques années, un rattrapage du marché s’opère donc il faut rester attentif à son évolution. Mais quoi qu’il en soit, c’est positif !
Face à un marché « en surchauffe », en quoi la structuration du groupe fait-elle la différence ?
La stratégie que nous avions à l’époque se confirme maintenant. D’abord, par la solidité de notre bilan. Ensuite, par le fait que nos concurrents se sont mis à adopter ce modèle. Nous nous sommes positionnés sur les segments de résidences pour étudiants, d’affaires, du tourisme, à la mer, à la montagne ainsi qu’à la campagne. Nous avons également développé une chaîne de résidences pour seniors, Happy Senior, et nous sommes positionnés sur quasiment l’ensemble des métiers d’exploitation des logements. Sur ce segment, nous sommes leader en France et détenons une compétence multiple que d’autres n’ont pas. Nous avons cette capacité à réagir rapidement et à nous montrer créatifs. Lorsque nous somme capables de faire tous ces métiers, la structuration du groupe fait la différence.
Vous œuvrez aussi dans le secteur du golf. Quel lien avec l’immobilier ?
Grâce à Ugolf (anciennement NGF Golf, ndlr) et LeClub, nous nous plaçons comme le leader mondial (avec 54 golfs en France et 700 golfs en réseau dans le monde, ndlr). Le changement de nom fait d’ailleurs partie de notre stratégie d’internationalisation du modèle. Plus concrètement, nous nous sommes tournés vers le secteur du golf dans cette logique de diversification. Nous avions regardé les métiers émanant du sport et des loisirs et avons opté pour celui du golf étant donné qu’aucun acteur ne possédait plus de 3 ou 4 % de parts de marché. Ce positionnement nous a permis de devenir un opérateur consolidateur.
Lorsque nous avons démarré, nous n’avions que 300 000 euros de recettes, alors qu’aujourd’hui, nous en générons près de cinq millions et sommes devenus le plus gros opérateur français. Toujours en matière de diversification, nous avons créé une holding dans le secteur des nouvelles technologies. Celles-ci impactant nos métiers traditionnels, nous avons investi dans tout un tas de structures qui se développent très rapidement. Nous sommes d’ailleurs considérés comme le groupe immobilier le plus impliqué dans les nouvelles technologies ainsi que dans la digitalisation de nos métiers. Nous continuons à le faire et apprenons beaucoup grâce à cela.
Plus globalement, comment avez-vous fait pour surmonter les difficultés tout au long de l’aventure ?
Des difficultés, nous en rencontrons tous les jours. Pour les dépasser, il faut être capable de se montrer sélectif, pragmatique et avoir le sens des priorités. Et surtout, une entreprise ne se fait pas toute seule mais avec des talents. C’est primordial. J’ai toujours recruté des gens bien meilleurs que moi. Ils forment aujourd’hui le socle, les fondamentaux du groupe. J’ai la chance d’être bien entouré. Il est possible de réussir en France. C’est un message important que je tiens à diffuser. Les talents ne doivent pas fuir notre pays.
Vous êtes également cofondateur de la fondation DUVAL. En quoi cela consiste-t-il ?
À travers la fondation Duval, nous menons des actions humanitaires en Afrique et en Asie au sein d’orphelinats, de dispensaires, d’écoles… Nous nous rendons régulièrement sur place, une démarche que j’ai eue au niveau familial et que nous poursuivons. À partir de ces démarches, nous avons par ailleurs développé une activité de transformation de riz, désormais rentable. Nous transformons ainsi du riz et l’exportons en France. Au vu du développement du groupe en France, nous avons considéré que nous avions atteint la taille suffisante pour nous développer à l’international.
Que représente l’entrepreneuriat pour vous ?
La liberté. L’entrepreneuriat permet de décider de ce que vous souhaitez faire. Je détiens 100 % du capital de la holding et peut ainsi faire plein de choses. Je ne me suis pas uniquement limité à un seul métier mais j’ai préféré diversifier le groupe en démarrant par une entreprise. Quand nous sommes entrepreneurs, nous sommes souvent contraints mais nous restons libres d’entreprendre.
Vous codirigez l’entreprise avec votre fille. Parvenez-vous à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ?
Il est vrai que l’entreprise n’est jamais bien loin de la maison. Ma fille, Pauline, a grandi dedans, mon fils, Louis-Victor, a également la fibre entrepreneuriale et mon père est, lui-même, entrepreneur. Cette envie d’entreprendre fait partie de nos gènes. Je fais toutefois attention à bien faire le distinguo entre vie familiale et vie professionnelle, malgré la place importante qu’occupe cette dernière !
5 conseils d’éric duval
- Soyez curieux. Il y a plein de choses qui nous entourent et que les gens ne regardent pas. Il faut aller les chercher, car de temps à autre, il y a des évidences que nous ne voyons pas, faute de s’y intéresser. C’est en étant curieux que nous finissons par nous ouvrir et être créatifs.
- Soyez créatif. La curiosité amène à la créativité et, quand nous sommes créatifs, nous dépassons souvent ceux qui ne le sont pas.
- Soyez rigoureux. Il s’agit d’un passage obligé car ceux qui sont créatifs font parfois de très belles choses mais les contraintes économiques doivent être respectées pour que le projet se fasse. Être rigoureux permet au créateur de pouvoir concrétiser sa création.
- Soyez agile. Au vu de nos différents métiers, être agile est une nécessité. Et cette agilité permet aussi de devenir créatif.
- Amusez-vous, et encore amusez-vous !
« Une entreprise ne se fait pas toute seule mais avec des talents. C’est primordial. J’ai toujours recruté des gens bien meilleurs que moi. »