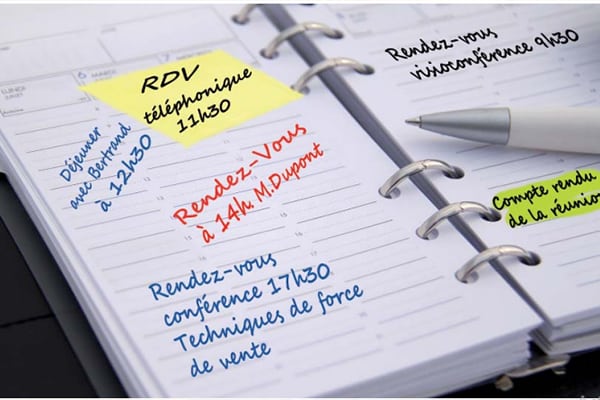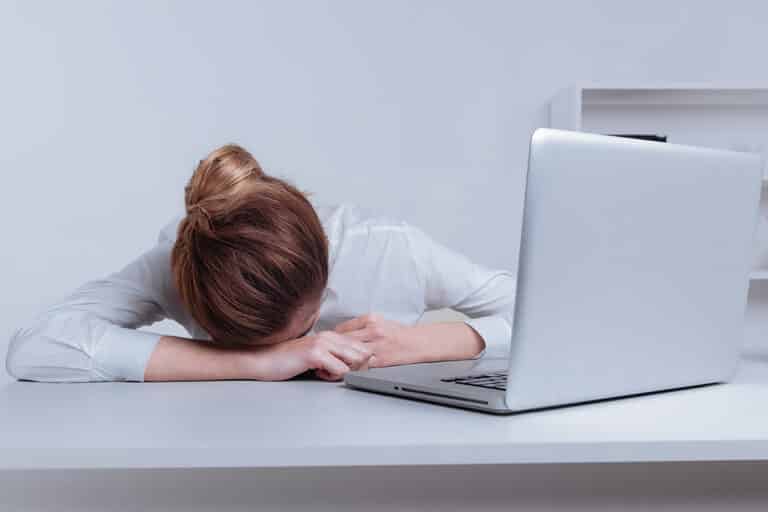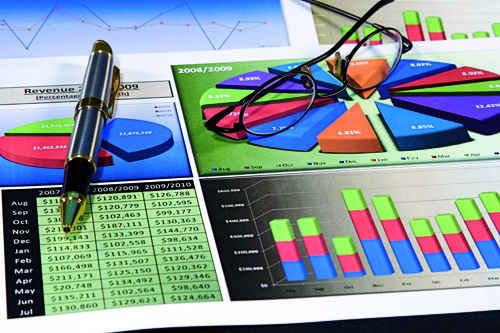L’international peut tirer le développement des PME… et on peut les y aider. Focus sur l’action des Chambres de Commerce et d’Industrie pour booster l’internationalisation des entreprises.
Entendons-nous bien, jamais aucun des six cents conseillers en développement à l’international des CCI ou des conseillers en innovation ne recommandera à une entreprise, plus encore s’il s’agit d’une TPE ou d’une PME, de s’engager à l’exportation ou à la recherche d’une implantation à l’étranger, sans au préalable avoir effectué un véritable diagnostic de ses forces, de ses faiblesses et de sa capacité réelle à initier une telle stratégie.
Une aventure à bien préparer
Nombre d’entreprises qui n’avaient ni les ressources humaines suffisantes ou adéquates, ni les moyens financiers, ou encore dont les produits étaient trop peu élaborés, trop peu sûrs, ou dont les brevets étaient trop peu protégés, se sont un jour retrouvées en difficulté. Leur survie même a été menacée par la tentative de cette aventure à l’étranger.
Disons-le d’emblée, un des grands atouts du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de France, dont nous savons que la couverture nationale s’appuie sur une proximité forte des entreprises dans les territoires où elles sont implantées, est justement cette capacité à avoir une vision et une approche globale de l’entreprise. De cet avantage, naît non seulement la connaissance de l’entreprise, mais aussi très souvent, la connaissance de l’entrepreneur et de ses collaborateurs.
Le reste, si on peut oser le dire ainsi, n’est plus alors que la question de l’enchaînement d’étapes plus ou moins logiques, tant souvent le rôle de l’opportunisme, ou du hasard, peut être grand dans une démarche d’exportation par exemple. Le rôle alors de chacune des composantes de l’équipe de France de l’Export est donc de limiter au maximum, et de minimiser, cette intervention du hasard.
De la préparation à l’action
La baisse continue du nombre d’entreprises françaises exportatrices, et au contraire le poids grandissant de la part des grands contrats dans les exportations françaises, conduit les acteurs que nous sommes, mais aussi les autres partenaires de cette équipe de France de l’Export, à sans cesse rechercher à identifier, pour ne pas dire parfois à débusquer, les PME-PMI voire les TPE-TPI non encore exportatrices mais qui en auraient le potentiel. La faiblesse de notre tissu d’entreprises et notamment d’entreprises patrimoniales, ne facilite guère cette tâche.
Le constat, aujourd’hui maintes fois réitéré, du trop petit nombre d’ETI, est bien connu et ce n’est malheureusement pas par de simples incantations que l’on pourra renverser cette tendance ! Toujours est-il qu’aujourd’hui, les dispositifs d’accompagnement ont considérablement évolué et que le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de France par exemple, en métropole mais aussi à l’étranger, avec l’agence Ubifrance, avec l’appui dans certains cas des collectivités territoriales, sont en ordre de marche.
Le choix de la structure d’accompagnement
Pour l’entreprise, les étapes de l’exportation sont clairement identifiées, les acteurs positionnés, l’entreprise ayant le choix – devant pouvoir garder le choix de la structure qui l’accompagnera. Les CCI, en l’occurrence, sont en mesure d’intervenir dès les premières phases d’information, tant par des rencontres collectives, que d’ores et déjà dans une relation individuelle à l’entreprise.
C’est là en l’occurrence que le rôle du diagnostic export intégré, tel qu’il est réalisé en Rhône-Alpes, en Normandie ou dans les Pays de la Loire par les CCI, est déterminant. Les premières rencontres avec les experts pays des CCI françaises à l’étranger ou ceux d’Ubifrance permettent alors d’affiner un projet, d’en préciser les contours et les modalités.
L’organisation des manifestations collectives autour d’une mission de prospection ou de la participation à un salon professionnel permet alors de franchir, une première fois, avec des chances de réussite optimisées, la frontière avec l’étranger. Les préalables, notamment en termes de connaissance des pratiques de l’export et de leur financement, deviennent impératifs. Incoterms, moyens de paiement, flux logistiques ne peuvent être improvisés. Leur choix détermine, par la suite, toute une série de conséquences mesurables au préalable.
Quelle organisation pour les CCI de France ?
Le réseau consulaire a, depuis longtemps déjà, érigé parmi ses priorités le développement à l’international des entreprises. 600 collaborateurs, partout en France qui sont chargés d’informer les entreprises, de les conseiller, de les accompagner sur les marchés étrangers, de leur faciliter leurs conditions d’implantation.
La capacité des CCI à avoir une vision globale des entreprises par l’intermédiaire de leur service « industrie », ou encore le réseau « Europe Entreprise Network » ou bien même par les Centres de langues qu’elles gèrent, permet non seulement la mise en œuvre d’une stratégie de développement international mais aussi, d’organiser le renforcement des éléments de compétitivité de ces mêmes entreprises.
Une mutualisation des compétences intéressantes
La mutualisation des compétences rassemblées sous la bannière CCI International à l’échelle régionale comme à l’échelle nationale décidée courant 2010 doit permettre d’accélérer désormais le travail sur trois axes de progrès :
- d’une part, la visibilité du réseau des CCI et de ses actions,
- d’autre part, la création de normes de fonctionnement et de produits,
- enfin, le renforcement de la synergie entre CCI elles-mêmes, entre les CCI en métropole et les Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger, entre le réseau consulaire et les autres acteurs du commerce extérieur français : Ubifrance, l’agence française pour le développement international des entreprises, les collectivités territoriales, etc…
L’association CCI international : une opportunité
La création de l’Association CCI International, l’Association des CCI françaises pour l’internationalisation des entreprises, dans laquelle se retrouvent CCI de France et Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’étranger, leurs têtes de réseau respectives (ACFCI et UCCIFE), est venue illustrer cette ambition. Cette démarche du réseau consulaire s’inscrit également dans la prise de conscience de la nécessité d’une synergie forte entre les différents acteurs en charge de la promotion des entreprises françaises à l’étranger.
Contrairement à ce que l’on peut souvent croire, le commerce extérieur français ne se porte pas mal ; c’est sa structure qui pose problème : dépendance aux grands contrats, dépendance aux grands groupes, alors que le socle général des entreprises exportatrices ne cesse de diminuer ces dernières années en dépit des efforts d’identification des nouveaux exportateurs. Il y a donc aussi urgence à renforcer les entreprises qui sont elles déjà engagées sur la voie de l’exportation et nous pouvons, CCI de France et partenaires de l’équipe de France de l’Export, vous y aider.
Article par DOMINIQUE BRUNIN | DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL | UCCIFE & CCI INTERNATIONAL |