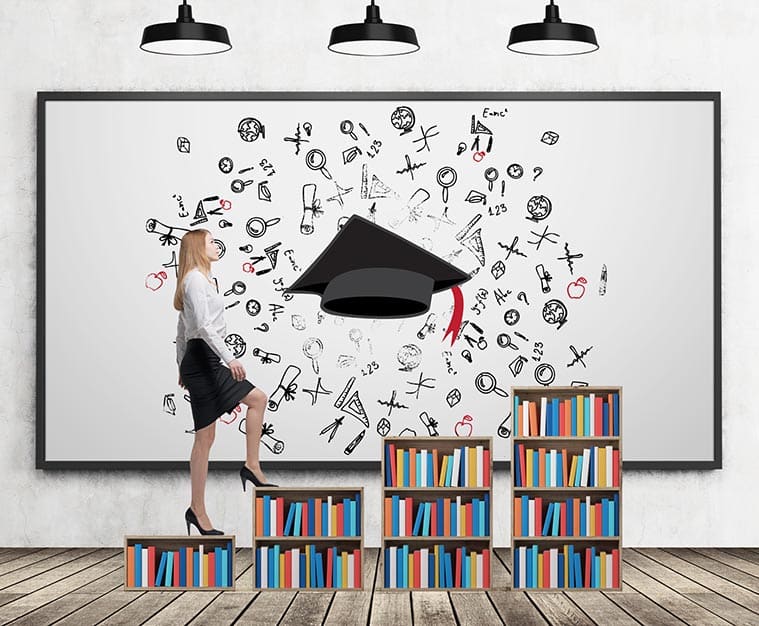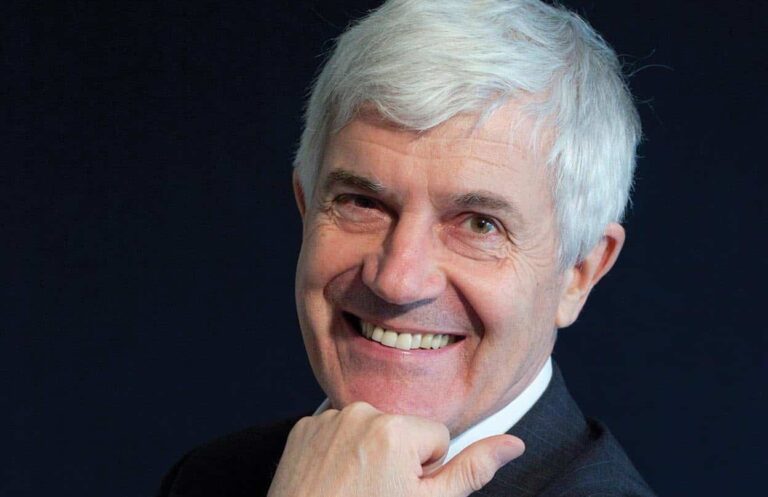Il est parfois difficile de maintenir un bateau entrepreneurial à flots, et une réussite une année peut se transformer en échec l’année d’après. Voici un classement des 10 PDG qui ont vu leur société être mis en redressement judiciaire durant ces 5 dernières années, et ce malgré un chiffre d’affaires remarquable l’année précédente.
Georges Horoks
Président d’une entreprise spécialisée dans les infrastructures informatique du nom d’Overlap, M. Georges Horoks enregistre un chiffre d’affaires de 149 millions d’euros en 2012, avant que sa société ne soit mise en liquidation en 2013. Cependant, Mr Horoks dirige, au total, 11 entreprises. Malgré les pertes d’emploi générées par la santé défaillante d’Overlap, ce président devrait rebondir !
Philippe Wehemeyer
En 1992 est créé la société « Score Game », une entreprise de jeux vidéo. En 2005, son fondateur rachète ADDON qui comprend 20 magasins. Puis, en 2007, c’est au tour de Maxilivres et de ses 158 magasins d’être racheté. En 2001, Score Game est acquis par le leader européen : Game. Mr Philippe Mehemeyer, directeur du secteur « France », connaît un chiffre d’affaires avoisinant 196 millions d’euros en 2010. En 2012, Game est racheté par OpCapita qui ne s’intéresse pas à la filiale française. En 2013, l’entreprise ferme définitivement…
Jérôme Bulte
246 millions d’euros, c’est le chiffre d’affaires que produit « Européenne Food » en 2011, une société de distribution alimentaire dont Jérôme Bulte est le président. En difficulté l’année suivante, la firme sera rachetée par Pomona en 2013, qui supprimera plus de 200 postes.
Francis Nourrier
Continentale Nutrition, dirigée par Francis Nourrier, est spécialisée dans la nourriture pour animaux. Un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros est enregistré en 2013. L’année suivante, l’entreprise est en redressement judiciaire.
Xavier Négiar
« Clestra », une société réalisant des cloisons métalliques, située en Alsace, enregistre un chiffre d’affaire de 200 millions d’euros en 2011. Cette entreprise à succès, dont Mr Xavier Négiar est à la tête, connaîtra malgré cela un redressement judiciaire l’année suivante.
Louis Gad
Mr Louis Gad fonde l’entreprise Gad en 1956, dont le secteur d’activité est l’abattage de porcins. En 2010, 2500 personnes sont employées et le chiffre d’affaires record sera de 455 millions d’euros en 2012. Aujourd’hui, dans un contexte de crise, malgré les bénéfices enregistrés, la société a dû licencier 889 personnes, suite à une liquidation judiciaire.
Thierry Léonard
Fagor Brandt, le spécialiste de l’électroménager, dont M. Thierry Léonard est le dirigeant, est en redressement judiciaire avant d’être racheté par Cevital, en 2014. L’année précédant ce déclin, la société enregistrait pourtant un chiffre d’affaires de 648 millions d’euros.
Thierry Le Hénaff
Thierry Le Hénaff, PDG de la société « Kem One », dont le secteur d’activité est la chimie, atteint un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros en 2011. Malgré tout, « Kem One » sera au cœur de l’actualité dès 2012, en faillite, avec des projections de licenciements, des manifestations syndicales et salariales en nombre dans les rues de Lyon.
Jean-Louis Demeulenaere
765,5 millions d’euros : c’est le chiffre d’affaires de Mory Ducros, entreprise de transport dirigée par Jean-Louis Demeulenaeres, en 2012. Suite à cette belle année, la société vacille et se trouve en redressement judiciaire avant d’être rachetée et rebaptisée MoryGlobal. Rien y fait, en 2015, la faillite est annoncée.