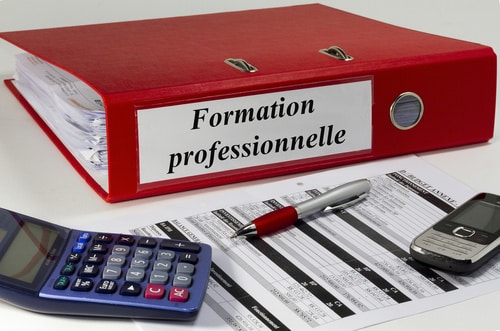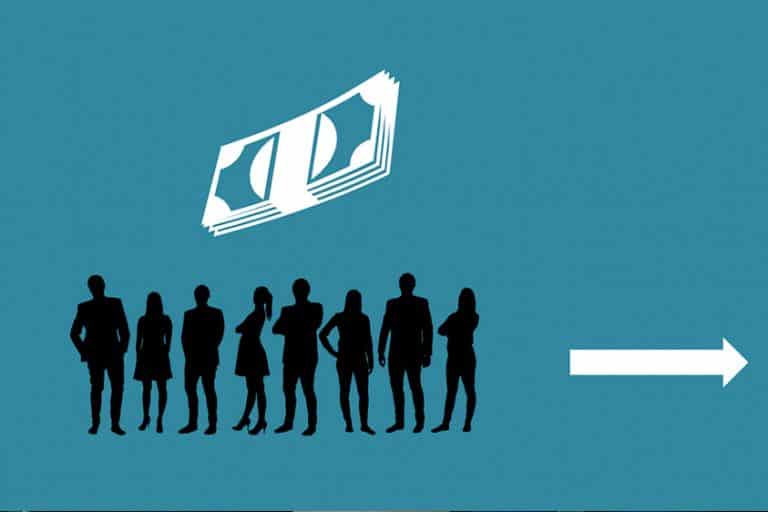Le 1er avril, ce n’est pas un poisson d’avril, la réforme de la formation entre en vigueur. Les nouveaux acteurs de la formation professionnelle c’est-à-dire les « opérateurs de compétences » (Opco), vont remplacer OPCA.
Ce sont des organes paritaires, gérés par les partenaires sociaux, qui ont pour mission :
- D’accompagner les entreprises de – de 50 salariés dans le développement des compétences
- De renforcer l’appui aux branches dans l’analyse des besoins et évolution des certifications professionnelles
- De financer les premières ouvertures de CFA ou sections d’apprentissage non conventionnés par les régions
Les arrêtés portent agrément au 1er avril de onze «opérateurs de compétences», les nouveaux acteurs de la formation professionnelle, sont parus le 29 mars au Journal officiel.
Cette réforme de la formation professionnelle prévoit que les 20 opérateurs paritaires collecteurs agréés («Opca») ne collectent plus les cotisations formation – transférées à l’avenir à l’Urssaf – et soient transformés en opérateurs de compétences («Opco»).
Treize dossiers d’agrément avaient été déposés fin décembre, mais le ministère du Travail n’en a que onze
Neuf opérateurs ont été acceptés sas difficultés :
1. Agriculture et agroalimentaire
2. Industrie
3. Construction
4. Mobilités
5. Commerce
6. Services financiers et conseil
7. Santé
8. Culture et médias
9. Cohésion sociale.
Cependant, le gouvernement avait refusé en janvier quatre projets qui faisaient l’objet de discussions intra-patronales et syndicales et leur a accordé deux mois aux branches concernées pour renégocier des accords correspondant à « des secteurs économiques pertinents ». La conclusion en est qu’il y aura :
- un opérateur des entreprises de proximité
- un opérateur des entreprises et salariés des services à forte intensité de main d’œuvre (secteur de l’intérim, de la propreté, de l’hôtellerie-restauration, etc.).
Quelles sont les branches qui entrent dans le champ d’application ?
- Convention collective nationale du bricolage, vente au détail en libre-service
- Convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet
- Convention collective nationale des entreprises de vente à distance
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d’alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution)
- Convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie
- Convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
- Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d’art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie (œuvres d’art)
- Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement
- Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure
- Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager
- Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires
- Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation exportation
- Convention collective nationale du négoce de l’ameublement
- Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique [et de librairie]
- Convention collective Nationale des professions de la photographie
- Convention collective nationale des jardineries et graineteries
- Convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail
- Convention collective nationale des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, “gérants mandataires” (grande distribution)
- Convention collective nationale du personnel de la reprographie