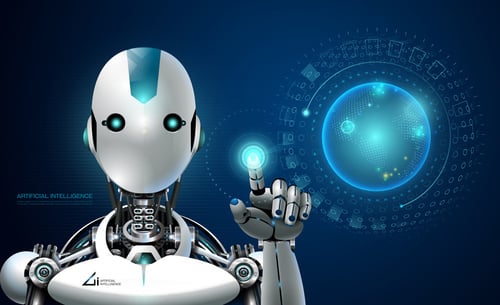Le Télétravail, les nouvelles méthodes de travail, la mobilité géographique vont-ils modifier l’investissement immobilier. Pour la 5e année consécutive, le réseau immobilier Optimhome, par le biais d’une étude menée avec l’Ifop, s’est penché sur le comportement des français concernant le marché de l’immobilier face aux enjeux socio-économiques.
L’enquête a été réalisée du 26 février au 4 mars 2019 par l’institut Ifop auprès d’un échantillon de 1 503 personnes représentatif de la population française âgée de 25 à 65 ans. Parmi elles : 330 Millenials (25-34 ans, nés entre 1984), 241 Xennials (35-41 ans, nés entre 1977 et 1983) et 424 Génération X (42-52 ans, nés entre 1966 et 1976)
Devenir propriétaire, toujours un engouement
Pour devenir propriétaire, l’endettement ne fait pas peur. En effet, Les Français sont prêts à s’endetter plus longtemps pour devenir propriétaires. Près de la moitié des personnes interrogées ont eu recours à un crédit de plus de 21 ans cette année (48%) contre seulement 32% en 2018. D’ailleurs, le recours à un crédit pour acquérir sa résidence principale est stable et toujours très élevé. 82% des personnes concernées y ont en effet eu recours c’est-à-dire un score identique à celui de 2018).
Quelle méthode pour trouver le bien immobilier ?
Les Français n’hésitent pas à utiliser tous les moyens qui sont mis à leur disposition : utiliser des portails d’annonces 73%, 67% le site PAP, 28% les applications pour smartphone ou tablette, et 22% les réseaux sociaux comme Facebook.
Cependant, l’importance des relations humaines est soulignée que ce soit des informations issues de professionnels de l’immobilier 71%. Mais l’impact des vitrines des agences immobilières est loin d’être négligeable 70%.
Pourquoi choisir un professionnel de l’immobilier ?
Les attentes à l’égard d’un conseiller immobilier sont plurielles : réactivité (25%) ; sa réputation (23%) ; la personnalisation de ses conseils (22%), et ses qualités d’écoute (22%). Toutefois, les services les plus attendus de la part d’un professionnel de l’immobilier sont avant tout financiers. Comme en 2018, 71% des Français attendent des professionnels de l’immobilier qu’ils fassent une estimation la plus fiable possible de la valeur du bien sur le marché (premier service cité parmi la liste proposée).
Le constat est que le recours aux professionnels de l’immobilier progresse fortement cette année, qu’il s’agisse d’un achat ou d’une vente : 68% y ont recours pour l’achat cette année et 74% pour la vente. Il est particulièrement significatif dans le cas de la vente de la résidence principale : il enregistre en effet une hausse remarquable sur trois ans (74% contre 62% en 2016).
Le digital, un appui pour trouver le bien immobilier
Dans la recherche de bien immobilier, le digital est apprécié pour ses services innovants et facilitateurs lors de la visite. Cependant, Il ne remplace pas la présence physique lors de l’étape clé de la signature.
La mobilité géographique, une incitation
Une forte proportion des Français envisagent la mobilité géographique est concrètement. 40% pourraient réaliser une mobilité géographique dans les cinq prochaines années. L’intention de mobilité n’est toutefois pas homogène selon les différentes catégories de population.
Les transports, un levier de mobilité
L’efficacité des moyens de transport (44%) constitue le principal levier permettant de déclencher une mobilité géographique, suivi par une plus grande facilité à être en télétravail (21%). Ce dernier constat démontre que, pour beaucoup de Français, la corrélation des conditions de travail plus confortables est étroitement corrélée à une perspective de mobilité géographique.
Bordeaux et Nantes toujours plébiscitées
Bordeaux et plus généralement l’Ouest de la France demeurent particulièrement attractifs pour investir dans l’immobilier. Elle arrive encore en tête (citée par 19%) devant Nantes (12%) qui précède cette année Paris (11%).
Le télétravail, un enjeu ?
Le lien entre enjeux immobiliers et télétravail est significatif. La pratique du travail à distance se trouve en effet chez 45% des acheteurs récents d’une résidence principale ; 55% de ceux d’un bien immobilier locatif, 54% des vendeurs d’une résidence principale et 58% de ceux d’un bien immobilier locatif. Or, près d’un tiers des Français actuellement en poste ont recours au télétravail (32%). La pratique du télétravail est différente selon les situations. Elle atteint 37% chez les Millenials, 62% chez les cadres et 41% chez les habitants de l’agglomération parisienne. Pour 72 % des 25-65 ans actifs occupés, le recours au télétravail incite à réaliser une mobilité géographique, dont 76% chez les femmes et 69% chez les hommes.
Le logement durable, un critère essentiel
La performance énergétique du logement s’impose de surcroît comme un enjeu dans l’immobilier. Ainsi, 85 % des Français estiment que la valeur d’un logement dépendra de sa performance énergétique dans l’avenir proche. Ils acccordent une attention particulière à l’espace environnant des habitations et aux politiques durables de la ville dans la décision d’achat des Français. Près de la totalité des 25-65 ans estime que la présence d’un espace vert à proximité est importante (91%). De même, plus de huit sur dix jugent « qu’une politique volontaire de la ville en faveur du développement durable, et notamment en matière de tri des déchets », est importante au moment d’acheter un bien immobilier (84%, +2 points).
Les mesures gouvernementales incitatrices :
La reconduction jusqu’en 2021 du prêt à taux zéro (PTZ) : 87% estiment que cela aura des conséquences plutôt positives ainsi que la suppression de la taxe d’habitation 82%.
La reconduction jusqu’en 2021 du dispositif de défiscalisation Pinel, qui permet à tout investisseur achetant un logement neuf dans le but de le louer, de bénéficier d’une réduction d’impôt (77%).