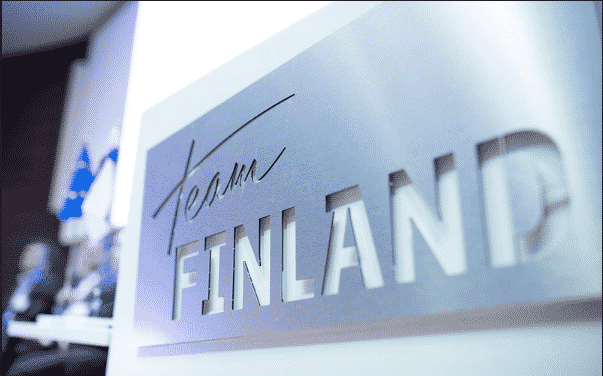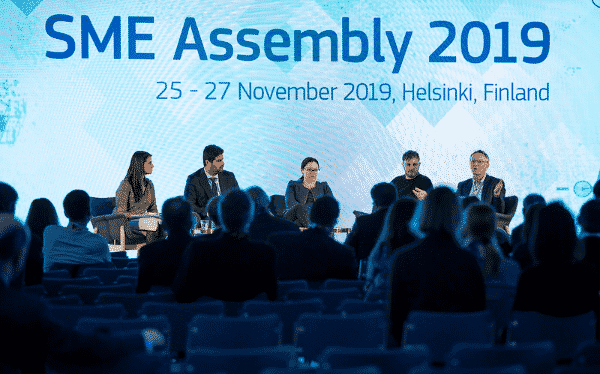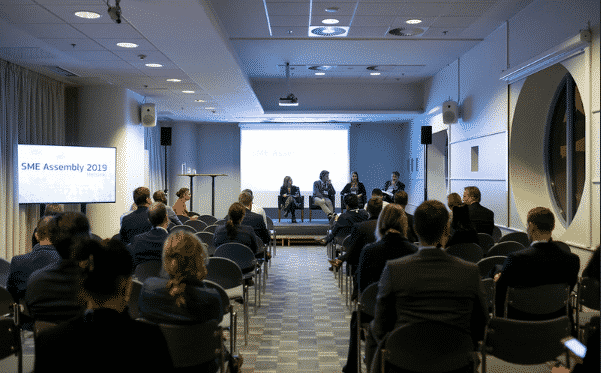Aujourd’hui, il faut bien le constater : le recrutement est devenu digital. Les smartphones permettent aux candidats de se connecter à toute heure et de chercher l’offre qui leur correspond, selon leur rythme de connexion qu’ils soient cadres, actifs ou jeunes à la recherche d’un premier emploi.
Si, les entreprises devaient poser une annonce dans plusieurs journaux afin d’atteindre le maximum de candidats, elles ont désormais de nombreuses opportunités grâce aux sites de recrutement. Elles peuvent aussi être aidées par des agences spécialisées afin de réaliser un recrutement ciblé avec un investissement peu élevé puisqu’une simple annonce leur permet d’entrer en contact avec une audience illimitée. On ne fait que le répéter les nouvelles technologies et la mondialisation ont apporté des changements radicaux dans nombre de domaines. Celui du recrutement, point crucial pour développer son entreprise et la rendre pérenne, est au centre des attentions.
Comment les talents cherchent-ils un job ?
Selon Charles-Henri Dumon, ancien dirigeant et l’un des fondateurs du groupe Michael Page :
« 2/3 des candidats citent les moteurs de recherche comme principal outil de recherche d’offres d’emploi. Ils naviguent à partir du titre de la fonction, suivi du mot « emploi » ou « job ». 30 % des recherches sur le mot « job » sur Google viennent d’un mobile. 40 % des candidats en recherche active utilisent un job board afin d’accéder à des offres. 1/3 des candidats vont sur les sites des entreprises qui les intéressent. Si votre stratégie de recrutement de talents n’est pas digitale et n’existe pas sur le mobile ? Vous n’avez aucune chance de recruter les meilleurs ! »
D’après Médiamétrie NetRatings dans sa synthèse des résultats de juillet 2019, 52,8 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois, soit 84,3 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 44,4 millions d’internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 70,9 % de la population française. Rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 29 minutes sur ordinateur et de 77 minutes sur mobile. Des chiffres qui sont révélateurs des nouveaux usages.
Une méthode de recrutement prédictive
Il ne s’agit plus de recruter seulement pour des postes vacants. La vitesse de transformation des entreprises implique de repenser la manière de recruter et d’anticiper les évolutions pour avoir les collaborateurs en place au moment où l’entreprise en aura besoin. Il est désormais nécessaire de recruter sur des postes dont vous ne maîtrisez pas toutes les implications et de déterminer les compétences dont l’entreprise aura besoin dans le futur. La difficulté peut paraître évidente car il se peut et il y a des fortes chances que le besoin ne soit pas encore explicite. Faute d’avoir anticipé les besoins , recruter au dernier moment peut s’avérer désastreux car une sélection dans la précipitation n’est jamais une bonne option et peut conduire une entreprise à mettre la clé sous la porte par manque de candidats compétents sur le marché.
Recruter mais où chercher les candidats
L’ordinateur et le mobile font partie de leurs habitudes et les sites qui se consacrent à proposer des offres sont devenus performants. Certains sites sont généralistes, d’autres axés sur un domaine…mais leur cible est explicite. Nous vous proposons ci-après une liste non exhaustive de sites qui vous permettront soit de trouver un emploi, soit d’insérer une annonce pour trouver vos collaborateurs. Puis une liste d’applications qui vous permettront d’optimiser vos recherches ou vos recrutements.
Les sites les plus connus
| Pôle Emploi | https://www.pole-emploi.fr |
| APEC | https://www.apec.fr/ |
| Cadre Emploi | https://www.cadremploi.fr/ |
| Indeed | https://www.indeed.fr |
| Monster | https://www.monster.fr |
| Jobijoba | https://www.jobijoba.com/ |
| Linkedin Jobs | https://www.linkedin.com |
| Welcome to the jungle | https://www.welcometothejungle.com/fr |
| Wiz bii | https://www.wizbii.com |
| Jobteaser | https://www.jobteaser.com/fr |
| Keljob | https://www.keljob.com |
| SimplyHired | https://www.simplyhired.fr |
| LesJeudis | https://www.lesjeudis.com |
| Google for Jobs | https://jobs.google.com/about/intl/fr_ALL |
| Meteojobs | https://www.meteojob.com |
| Qapa | https://www.qapa.fr |
Autres sites utiles pour vous aider dans votre recrutements
| FYTE4U | application mobile et plateforme web d’enregistrement de CV vidéo avec l’aide d’un prompteur. |
| LELAPS | ciblage précis des candidats grâce un algorithme qui propose la bonne offre à la bonne personne. |
| Kudoz | application mobile qui simplifie les processus de recrutement pour cadres, en fonctionnant avec système de « match » basé sur la géolocalisation et les compétences des candidats. |
| Doyoubuzz | plateforme de création et de partage de CV en ligne. |
| Sourcingo | plateforme d’assistanat RH 3.O pour l’acquisition de nouveaux talents (recherche de candidats, organisation des entretiens, visioconférences, questionnaires, etc.). |
| Golden Bees | plateforme qui permet de cibler ses campagnes de recrutement uniquement sur une audience qui correspond aux profils recherchés. |
| ScoringLine | outil d’aide à la sélection de candidats qui permet de trier une importante quantité de CV et lettres de motivation. |
| Assess First | test de personnalité Sharpe est un excellent outil d’aide à la sélection de candidat par rapport à leurs Quotients Emotionnels. |
| FYTE Intérim | application mobile qui permet la mise en relation entre les intérimaires et les entreprises, basé sur la géolocalisation et les compétences des intérimaires. |
| Emotient | software qui détecte et analyse les émotions sur les visages dans une vidéo. |
| Riminder | plateforme de recherche d’emploi basée sur un algorithme de deep learning qui fait correspondre le CV du candidat avec des offres d’emploi adaptées. |
| Upwork | plateforme de services à la demande qui met en relation les free-lance et les entreprises (photographe, Développeur, designer etc.). |