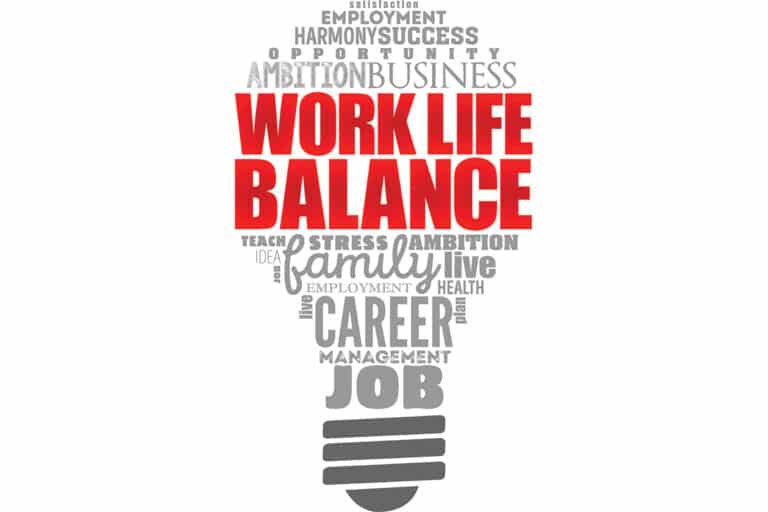De nos jours, toute entreprise se doit d’inclure une composante technologique dans sa stratégie commerciale si elle souhaite maintenir son avantage concurrentiel. Cependant, alors que les petites entreprises investissent facilement dans les dispositifs mobiles, PC et ordinateurs portables, elles sont peu nombreuses à s’intéresser aux bénéfices que pourraient apporter un serveur à leur société.
La technologie peut contribuer à l’essor des entreprises, mais les petites structures trouvent rarement le temps de la comprendre en profondeur et de saisir toutes ses possibilités. Beaucoup pensent à tort, par exemple, qu’un serveur ne convient qu’aux grandes entreprises et que son coût est élevé. Cela étant dit, quelle que soit sa taille, toute TPE-PME peut tirer profit d’un serveur.
Une solution à moindre coût
Soumises à des budgets restreints, les petites entreprises doivent veiller à utiliser leur budget correctement. Sur le plan IT, une petite société a tendance à investir dans un premier temps dans un serveur physique. Il s’agit de la première étape dans la création d’une infrastructure informatique sécurisée et robuste. Un serveur est conçu pour traiter des quantités de données et offrir un espace où les employés peuvent créer et alimenter des documents, des bases de données confidentielles, et également stocker et partager des applications et toutes sortes d’informations. Il garantit également la sécurité et le contrôle d’accès qui devient de plus en plus crucial quand l’entreprise se développe. Le serveur est un facteur clé pour la croissance. Il offre de nouvelles opportunités aux TPE/PME leur permettant de remettre au goût du jour leurs modèles d’entreprise et d’en créer de nouveaux, comme les sites de vente en ligne.
Un coût loin d’être excessif
Excellente nouvelle en cette période de crise pour les entreprises : le coût d’un serveur n’est plus prohibitif. Un retour sur investissement sera vite généré grâce aux gains réalisés par la simplification des méthodes de travail, engendrant plus d’efficacité et une productivité accrue. Une grande variété de serveurs s’offre aux TPE/PME. Pour un système standard il faut compter environ 300 euros, ce qui revient moins cher que beaucoup d’ordinateurs portables. Si l’entreprise a besoin d’une solution plus robuste (un serveur plus puissant, un disque dur de plus grande capacité, plus de mémoire, un processeur et un système d’exploitation plus rapides), le coût sera d’environ 1 000 euros.
Comment savoir s’il faut un serveur dans l’entreprise ?
Toute TPE/PME de deux employés minimum devrait envisager d’acquérir un serveur ou au moins à en prendre un partagé. Plus celle-ci embauchera et aura d’ordinateurs (dont les portables et les tablettes), plus il sera nécessaire d’automatiser ces opérations. Les entreprises se sentent de plus en plus concernées par la sécurité, la protection des données importantes et l’amélioration des méthodes de travail des employés. Il y a plusieurs signes, permettent d’alerter les sociétés quant à l’utilité d’investir dans un serveur :
1/ L’accès à l’information gagne de l’importance
Le premier signe indiquant qu’une entreprise a besoin d’un serveur est la demande croissante de ses employés de partager et d’accéder à des données et des fichiers importants, comme par exemple des bases de données clients qui étaient jusqu’à présent stockées au hasard sur les ordinateurs individuels. Les employés doivent constamment s’envoyer les documents par email et ne trouvent pas les fichiers quand ils en ont le plus besoin.
2/ Les ordinateurs commencent à s’essouffler
Tandis qu’un nombre croissant d’applications et de fichiers sont stockés localement sur les ordinateurs de chacun, ils commencent à saturer et à ralentir. Le démarrage des PC prend du temps, et au fil de la journée, l’ouverture des applications et des fichiers devient parfois de plus en plus lente. Pire encore, les employés peuvent devoir redémarrer leur PC lorsque leurs applications ne répondent plus. En outre, le nombre de plus en plus important de fichiers et d’applications utilisés peuvent occuper un espace considérable sur le disque dur. Les entreprises doivent donc, par manque d’espace, envisager de remplacer leurs disques durs par des modèles de plus grandes capacités.
3/ Les employés ont des besoins spécifiques en logiciels
Les TPE/PME commencent à investir de plus en plus dans des programmes spécifiques, comme des bases de données ou des logiciels de comptabilité, pour soutenir l’activité de l’entreprise et améliorer la productivité et l’efficacité des employés. Sans serveur, le logiciel doit être installé sur plusieurs ordinateurs et les licences coûtent chères. Les entreprises se rendent compte aussi que certains de leurs employés utilisent d’anciennes versions de logiciels et ne peuvent donc plus mettre à jour et partager facilement des documents avec leurs collègues.
4/ Les copies de sauvegarde sont devenues indispensables
Les entreprises commencent à prendre conscience que les ordinateurs de leurs employés contiennent de nombreuses informations essentielles et craignent que des données sensibles (telles que les coordonnées des clients ou des commandes récentes) soient perdues ou supprimées par inadvertance. Les employés n’étant pas forcément conscients de l’utilité de faire des sauvegardes régulières des données de leur ordinateur, les entreprises doivent réfléchir à automatiser le processus.
5/ Les employés ont besoin d’un accès à distance sécurisé
Dans le contexte actuel marqué par la mobilité, l’entreprise attend de ses employés qu’ils puissent travailler n’importe où et n’importe quand. Les sociétés reconnaissent de plus en plus leur besoin de se connecter au serveur depuis chez eux ou en déplacement. Pour autant qu’elles veuillent leur fournir un accès à distance, les entreprises craignent également pour leur sécurité et leur capacité à contrôler l’accès aux informations sensibles.
Les bénéfices de l’installation d’un serveur
En installant un serveur sous le système d’exploitation Windows Server 2012, les TPE/PME peuvent maximiser leur infrastructure, optimiser leurs opérations et améliorer considérablement la productivité des employés. Le serveur central de fichiers et de bases de données permet de partager des documents avec l’ensemble de l’entreprise et lui permet de contrôler son bien le plus cher : les données. Les employés peuvent facilement accéder aux fichiers à n’importe quel moment et ne perdent donc pas de temps à retrouver la personne qui possède cette information (comme une liste de contacts à jour, ou à se demander qui fut le dernier à travailler sur un document et s’ils détiennent la version la plus récente). Une autre raison d’investir dans un serveur dédié est la capacité d’effectuer un archivage et des copies de sauvegarde sur tout le réseau.
Mette en place des équipes
La collaboration est rendue possible par l’utilisation d’un réseau centralisé qui stocke les applications et les fichiers dans un espace sécurisé accessible à tous. Cela permet d’accorder des autorisations aux utilisateurs ou de limiter l’accès à certains, ainsi que de mettre en place des équipes collaboratives. Employés, partenaires et clients ont la possibilité de travailler ensemble dans un espace virtuel, de partager et d’imprimer des documents, et d’accéder à des informations telles que les bases de données, tableurs, chiffres comptables, outils de CRM, etc. Organiser des réunions devient facile grâce aux calendriers partagés en ligne entre les membres de l’équipe et vérifier ainsi rapidement les disponibilités de chacun. Les petites entreprises peuvent donc également installer des bureaux régionaux afin de mieux répondre aux attentes de leurs clients.
L’espace ?
Puisque tout se sauvegarde dans un serveur central, on libère de l’espace sur les ordinateurs de chacun. En d’autres termes, les postes individuels et les ordinateurs portables fonctionnent plus vite, rencontrent moins de problèmes et n’ont plus besoin de si grandes capacités de disques durs, ce qui permet de choisir des portables plus légers. On consacre ainsi un temps moins important à chaque ordinateur car l’assistance et les mises à jour de logiciels peuvent se réaliser via le serveur centralisé. Cela garantit également que tous les systèmes fonctionnent avec les versions les plus récentes et permet de réduire le nombre de licences d’utilisation.
Un point d’entrée unique fournit une meilleure sécurité. En effet, l’accès aux informations sensibles de l’entreprise est mieux géré et contrôlé. Il est ainsi possible de refuser l’autorisation à certains utilisateurs non enregistrés. Avec un tel degré de sécurité, il est possible de protéger toute l’entreprise contre les intrusions et les attaques. Cela permet aussi aux sociétés de remplir les exigences juridiques relatives au recueil de données et à leur conservation.
Quel est le serveur le mieux adapté aux TPE/PME ?
Un serveur ressemble beaucoup à un ordinateur de bureau mais il fonctionne de manière très différente. Contrairement à un PC classique, ses composants internes, y compris son disque dur, sa mémoire et ses processeurs, ont été spécialement conçus pour fonctionner 24/24, 7/7. Un serveur fonctionne avec des systèmes d’exploitation spécialisés conçus pour des applications et des utilisateurs multiples. Il existe beaucoup de serveurs différents sur le marché et leur prix varie en fonction de la puissance dont l’entreprise a besoin.
Que faire avant d’investir dans un serveur ?
Ainsi, avant d’investir dans un serveur, il est important de connaître le nombre et le type d’applications que l’entreprise a besoin d’utiliser, et combien de personnes devront y accéder. En général, pour une TPE/PME de moins de 25 employés qui souhaite simplement partager des fichiers et utiliser des applications quotidiennement, comme un serveur d’impression et un partage de documents bureautiques, un serveur tour équipé d’un processeur et de deux à quatre disques durs devrait suffire.
À un moment donné, les TPE/PME en pleine croissance devront acquérir un serveur plus performant ou envisager d’ajouter des serveurs supplémentaires. Par exemple, si l’accroissement de l’activité nécessite d’utiliser des applications supplémentaires, avec un volume de données important (comme Salesforce) ou héberger de grandes bases de données, un processeur beaucoup plus puissant sera nécessaire, tout comme des disques durs plus rapides. Dans ce cas, choisissez un serveur équipé de deux processeurs et de quatre à six disques durs.
L’augmentation du nombre des données et le besoin d’en stocker des quantités importantes nécessiteront des serveurs supplémentaires. À l’heure où les TPE/PME se diversifient et lancent des sites de vente en ligne, les entreprises auront besoin d’un serveur e-commerce sécurisé. Elles devraient également envisager d’augmenter le nombre d’applications commerciales (comme les livres comptables) et choisir un serveur consacré aux données, un autre pour les copies de sauvegarde et un autre pour le pare-feu.
Pour les entreprises en plein essor qui utilisent déjà des serveurs multiples depuis un moment et qui souhaitent continuer d’augmenter leurs applications, un serveur rack est le choix idéal. Celui-ci fournit une plus grande puissance, occupe moins d’espace s’il se trouve dans une armoire racks, simplifie la gestion des câbles et rend la gestion du refroidissement plus simple et plus efficace.
La taille de l’entreprise n’a pas d’importance
La taille de la structure n’a pas d’importance quand il s’agit d’investir dans un serveur. Un serveur offrira à une petite entreprise la tranquillité d’esprit, lui permettra de contrôler ses données, et à ses employés de mieux travailler ensemble et plus vite. Il préparera aussi la société à l’arrivée de nouvelles applications et de nouveaux services pour les clients. Au fur et mesure que l’entreprise se développe, l’évolutivité est possible grâce à l’ajout de nouveaux serveurs garantissant la capacité des TPE/PME à maintenir leur avantage concurrentiel.
Avant d’investir dans un serveur, les petites sociétés devraient s’associer avec un partenaire en qui elles ont confiance pour s’assurer que leurs décisions prises aujourd’hui appuieront leurs activités de demain. Elles doivent évaluer les activités actuelles et, avec l’aide de leur partenaire informatique, imaginer où elles pensent se retrouver dans cinq ans : de quels serveurs et applications elles risquent d’avoir besoin et comment elles vont les gérer.