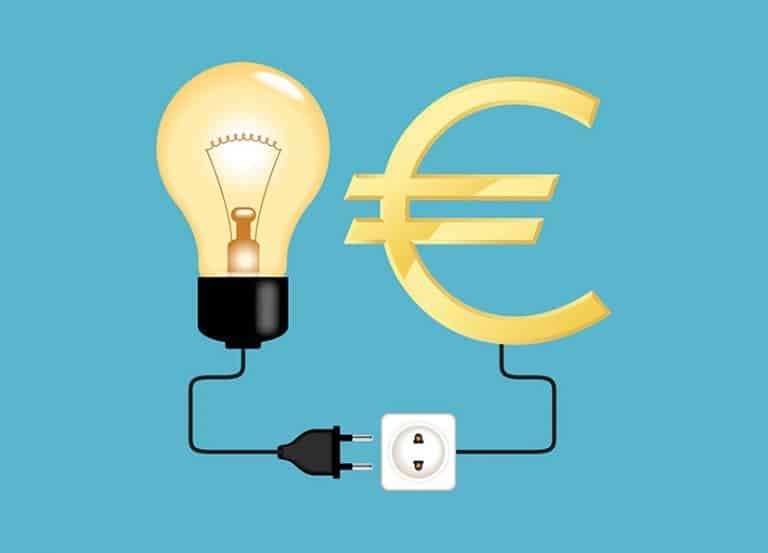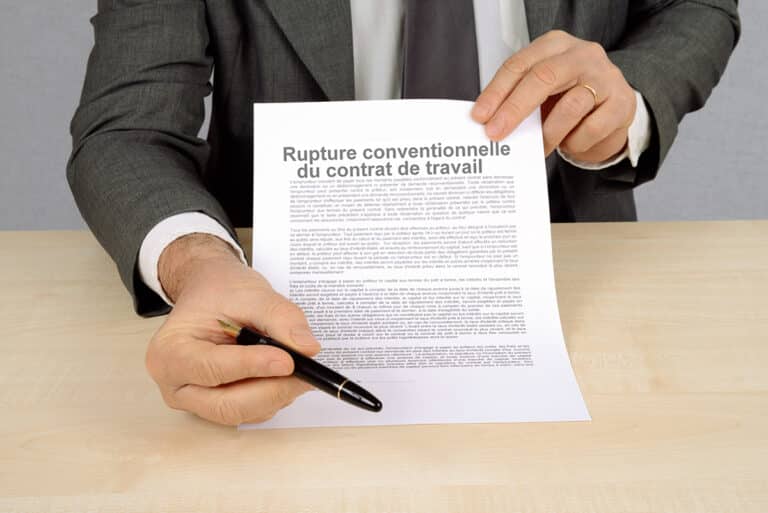Les droits, obligations et devoirs du porteur de projet dépendent de son statut. Quels sont les statuts du de projet ?
Certaines condamnations et les différentes statuts du porteur de projet peuvent affecter la possibilité d’entreprendre.
Le demandeur d’emploi
Le demandeur d’emploi indemnisé
Avant l’immatriculation, il continue de percevoir ses allocations, ses démarches en vue de créer son entreprise constituant des actes positifs de recherche d’emploi.
Il peut alors bénéficier des aides du Pôle emploi, des mesures d’accompagnement et de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) qui se traduit par une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
Une fois l’immatriculation effectuée et l’activité lancée, les allocations chômage ne sont plus versées au demandeur d’emploi indemnisé. Toutefois, leur maintien peut être accordé par le Pôle emploi sous conditions. Ainsi, il faut notamment qu’il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
En cas de cessation d’activité, il peut s’inscrire au Pôle emploi et retrouver le solde de ses droits pour une période correspondant à la durée des droits ouverts augmentée de trois ans et démarrant à la date d’ouverture desdits droits.
S’il est bénéficiaire de l’ACRE, il dispose d’une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
En savoir plus sur l’ACRE (article prochainement présent à partir du 5 octobre)
Le demandeur d’emploi qui n’est pas indemnisé
Il peut bénéficier de l’ACRE (exonération des cotisations sociales) pendant un ou trois ans sous conditions qu’il justifie d’une inscription au Pôle emploi pendant un semestre au cours des 18 derniers mois (*).
Il peut prétendre aussi à des mesures d’accompagnement ainsi qu’à l’application du dispositif NACRE comprenant une aide au montage de son projet personnel assortie d’un appui pour son financement
Le demandeur d’emploi non indemnisé, quant à lui, ne pourra se prévaloir que du dernier dispositif de celui indemnisé s’il est bénéficiaire de l’ACRE.
Le salarié
En cours de licenciement, le salarié peut profiter de son préavis pour préparer son projet personnel dès lors qu’il ne cause pas de préjudice à son employeur ni n’empiète sur son temps de travail. Assuré social, il peut bénéficier de l’ACRE qui se traduit par une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
Pour sa part, le salarié démissionnaire peut profiter de son préavis pour préparer son projet personnel dès lors qu’il ne cause pas de préjudice à son employeur ni n’empiète sur son temps de travail. Durant une année, il bénéficie du maintien de sa protection sociale mais il ne peut prétendre à l’ACRE à moins qu’il ne demande son inscription auprès du Pôle emploi et patiente 6 mois pour créer son entreprise. Toutefois, il ne peut bénéficier des allocations chômage mais, s’il s’inscrit comme demandeur au Pôle emploi, il pourra au bout de 4 mois obtenir une révision de sa situation et peut-être une indemnisation.
S’il est bénéficiaire de l’ACRE, le salarié démissionnaire dispose d’une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*). En cas d’échec de son entreprise, il aura droit aux allocations chômage s’il s’inscrit au Pôle emploi dans les 36 mois qui suivent la fin de son ancien contrat de travail.
Le salarié en poste peut préparer son projet personnel dès lors qu’il ne cause pas de préjudice à son employeur ni n’empiète sur son temps de travail. S’il justifie d’une ancienneté d’au moins 24 mois, il peut demander à bénéficier d’un congé création ou reprise d’entreprise. L’employeur peut alors décider de différer le départ en congé ou le refuser dans les entreprises de moins de 200 salariés s’il considère que cela aura des effets préjudiciables sur sa société ou concurrencera son activité.
S’il justifie d’une ancienneté d’au moins 24 mois, il peut demander à bénéficier d’un temps partiel ou complet pour création ou reprise d’entreprise.
S’il justifie d’une ancienneté de 36 mois et d’une activité professionnelle de 6 ans minimum, le salarié en poste peut demander à bénéficier d’un congé sabbatique que l’employeur peut reporter ou refuser sous conditions. À noter que, pendant un congé création à temps plein ou un congé sabbatique, le salarié ne perçoit aucune rémunération mais reste couvert pendant un an par le régime de la sécurité sociale.
Une fois l’immatriculation effectuée et l’activité lancée, le salarié en cours de licenciement est tout à fait libre de créer son entreprise si aucune clause contractuelle ne l’interdit. S’il a obtenu l’ACRE, il bénéficie d’une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions. En cas de cessation d’activité, il dispose de 36 mois à compter de la rupture de son contrat de travail pour demander l’ouverture de ses droits aux allocations chômage.
De son côte, le salarié en poste est tout à fait libre de créer son entreprise si aucune clause contractuelle ne l’interdit et si sa nouvelle activité ne concurrence pas celle de son employeur. S’il relève, au titre de sa nouvelle activité, du régime des non-salariés, ses revenus afférents aux deux activités seront imposés dans la catégorie correspondante. Pour son activité non salariée, le salarié en poste peut opter pour le régime de la micro-entreprise si ses recettes n’excèdent pas 32 000€ pour les prestations de service et 80 000€ pour les activités d’achat-revente et de fourniture de logements.
Socialement, le salarié en poste est tenu de cotiser aux régimes salarié et non salarié mais, si son activité salariée est exercée à titre principal, il échappe à la cotisation forfaitaire versée, à titre de provision, auprès de la Caisse d’assurance maladie des non-salariés. Il s’acquittera de ses cotisations l’année suivante selon ses revenus réels. À noter qu’il peut aussi opter pour le régime de l’auto-entrepreneur pour disposer notamment d’une parfaite connaissance du montant des charges sociales et fiscales à payer.
Le titulaire du RSA
Avant l’immatriculation, le titulaire du revenu de solidarité active (RSA) peut à la fois préparer son projet et percevoir le RSA. Bénéficiaire des prestations maladie et de la protection contre les accidents survenus à l’occasion des actions d’insertion, il peut prétendre aussi au dispositif NACRE comprenant une aide au montage de son projet assortie d’un appui pour son financement ainsi qu’à l’ACRE qui se traduit par une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
S’il est bénéficiaire de l’ACRE, le titulaire du RSA se voit appliquer une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*). Le montant du RSA est recalculé à chaque trimestre en tenant compte des revenus d’activité perçus. Il bénéficie enfin du maintien d’un montant dit « forfaitaire garanti » variant selon la composition de son foyer.
L’ayant-droit d’un assuré social
Avant l’immatriculation et s’il a été inscrit au Pôle emploi durant un trimestre sur les 18 derniers mois, il peut bénéficier de l’ACRE qui se traduit par une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
Une fois son activité lancée et la société immatriculée, il cesse d’avoir qualité d’ayant droit et fait sien le statut social correspondant à sa nouvelle activité. S’il est bénéficiaire de l’ACRE, il se voit appliquer une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
Le jeune âgé de moins de 26 ans, sorti du système éducatif
Ayant droit d’un assuré social, en situation de maintien de droit ou bénéficiaire de la CMU, il peut bénéficier de l’ACRE qui se traduit par une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*). Il peut aussi prétendre au dispositif NACRE comprenant une aide au montage de son projet assortie d’un appui pour son financement.
Une fois son activité lancée et la société immatriculée, il se voit appliquer, s’il est bénéficiaire de l’ACRE, une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
L’étudiant
Ayant-droit de ses parents jusqu’à 20 ans et bénéficiaire au-delà du régime Etudiant de sécurité sociale, il peut avant immatriculation bénéficier d’une double aide s’il répond aux conditions d’accès aux contrats emploi-jeunes : l’ACRE qui se traduit par une exonération des cotisations sociales pendant un an et le dispositif NACRE comprenant une aide au montage de son projet assortie d’un appui pour son financement.
Une fois son activité lancée et la société immatriculée, âgé de plus de 20 ans, il dépend grâce à sa nouvelle activité du régime des non-salariés qui le dispense du paiement des cotisations d’assurance maladie d’après l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale. Il est toutefois tenu de s’acquitter des cotisations d’allocation familiale, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et des cotisations retraite.
S’il est bénéficiaire de l’ACRE, il se voit appliquer une exonération des cotisations sociales pendant un ou trois ans sous conditions (*).
Le retraité
Avant l’immatriculation, il peut préparer son projet personnel, percevoir sa retraite et bénéficier d’une couverture sociale en rapport avec sa précédente activité.
Une fois son activité lancée et la société immatriculée, il peut cumuler emploi et retraite s’il est âgé d’au moins 60 ans, justifie d’une durée d’assurance ouvrant droit à une retraite à taux plein et a procédé à la liquidation de toutes ses pensions de vieillesse.
Même si le retraité ne satisfait pas à ces conditions, il peut toujours cumuler pension de retraite et revenus issus de son activité indépendante.
S’il se trouve rattaché au régime des travailleurs non-salariés (TNS), il est tenu de cotiser à ce régime et sa retraite de base sera suspendue si ses revenus professionnels dépassent 17 154€ pour le commerçant ou l’artisan retraité ou 34 308€ pour le professionnel libéral retraité. Sa retraite complémentaire sera maintenue s’il appartient à la seconde catégorie et suspendue s’il fait partie de la première. Plus simplement, s’il se trouve rattaché au régime des salariés, il peut créer son entreprise et percevoir l’intégralité de sa pension retraite, de base et complémentaire.
Si le retraité est un ancien salarié et s’il se trouve rattaché au régime des TNS, il peut créer son entreprise et percevoir l’intégralité de sa pension retraite, de base et complémentaire.
S’il se trouve rattaché au régime des salariés, sa retraite de base sera suspendue dans le cas où ses revenus professionnels dépasseraient son dernier salaire brut d’activité ou un plafond qui correspond à 160% du SMIC en vigueur. Sa retraite complémentaire sera également suspendue.
En cas de cumul, le retraité devra s’acquitter de cotisations « retraite » envers le régime de base compétent sans que ces cotisations ne lui ouvrent de droits.
Le fonctionnaire et assimilé
Avant l’immatriculation, il peut demander à bénéficier d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise pour une année maximum, renouvelable une fois.
Il peut aussi demander une mise en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise pour une année maximum, renouvelable une fois. Une fois son activité lancée et la société immatriculée, le fonctionnaire peut cumuler pendant 2 ans maximum, période renouvelable un an, son emploi et la création ou la reprise d’une entreprise commerciale, artisanale ou agricole. À cette fin, il doit adresser deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’entreprise une déclaration écrite à l’autorité administrative. Ensuite, l’administration procède à la saisine pour avis de la commission de déontologie qui veillera à la compatibilité de l’activité concernée avec les fonctions de l’intéressé.
Le cumul n’est pas limité dans le temps s’il concerne la production d’oeuvres de l’esprit ou l’exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions exercées par les personnes pratiquant des activités à caractère artistique et par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement.
Si le fonctionnaire relève de la fonction publique d’Etat et quitte ses fonctions pour créer ou reprendre une entreprise, il peut prétendre, sous conditions, à une indemnité correspondant au montant maximal de 2 ans de rémunération brute annuelle, montant qui ne peut être modulé selon l’ancienneté de l’intéressé. À noter que ce dispositif ne vaut pas pour le fonctionnaire à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de son droit à pension de retraite.
(*) L’exonération au titre de l’ACRE peut être prolongée durant deux années supplémentaires en cas de création ou de reprise d’une entreprise individuelle soumise au régime fiscal de la micro-entreprise et sous condition de revenus.