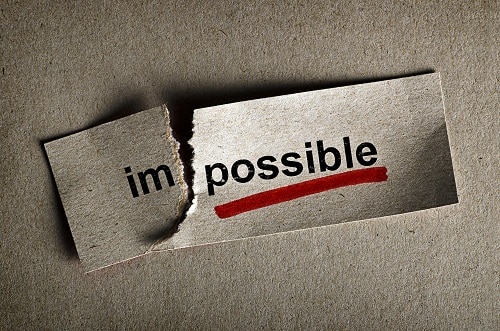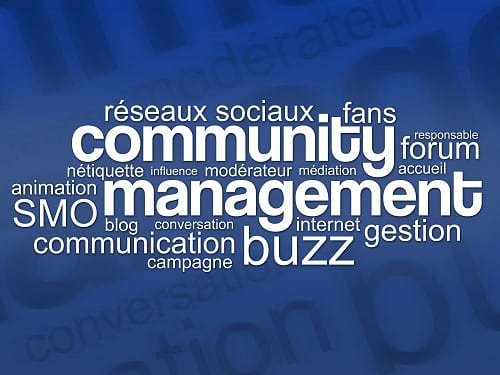Concilier nouvelles technologies et RSE est possible mais surtout indispensable, tant les directions informatiques des firmes sont consommatrices d’énergie. Le sujet est complexe et beaucoup de pistes sont à explorer, allongement de la durée de vie des appareils, Cloud Computing… Voici quelques explications sur le sujet pour éviter les pièges et les idées reçues.
Du green encore du green…
Le green IT ? Encore du « green » pour se prévaloir d’une image verte… ?
Non, nous ne parlons pas de « greenwashing » cette fois mais bien de green opérationnel et concret…où les nouvelles technologies se mettent au service de la politique et de la performance RSE de l’entreprise. Le Green IT est une démarche d’amélioration continue qui vise à réduire l’empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Jusqu’à récemment, les directions informatiques ne se sentaient pas réellement concernés par le sujet de la RSE, mais la crise économique aidant, la plupart des entreprises se sont lancées dans le sujet, avant tout motivées par des raisons financières. Même si cette approche fait la critique des puristes de la RSE, celle-ci est avant tout une démarche de performance globale de l’entreprise : alors, quand on peut allier économies financières, et protection de l’environnement, pourquoi s’en priver ?
Concrètement, comment l’informatique peut-il apporter des réponses concrètes ? Etudions ce sujet de plus près…
La DSI au cœur des enjeux de la RSE
En 2009, les techniques de l’information et de communication (TIC) consommaient 13,5 % de l’électricité en France… Un chiffre édifiant que l’on retrouve aussi à l’échelle d’une entreprise : en 2008, chez Axa, la Direction Informatique représentait 46 % de la consommation électrique du groupe !
Autant dire que les enjeux financiers de l’informatique écoresponsable sont très importants…
La DSI (Direction des Services Informatiques) se retrouve ainsi au centre de nouveaux enjeux : à la fois au cœur des enjeux financiers comme source de réduction des coûts, et des enjeux environnementaux en participant à la réduction des consommations d’énergie et des impacts environnementaux.…mais de quels types d’impacts parlons-nous ?
Combattre les idées reçues…pour avoir les bons leviers d’actions
Contrairement aux idées reçues, les impacts environnementaux significatifs des TIC ne se concentrent pas sur la phase d’utilisation des ordinateurs mais à 80 % sur la phase de fabrication et de fin de vie (source CNRS, GreenIT.fr d’une étude ADEME) : autant dire que la question de l’efficience énergétique mise en avant à toutes les sauces aujourd’hui, est une « goutte d’eau dans la mer » en caricaturant légèrement…
Le green IT soulève un des défis majeurs de la RSE aujourd’hui : être capable de mettre nos forces d’actions là où les enjeux sont les plus importants !
Laissons les chiffres parler d’eux-mêmes : pour un serveur de PME de 450 W avec écran (20 pouces environ), la fabrication émet environ 1500 kg CO2eq alors que la phase d’utilisation, en émet environ 2 500 kWh par an, soit 250 kg CO2eq ! (source ADEME, Green It.fr).
Emissions de CO2 donc, mais pas que…
L’étude de l’ ADEME, démontre, par une analyse de cycle de vie multicritères, que les deux enjeux environnementaux les plus importants ne sont pas les émissions de CO2 mais bien la toxicité des produits et l’épuisement des ressources non renouvelables : face à de tels constats, il est d’une évidence implacable que le geste le plus efficace pour réduire les impacts environnementaux est d’allonger la durée de vie des équipements, or, la durée de vie des ordinateurs depuis 1985 jusqu’à aujourd’hui a considérablement diminué passant de 11 ans à une moyenne de trois à cinq ans(source Green It.fr) !
Aujourd’hui, comme le souligne l’expert en France sur le sujet, Frédéric Bordage, « concentrer tous nos efforts sur l’efficience énergétique des Data Center est une aberration écologique, si l’on veut réduire l’empreinte environnementale du système informatique, il faut allonger la durée de vie active en travaillant sur la partie fabrication des équipements, c’est cela très clairement qui sera le plus impactant…. ».
Au niveau de la gestion des logiciels, Frédéric Bordage insiste sur un aspect essentiel mais totalement méconnu des petites entreprises et du grand public : « savoir bien gérer ses logiciels autrement dit ne pas mettre systématiquement à jour les versions est capital, les mises à jour, à moins qu’elles ne soient essentielles pour la sécurité, consomment beaucoup de mémoire vive et elle sont le principal facteur d’obsolescence programmée des serveurs ». Et Frédéric d’ajouter, « Si la DSI gère correctement son système information, elle n’a pas forcément besoin de le mettre à jour si cela fonctionne : if it works, don’t fix it ! »
Enfin, travailler sur l’éco conception des logiciels dans une logique d’éco-efficience permet de rechercher le meilleur équilibre entre la qualité de service optimal et les ressources utilisées : « il ne sert à rien de mettre trop d’énergie sur des fonctionnalités inutilisées » martèle Frédéric, pour qui l’écoconception et la concentration sur les besoins essentiels des utilisateurs sont la clef du Green IT. Quand on pense, que les utilisateurs utilisent 5 % des fonctionnalités du logiciel Word, on marche sur la tête !
En parlant d’écoconception, la directive ERP (Energy Related Product), dont on attend la prochaine version fixe notamment un cadre en la matière sur les produits consommateurs d’énergie : elle fixera des normes de consommation électrique mais définira aussi certainement les contraintes écologiques du produit tout au long de son cycle de vie. Ainsi, elle va se rapprocher des seuils techniques d’énergie du label Energy Star 5.0 for Computer, version cinq…Aujourd’hui, ce label, non obligatoire, indique une consommation de 2 watts heure, les objectifs de consommation avec l’ERP devraient être réduits à 0,5 watt heure en 2013.
Néanmoins aujourd’hui, le label Américain EPEAT américain de type 2 est aujourd’hui le label le plus abouti, selon Frédéric Bordage : « c’est une auto-déclaration et un référentiel reconnu au niveau international, il couvre le cycle de vie complet, et quasiment tous les modèles d’ordinateurs professionnels, il intègre pas moins de 40 critères environnementaux, notamment ceux du label Energy star, plus connu des professionnels et du public averti sur le sujet… ».
Si on ajoute aussi le label Blue Angel Allemand pour les imprimantes, on peut dire que la DSI a l’embarras du choix dans ses critères d’achat, d’autant plus que selon Frédéric « il n’y aurait pas de réel surcoût à l’achat»…
Les achats, au-delà des labels qu’ils peuvent exiger dans les cahiers des charges, peuvent être un excellent levier d’action pour faire avancer le sujet notamment au niveau social : en incitant à acheter des ordinateurs et des équipements reconditionnés plutôt que neufs, l’Ecolabel Ordi 2.0 porté par l’Etat permet notamment de lutter contre la fracture numérique et facilite l’accès de ces équipements à bas prix à des publics en difficulté économique ou sanitaire.
Mais la DSI n’est pas nécessairement aux commandes des achats, ni responsable des actions des constructeurs. Elle est avant tout responsable de l’efficience énergétique de ses centres de données… et là, elle a un rôle fondamental à jouer …
Une question qui fait controverse : le cloudcomputing
Jusqu’à récemment, l’entreprise était engagée dans une orgie de dépenses énergétiques et financières pour la gestion de ses centres de données et il a fallu attendre d’être aux pieds du mur pour retrouver un tant soit peu de logique dans notre gestion de l’énergie : même si ce n’est pas ce qui a le plus d’impact en matière d’environnement aujourd’hui, il est essentiel de continuer à progresser sur ces questions de consommation énergétique, car les solutions dignes des meilleures recettes de nos grands-parents existent et relèvent la plupart du temps du GBS, « Gros Bon Sens ».
Une panoplie de solutions techniques est à notre disposition et les progrès de ces dernières années sont indéniables : dernière en date, le Cloud Computing, basée sur la virtualisation : deux grands mots bien complexes, pour le « non amateur »…
Selon les dires d’experts, la virtualisation permet à plusieurs serveurs virtuels de tourner sur un seul serveur physique, le Cloud ajoute à cette virtualisation une couche d’abstraction logicielle qui masque l’infrastructure physique : plus simplement, en mettant en commun les ressources informatiques, ce système permet aux entreprises de réduire leur empreinte sur l’environnement et leur consommation énergétique.
Néanmoins, si la mutualisation des ressources informatiques réduit l’empreinte carbone en théorie, il n’y a pas d’étude sérieuse aujourd’hui qui le prouve : le sujet reste complexe et fait controverse parmi les experts du milieu du green IT.
Pour Frédéric Bordage, « rien ne prouve que la mutualisation est green, cela va dépendre du taux de mutualisation ; il peut y avoir un effet rebond sur la qualité du service rendu, pour avoir un niveau de disponibilité des données important et un niveau de service supérieur, les opérateurs doivent multiplier les serveurs et les centres informatiques ». Oui, certes, mais comme le précise bien Jérémy Cousin de CIV, une entreprise qui héberge des sociétés de Cloud, spécialisée dans le Green It, dans le Nord pas de Calais « dans le cas du Cloud pur, où les entreprises n’ont plus aucun outil informatique, et demandent à une société tiers de sécuriser les contrats au maximum pour assurer la continuité en cas de problème, les infrastructures et centres informatiques sont doublés, et cela ne va pas dans le sens de la protection d’environnement ». Mais dans le cas du Cloud privé qu’il propose, les entreprises restent propriétaires de leurs machines et de leurs investissements, ils ne font qu’externaliser leur hébergement : « et dans ce cas, point de nécessité de multiplier par deux les infrastructures et les centres informatiques, et là, la mutualisation prend tout son sens surtout quand elle est effectuée sur le modèle du green IT » renchérit Jérémy.
Jérémy Cousin de CIV, est affirmatif : « notre modèle est construit sur le Green IT, nous divisons la facture énergétique de nos clients par deux, une PME en utilisant notre hébergement, divise par deux sa facture énergétique passant de 60000 euros par an à même pas 30 000 € ! Sans compter les coûts de maintenance, qui sont évidemment mutualisés, tout ça allant dans le sens d’un gain financier et de la protection de l’environnement » et Jérémy de rajouter passionné : « dans notre propre entreprise, notre facture énergétique a été divisé par trois, grâce au free-cooling, un système qui permet d’utiliser la température extérieure du dehors pour refroidir l’eau : notre positionnement géographique à Lille est très favorable, car rien qu’avec 2° d’écart sur Paris, nous gagnons 50 jours de froid en plus ! ». Autant dire que CIV est vraiment engagée dans une chaîne de valeur RSE, d’autant plus que Jérémy mène actuellement des études pour passer à de nouvelles énergies, comme la pile à combustible et la biomasse et se prémunir de l’énergie nucléaire.
Et il rajoute que selon lui le Cloud, permet d’être au plus juste du besoin de l’entreprise, et de diminuer le renouvellement du parc informatique : «le Poste de travail n’a plus besoin de mises à jour, il redevient un terminal passif et donc le Poste s’use moins » précise Jérémy. Une affirmation justifié par un chiffre clé qui parle de lui-même : « avant, nous changions de machines tous les trois ans aujourd’hui tous les 6 ans » conclut Jérémy.
Des arguments plutôt convaincants… : le Cloud fait indéniablement avancer la RSE dans le bon sens mais il faut être vigilant et encore une fois actionner les bons leviers techniques sans oublier les comportements…
Ne pas oublier les comportements…
Pour progresser dans la RSE et dans les prises de conscience, le Green IT est un formidable levier symbolique pour faciliter le changement culturel et comportemental…
En pointe dans ce domaine en France, La Poste et la Caisse des Dépôts mettent aujourd’hui à la disposition de leurs équipes un guide de bonnes pratiques sur les écogestes qui permettent de limiter l’impact des matériels informatiques sur l’environnement et de mieux maîtriser la consommation électrique courante des postes informatiques.
Ce guide, conçu autour d’une dizaine de planches très parlantes et pédagogiques, présente des exemples concrets du quotidien : utilisation de la messagerie électronique, stockage des données, impressions, consommations énergétiques du poste de travail, etc. « Son objectif est de faciliter l’appropriation des bons réflexes par tous les collaborateurs, grâce notamment à l’accent porté sur les gestes simples que chacun d’entre-nous peut appliquer, tout en conservant voir en améliorant son confort d’usage des équipements » déclare Bénédicte Geinaret, responsable Qualité, risques et RSE à la Poste.
Encore des gestes de bon sens, la plupart du temps…mais ces éco-gestes ne sont qu’une toute petite partie de l’ensemble des domaines connexes concernés par la Green IT…
Un sujet très vaste…et une route encore longue…
Consommation responsable de papier, recyclage des consommables, gestion technique centralisée des bâtiments, optimisation des transports, communication unifiée, visioconférence et téléprésence, etc. …autant de sujets concernés par la Green IT…
La dématérialisation des supports est par contre une sujet bien plus complexe qu’il n’y paraît : « quand on passe d’un support vers un process informatique c’est-à-dire un logiciel, cela peut être intéressant, mais quand on passe d’un document papier à un document numérique alors cela ne vaut pas forcément le coût…et peut même être une aberration écologique, cela va dépendre du scénario d’usage et du nombre de facture concernées »…conclut Frédéric Bordage, un vrai passionné du sujet qui a même écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, « Ecoconception web : les 100 bonnes pratiques pour l’éco-conception logicielle ».
Toute la complexité de la RSE dans sa splendeur ! Penser global et cycle de vie est essentiel pour être sûr de ne pas déplacer les problèmes…simple sur le papier, plus complexe dans la réalité….
En tout cas, ce qui est certain, c’est que la route est certainement encore très longue avant d’afficher un bilan vraiment vert…
A vous de vous faire votre propre avis…mais n’utilisez pas l’argument de la complexité pour ne rien faire…