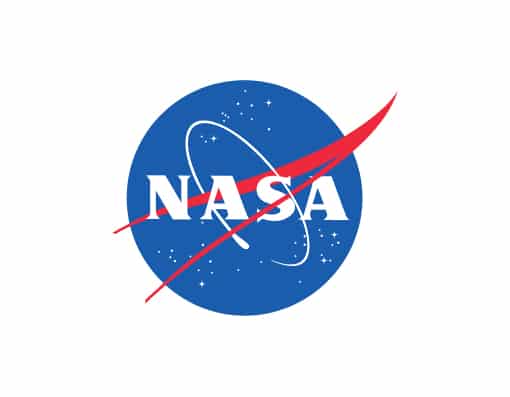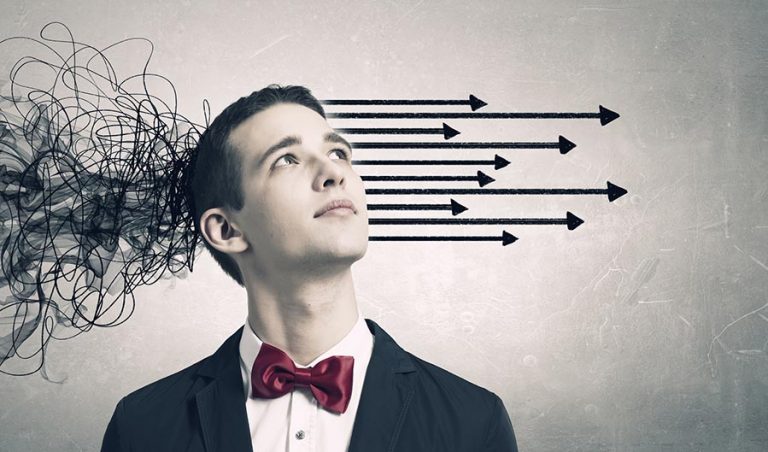Christophe Auvray, c’est l’aventurier-entrepreneur. Les péripéties ne lui font pas peur et il a appris à développer audace, prudence et sagesse pour garder son indépendance. Portrait.
Quel est votre parcours avant la création de votre entreprise ?
Depuis 30 ans, je suis multi-entrepreneur et j’ai vécu d’incroyables aventures.
Diplômé de l’ESSEC en 1984, je suis entré chez IBM, une société extrêmement performante à l’époque, attiré par le formidable développement de l’informatique. J’y ai appris le métier d’Ingénieur commercial « Grands Comptes ». Au bout de trois ans, ayant acquis l’expérience et la connaissance nécessaire du marché, j’ai lancé ma propre société dans la location de grands systèmes informatiques.
À cette période, les besoins informatiques des entreprises explosaient et les opportunités commerciales étaient florissantes. J’étais principalement sollicité par mes anciens clients du secteur bancaire. Au-delà de ce paradoxe, ils aspiraient à un financement souple de leurs investissements informatiques, pratique peu répandue à l’époque.
Lorsque j’ai créé cette première structure LOCFI en 1987, j’avais 26 ans, ma femme était étudiante et nous avions déjà deux jeunes enfants. À l’époque, pas internet, pas de Smartphone, pas de Business Angels … Autant dire que le challenge était réel !
Qu’avez-vous fait ensuite ?
Pour financer les gros contrats de location, je me suis rapproché d’une société, Computel, qui fédérait un réseau de loueurs sur la France entière. C’était une véritable aventure qui s’est développée très vite avec une équipe engagée et dynamique, ce qui m’a permis d’acquérir, entre erreurs et coups de génie, tous les bons réflexes. Dans la foulée, j’ai racheté deux autres sociétés me permettant de financer d’autres équipements informatiques.
En 1995, les constructeurs informatiques ont repris leur marché en main développant une offre agressive de financement. J’ai décidé opportunément de vendre les deux dernières sociétés acquises, mais les difficultés financières de mon partenaire, Computel, ont entraîné la faillite de ma première société alors qu’elle était largement bénéficiaire. J’ai alors décidé de me tourner vers l’international en intégrant une société anglaise de services informatiques pour salles de marché en tant que Responsable pour la France. Deux ans après, j’ai pris un poste de Directeur financier pour l’Europe du sud d’une filiale de Fujitsu, qui fabriquait des grands systèmes informatiques.
Malgré l’intérêt du poste, des déplacements en Europe et dans la Silicon Valley, l’appel de l’entrepreneuriat a été le plus fort. En 1999, j’ai décidé de créer la société DFI Lease, toujours dans le financement technologique mais en m’associant à un acteur dynamique du marché, le Groupe DFI. En tant que DG et actionnaire, j’ai développé l’activité de 0 à 15 millions d’euros grâce à des solutions innovantes, ce qui nous a permis de surmonter allègrement l’explosion de la bulle internet en 2001 !
Que s’est-il passé ensuite ?
Arrivant à la limite de ce business model et sentant arriver la crise de 2009, j’ai organisé la cession de l’entreprise à un concurrent sous LBO qui s’est conclue une semaine avant la faillite de la banque Lehmann Brother. Je suis resté un an pour accompagner la fusion. En 2001, en parallèle de mon activité au sein de D.F.I. Lease, j’avais créé PLIOS une société de consulting avec laquelle j’ai aidé le Groupe D.F.I. à se réorganiser.
PLIOS est toujours opérationnelle à ce jour et c’est grâce à cette structure que j’interviens auprès de dirigeants d’entreprise. Ma mission est de les accompagner dans toutes les phases de la vie d’une entreprise (création, développement, transformation, gestion de trésorerie, rachat/cession) sous forme de missions de conseil ou de management de transition.
C’est ainsi qu’entre 2013 et 2015, j’ai été Président d’une FinTech HLF (plateforme de web leasing innovante) au développement fulgurant (115 M€ de chiffre d’affaires en cinq ans). J’ai accompagné à cette occasion le rachat de HLF par un fonds d’investissement. Toujours à la recherche de nouvelles opportunités, j’ai créé l’an passé, une société immobilière ChambrApart, qui achète et rénove des appartements pour la colocation de jeunes actifs en région parisienne.
Profil multi casquettes vous êtes intervenus sur deux créneaux : informatique et financement. Pourquoi ces secteurs ? Pourquoi l‘entrepreneuriat ?
L’informatique demeure un secteur en permanente ébullition, on ne s’y ennuie jamais, la réalité dépasse toujours l’imagination. Mais il faut rester dans le mouvement et comprendre les évolutions. Ce côté nouveauté, innovation, stimulation implique de prendre des risques ; on peut rater une opportunité mais on peut surfer sur la vague suivante. Lorsqu’on arrive à rebondir à chaque fois, c’est la plus géniale des aventures.
Le financement reste un domaine à la fois normé et permettant une grande créativité pour trouver des solutions évolutives à des problématiques d’investissements technologiques.
Aujourd’hui, j’interviens dans d’autres secteurs comme la distribution, l’immobilier ou le service aux entreprises. J’y apporte mon expérience digitale, mes réflexes d’agilité et d’organisation, que d’autres secteurs découvrent. Le monde informatique est intéressant car on est passé du matériel/logiciels aux services/solutions fusionnant aujourd’hui avec la téléphonie, les réseaux, la bureautique et ce, dans tous les secteurs économiques (banques, industrie, santé…) tout en intégrant sans cesse de nouvelles technologies (objets connectés…). Depuis l’apparition du Smartphone, le digital est en train de bouleverser complètement nos modes de vie et de travail passant de la possession à l’usage, le tout à portée de main, partout.
Quelle différence avec l’entrepreneuriat ?
L’entrepreneuriat, c’est pareil mais avec la dimension humaine en plus. Quand on créé, on est petit, avec peu de moyens mais ambitieux, curieux, malin, rapide. Il faut aussi être prudent et humble. Des belles boites s’étant développées rapidement, se sont « plantées » en un rien de temps. On peut aussi faire de mauvaises rencontres dans le monde des affaires, c’est pourquoi il est essentiel de bien s’entourer et d’être soutenu par ses proches (c’est mon cas).
J’aime créer, développer une activité, avec l’excitation du challenge, l’aventure, une équipe de talents multiples fédérés autour d’un projet. Au fil des expériences, j’ai tissé des liens étroits avec un réseau d’experts. Nous entretenons des relations humaines riches et sincères basées sur la valeur ajoutée et le respect mutuel.
Cet aspect entrepreneurial vous l’avez en vous ou vous l’avez développé ?
Mon grand-père était entrepreneur et j’ai souvent passé du temps avec lui. Je pense qu’il m’a inspiré et m’a beaucoup apporté à l’époque. Je crois aussi que l’entrepreneuriat se cultive. À l’ESSEC, par exemple, j’ai très vite rejoint la Junior Entreprise où j’ai réalisé de nombreuses missions, dont une en 1983, à l’Agence pour la Création d’Entreprise (devenue l’Agence France Entrepreneur). J’ai rapidement voulu être à mon compte, c’est certainement aussi une histoire de tempérament.
J’aime souvent dire qu’un entrepreneur, c’est à la fois un aventurier, un sportif de haut niveau et un chef d’orchestre. Vaste programme !
Quelle est l’activité de PLIOS aujourd’hui ?
PLIOS est une société créée en 2001, à la fois en réponse à une opportunité et aussi pour me permettre de rebondir rapidement si besoin. À l’époque, nous étions en pleine explosion de la bulle internet et je pressentais qu’il était opportun d’assurer ses arrières.
De par mon réseau et mon expérience, j’ai été de plus en plus sollicité par des dirigeants d’entreprise pour des prestations et j’y ai vu le potentiel de développement en Conseil et en Management de transition. Quelle que soit la taille de l’entreprise ou le secteur, le dirigeant a besoin dans les moments importants de partager ses préoccupations en confiance, de trouver des solutions à des situations complexes et dans des délais courts. Les principales demandes de mes clients portent sur le Business développement, la gestion de trésorerie, le financement ou la croissance externe.
Comment voyez-vous le futur pour vous ou pour PLIOS ?
Je réfléchis actuellement à formaliser et à transmettre mon expérience en m’appuyant sur la digitalisation des contenus (comme créer une chaîne YouTube ou un ensemble tutoriel de vidéos en ligne) pour aider les entrepreneurs ou les dirigeants de TPE à réussir leur aventure entrepreneuriale.
Le monde évolue vite. Il existe aujourd’hui des moyens techniques et technologiques innovants qui permettent de communiquer facilement. C’est une époque incroyablement créative et agile de ce point de vue. Les modèles économiques traditionnels sont challengés par cette transformation numérique et j’ai toujours envie de faire partie de cette passionnante aventure.
Pouvez-vous me donner les chiffres de votre entreprise?
J’ai toujours développé des structures souples, avec peu de salariés, mais avec un écosystème riche et performant. Par exemple, avec DFI Lease, autour de quelques salariés, nous animions plusieurs dizaines de prescripteurs et prestataires pour réaliser 15 millions de CA. Chez HLF, nous réalisions 115 M€ de CA avec 10 salariés et plusieurs dizaines d’apporteurs d’affaires, financiers, développeurs… Chez PLIOS, pas de salariés, mais de nombreux partenariats : management de transition avec Fham+, prescripteurs (dont Club Dynamique !), web marketing, comptable, juristes… J’ai ainsi développé un modèle agile et collaboratif avec un minimum de charges fixes permettant de s’adapter à chaque mission et … d’absorber facilement les aléas du business.
Comment vous êtes-vous financé ?
Pour ma première entreprise, en empruntant le quart du capital (société anonyme). Puis, j’ai découvert que le financement d’équipements, en se refinançant auprès des banques, générerait ses propres ressources financières (BFR négatif pour les spécialistes !) : pour faire simple, plus je signe d’affaires, plus cela génère de trésorerie. Le rêve de tout entrepreneur !
Depuis, j’insiste toujours auprès de mes clients sur l’autonomie financière et l’utilisation prudente et maîtrisée du financement externe (emprunt, levée de fonds…). Un bon entrepreneur doit apprendre à devenir un bon gestionnaire : générer un maximum de cash et le dépenser à bon escient avec un ROI (retour sur investissement) bien calculé. C’est la base de l’indépendance et de la pérennité.
Aujourd’hui, tout le monde veut lever des fonds. Un véritable écosystème existe mais je trouve cela potentiellement dangereux car on peut perdre son indépendance et se retrouver très vite dehors en cas de difficultés. Il faut inclure la gestion du cash dans le business model dès le départ et avoir une véritable stratégie de financement pour contrôler la vitesse de développement et la perte progressive de contrôle au fil des levées de fonds.
J’ai eu des expériences entrepreneuriales parfois violentes : liquidation de ma 1ère boite à cause des difficultés financières de mon principal partenaire, conseillé par un mandataire judiciaire Ad Hoc malhonnête ; conflit avec des actionnaires qui ne respectaient plus les accords signés.
Ces expériences m’ont appris à être prudent et à m’entourer d’experts compétents et dévoués, ce qui m’a permis de toujours rebondir rapidement.
Qu’est-ce que vous retenez de vos expériences entrepreneuriales ?
L’essentiel, d’abord l’humain : travailler dans la durée avec des collaborateurs de confiance pour un projet ambitieux est un réel plaisir. À l’inverse, il faut se séparer très vite des personnes incompétentes, négatives ou malhonnêtes.
Ensuite, développer la capacité de trouver des solutions, s’adapter rapidement ou rebondir pour respecter ses engagements.
Surmonter ensemble les difficultés, célébrer collectivement les succès pour rester soudés dans une énergie positive.
Être à l’écoute des autres et surtout des plus jeunes : je prends beaucoup de plaisir à échanger avec mes enfants qui ont une trentaine d’années ainsi qu’avec les jeunes entrepreneurs. Ce sont eux qui ont les clés du futur.
Enfin, savoir conjuguer vie personnelle et professionnelle. Vivre ses passions et savoir travailler efficacement plutôt que travailler beaucoup. Je joue depuis dix ans dans un groupe de reprises pop-rock JAGH. Nous animons des soirées professionnelles ou privées pour apporter de la joie, de la bonne humeur et faire danser notre public. C’est un groupe composé de dirigeants d’entreprise et nous y gagnons beaucoup en énergie et en équilibre. Cet équilibre de vie est fondamental.
Le vrai challenge pour un entrepreneur, c’est de tenir dans la durée.
Vous pouvez visiter son site internet : www.plios.fr