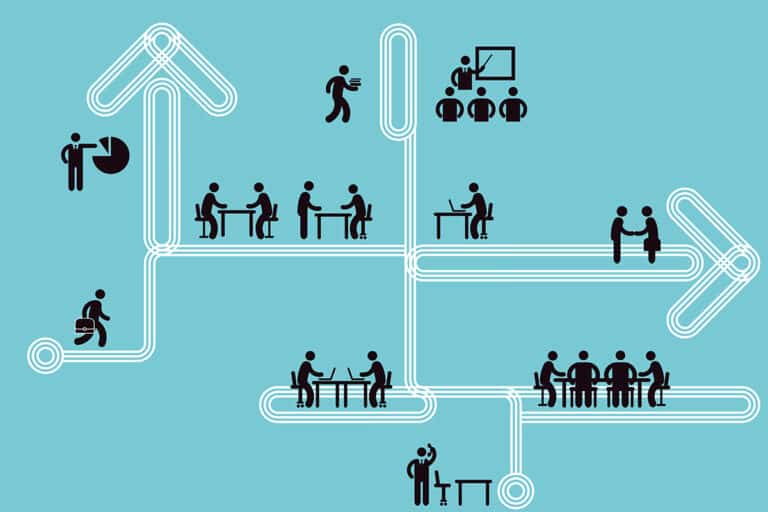Pour de multiples raisons certaines personnes veulent s’associer dans un projet mais ne souhaitent pas apparaître. Ils cherchent ainsi une forme occulte d’association… La société en participation (SEP) est une forme de société qui peut offrir un tel avantage. Elle peut avoir un objet civil ou commercial, et est régie par les articles 1971 à 1872-2 du Code Civil.
De manière générale, la Société en participation reste ignorée des tiers, sauf si tous les participants décident de la révéler. Ainsi, les SEP ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS), elles n’ont pas d’extrait K-bis et n’existent qu’à travers un contrat régularisé entre au moins deux sociétés ou personnes physiques qui s’associent le temps d’une opération, ou plus durablement.
En effet, pour des raisons commerciales, il peut être utile de cacher à son client ses partenaires. La discrétion peut ainsi être recherchée en matière d’appel d’offres lorsque l’entreprise lauréate n’a pas le temps de réaliser le travail (entente secrète). à l’inverse, le client peut demander à ses fournisseurs de créer une société en participation, dans la mesure où il n’aura qu’un seul interlocuteur pour l’opération envisagée. La SEP peut également être utile lorsque des associés souhaitent bénéficier d’un cadre simple uniquement contractuel.
Fonctionnement de la société en participation
Les associés conviennent librement du fonctionnement de la société en participation. Le contrat existant entre les associés d’une SEP définit précisément les apports et rôles de chaque intervenant : l’apport des fonds, l’expertise technique particulière de l’un des associés, etc. étant ici précisé que le partage des bénéfices est également librement fixé par les associés. à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société a un caractère civil ou par les dispositions applicables soit sociétés en nom collectif si elle a un caractère commercial.
Le gérant est nommé par les statuts. Si les statuts ne prévoient rien, tous les associés sont gérants. La société en participation se termine à la date prévue dans les statuts mais également lorsque son objet est réalisé. La société, lorsque le contrat est à durée indéterminée, peut également être dissoute à tout moment par l’un des associés, lequel devra adresser une notification à tous les associés. Cette notification doit être faite de bonne foi et « non faite à contretemps ». Fiscalement, ces entreprises peuvent être déclarées à l’administration fiscale et sont soumises au même régime fiscal que les sociétés en nom collectif. La SEP est traitée comme une entité distincte de la personne de ses membres.
Responsabilité des membres de la société en participation
Dans la mesure où la société en participation n’a pas la personnalité morale, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent ensemble en qualité d’associés à l’égard des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres. Cette responsabilité est solidaire si la société est commerciale et sans solidarité si l’objet de la SEP est civil.
Associés
La SEP compte au moins deux associés, personnes physiques ou morales. La loi ne fixe aucun seuil maximum.
Engagement financier
Aucun apport minimum n’est requis Les associés sont libres de faire des apports en numéraire, en industrie et en nature, ces derniers demeurant la propriété de l’apporteur sauf convention contraire entre les associés. Les biens acquis et les bénéfices réalisés durant la vie de la société figurent à l’actif de la SEP et sont réputés indivis entre les associés.
Régime fiscal de la société
Alors même qu’elle n’est pas immatriculée au RCS, la SEP doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service des impôts des entreprises, produire annuellement une déclaration de ses résultats et tenir une comptabilité régulière.
Le régime fiscal de la SEP est le même que celui des sociétés de personnes si les noms et adresses de tous les associés ont été communiqués à l’administration : ce sera l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu au nom des associés. Si ces informations n’ont pas été transmises, la quote-part de bénéfices des associés non recensés est soumise à l’impôt sur les sociétés au nom du gérant. Enfin, la SEP peut choisir d’être soumise à l’impôt mais cette option est irrévocable.
Régime fiscal des associés
Chaque associé est imposé au titre de l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices qui lui revient dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) pour une activité libérale, des bénéfices agricoles (BA) pour une activité agricole et des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour une activité artisanale ou commerciale. Ce régime ne s’applique que si la SEP n’a pas choisi l’impôt sur les sociétés.
Cela vaut pour les associés indéfiniment responsables dont les noms et adresses ont été communiqués à l’administration
Régime social des associés
S’ils exercent une activité dans le cadre de la SEP, les associés personnes physiques doivent s’immatriculer aux caisses sociales dont ils relèvent selon la nature de cette activité, artisanale, commerciale ou libérale. S’ils n’exercent pas d’activité au sein de la SEP, aucune obligation de ce type ne pèse sur eux.
Régime social du gérant
Le gérant se trouve affilié aux caisses sociales des travailleurs non-salariés qui correspondent à la nature de l’activité exercée.
Transmission
La cession des droits de la SEP nécessite obligatoirement l’unanimité des associés à moins que les statuts n’en disposent autrement. Cette cession est assortie de droits d’enregistrement de 3% à la charge de l’acquéreur avec un plafond fixé à 5 000€. Les plus-values professionnelles peuvent être transmises à la charge du vendeur.
Principaux avantages
Positivement, la SEP se caractérise par l’absence de capital minimum et la liberté offerte aux associés dans le fonctionnement de la société.
Principaux inconvénients
Négativement, la société en participation, SEP, est marquée par l’absence de personnalité morale, les frais et les difficultés résultant de la séparation éventuelle des associés et la nécessité de prévoir dans l’acte constitutif ses règles de fonctionnement de même que les événements potentiellement conflictuels.
Article par PHILIPPE RUFF | AVOCAT À LA COUR