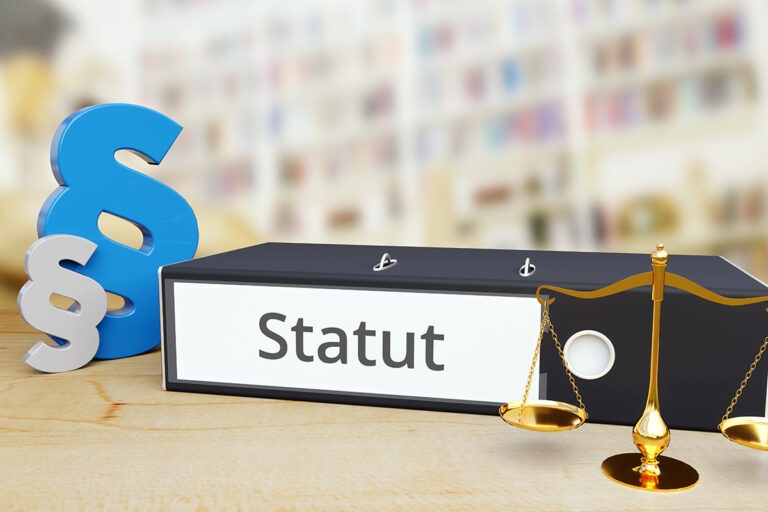Cumuler un emploi avec une activité indépendante c’est possible, à condition de respecter certaines règles. La loi de modernisation de l’économie (LME) favorise la possibilité d’effectuer ce type de cumul grâce à la mesure concernant le statut de l’auto-entrepreneur.
Le cumul est possible pour trois profils de salariés :
- salarié non agricole ou gérance non rémunérée SARL,
- fonctionnaire
- retraité.
La LME a institué le statut d’auto-entrepreneur et la dispense d’immatriculation et déclaration d’activité au CFE.
Attention !
- Si l’activité met en relation le salarié créateur avec les clients de son employeur, il convient d’avoir une autorisation écrite.
- Le principe de concurrence déloyale est applicable.
- Le principe d’honnêteté sur le temps de travail doit être appliqué.
Cumul d’une activité salariée et d’une activité non-salariée
• Sur le plan juridique
Le cumul est possible dès l’instant où le salarié respecte son obligation de loyauté envers son employeur. Sa nouvelle activité doit donc ne pas être susceptible de concurrencer celle de son employeur. Si le contrat de travail du salarié comporte une clause d’exclusivité, celle-ci ne lui sera pas opposable pendant une durée d’un an (ou deux dans certains cas).
• Sur le plan fiscal
Les revenus afférents aux deux activités sont déclarés dans la catégorie qui leur est propre : traitements et salaires, BIC ou BNC selon la nature de l’activité. Avec possibilité d’opter pour le régime de la micro-entreprise lorsque les revenus non-salariés n’excèdent pas une certaine limite
• Sur le plan social
L’intéressé doit cotiser simultanément aux deux régimes, salariés et non-salarié de la sécurité sociale, ainsi que des allocations familiales. Le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève l’activité principale.
A noter :
- Sont considérées comme équivalente à une période salariée (à raison de 6 heures/jour) : les périodes d’arrêt maladie, maternité, ou pour adoption ou accident, les périodes de chômage indemnisé et les périodes de formation professionnelle rémunérée.
- Si l’intéressé est salarié par son activité principale, il n’est pas soumis à la cotisation minimale forfaitaire normalement acquittée auprès du Régime Social des Indépendants (RSI). Il cotise sur la base de ses revenus non salariés réels, même s’ils sont inférieurs à 40 % du plafond de la sécurité sociale et sera dispensé de verser la première année la cotisation provisionnelle forfaitaire d’assurance maladie.
• Détermination de l’activité principale
L’activité non-salariée est présumée être exercée à titre principal. Il en est autrement si l’intéressé a accompli au cours de l’année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui de ses activités non salariés (article R 615-3 du code de la sécurité sociale).
• La retraite
Une double affiliation est obligatoire, mais, en contrepartie, le pluriactif cumulera les prestations acquises dans les deux régimes.
Activité salariée et gérance non remunerée de sarl
• S’il s’agit d’un gérant minoritaire, il n’aura aucune charge sociale à payer au titre de ses fonctions de gérant.
• S’il s’agit d’un gérant majoritaire, il devra s’affilier obligatoirement aux caisses sociales des travailleurs non-salariés.
Les fonctionnaires : le cumul d’activité
- Le cumul est subordonné à l’autorisation de l’administration qui notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la demande de l’agent.
- L’exercice d’une activité bénévole (hors fonction de direction) dans une association sans but lucratif est libre, sous certaines conditions.
- Les créateurs et repreneurs d’entreprise pourront cumuler leurs activités pendant une durée maximale d’un an, renouvelable une fois. Pour cela, cela il leur faut adresser une déclaration écrite (précisant la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activité et les éventuelles subventions dont elle bénéficie) à l’autorité dont ils relèvent, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’entreprise.
- S’il s’agit d’une reprise d’entreprise, l’agent ne doit pas avoir exercé un contrôle sur celle-ci ou participé à l’élaboration ou à la passation de marchés publics avec elle au cours des trois dernières années.
Focus sur le statut d’auto-entrepreneur
Il s’agit d’un ensemble de mesures permettant d’exercer une petite activité professionnelle indépendante facilement, de façon régulière ou ponctuelle, en minimisant les coûts administratifs. Attention, le chiffre d’affaires ne doit pas excéder 80 000 euros HT pour une activité de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement et 32 000 euros HT pour une autre activité de services.
Qu’en est-il des professions libérales ?
Elles ne sont pas concernées par la première mesure (dispense d’immatriculation), car elles n’ont déjà à faire qu’une déclaration de leur activité auprès du CFE de l’URSSAF. Elles pourront cependant bénéficier des autres mesures visées ci-dessus, dès l’instant où elles sont exercées en entreprise individuelle et que leurs recettes se situent en dessous du seuil d’application du régime fiscal de la micro-entreprise (32 000 euros).
Dispense d’immatriculation pour les salariés/retraites/fonctionnaires, déclaration d’activité au CFE
Personnes concernées : toute personne physique souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale, à titre principal ou complémentaire sous le régime fiscal de la micro-entreprise et en optant pour le régime micro-social. Concerne notamment les salariés, les retraités et les fonctionnaires qui veulent créer une activité complémentaire.
A noter
Les salariés qui créent ou reprennent une entreprise peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations sociales dues au titre de leur activité indépendante. Elle a une durée d’un an et s’applique à condition de justifier d’au moins 910 heures d’activité salariée au cours des 12 mois précédant la création ou la reprise d’entreprise et d’au moins 455 heures d’activité salariée au cours des 12 mois suivants la création ou la reprise d’entreprise.
A savoir
- Dispense d’immatriculation. Une simple déclaration d’activité auprès du CFE compétent est suffisante pour démarrer l’activité.
- L’auto entrepreneur peut cesser son activité par une simple déclaration. Attention ! Cette mesure ne le dispense pas de remplir les conditions légales et/ou réglementaires imposées pour l’exercice de l’activité en question.
- Paiement des cotisations sociales selon les modalités du régime « micro-social ». L’auto entrepreneur paie ses charges sociales en fonction au chiffre d’affaires réellement réalisé.
- L’application du régime fiscal de la micro-entreprise et de la franchise de TVA.
- L’auto entrepreneur pourra payer sous certaines conditions l’impôt sur le revenu en appliquant un pourcentage sur le CA réalisé.