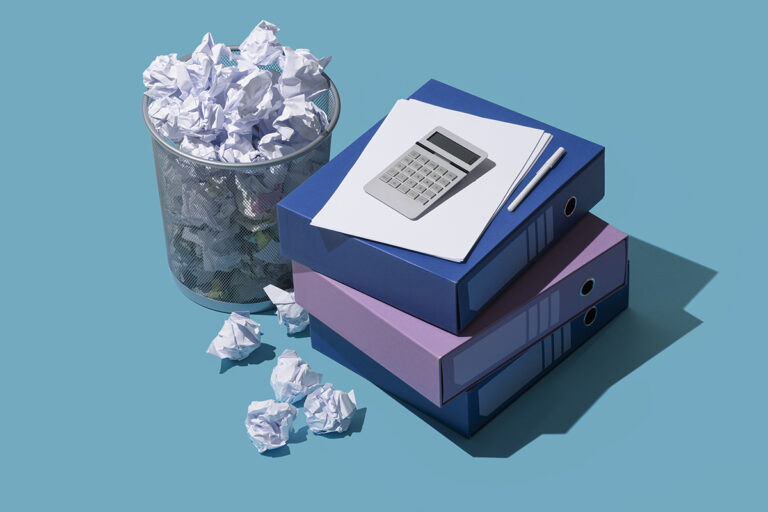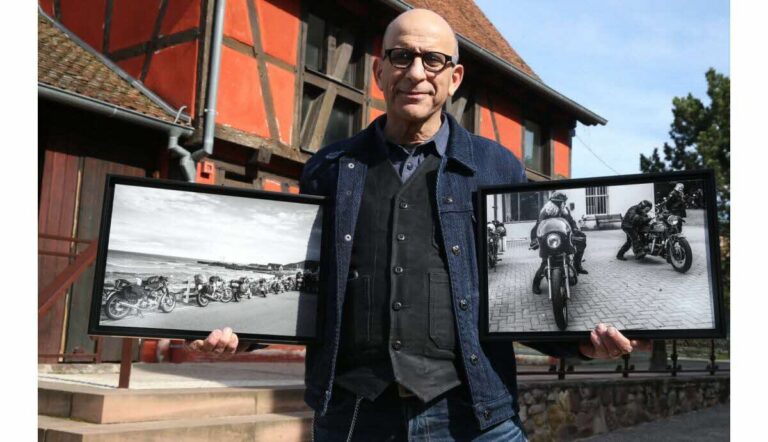Le développement durable est un véritable enjeu mondial et une opportunité commerciale évidente. Il est important de faire la part des choses dans cette médiatisation qui génère autant d’inquiétude, de mobilisation que de répulsion face aux abus marketing. Cette problématique bénéficie-t-elle d’un véritable écho ? Comment se situe la France dans ce contexte international ? Quels sont les espoirs de trouver des solutions durables dans ce monde fragile et instable ?
L’entreprise durable : une harmonie tactique
L’éclosion du phénomène de « développement durable », pousse les entreprises à identifier, au delà de la logique purement écologique, des critères qui pourraient assurer la pérennité de leur existence. Ainsi, bien loin des débats de croissance et de parts de marchés, ce label d’entreprise durable se veut avant tout équilibré pour les hommes, pour les structures et pour leur environnement. C’est tout simplement une réflexion de bons sens. A l’image du slogan du groupe MICHELIN, « Les plus belles performances sont celles qui durent », la logique du « Développement Durable » donne un renouveau aux critères de performance des entreprises actuelles.
Alors que nous avions tendance à croire que ce concept n’avait de sens, que pour des entreprises confrontées aux problématiques énergétiques ou dont les matériaux utilisés devaient respecter l’environnement, nombreux sont ceux qui voient dans les fondements du développement durable, les conditions appropriées au succès des entreprises modernes. Ainsi, les trois critères fondamentaux font de ces entreprises des sociétés économiquement viables, socialement équitables et respectueuses de leur environnement.
Un équilibre nécessaire
Et loin d’une simple utopie pour consultant, cette prise de conscience s’avère aujourd’hui vitale pour résister dans une économie qui s’internationalise à grands pas, réduisant les distances vis-à-vis de nouveaux fournisseurs, des clients, comme des concurrents. Mais au-delà de ces trois critères d’ores et déjà respectés par de nombreuses entreprises, c’est avant tout l’équilibre de l’énergie portée sur ces trois conditions qui font de l’entreprise, une aventure pérenne.
En effet, nous avons tous autour de nous des exemples d’entreprises dont les qualités économiques sont exceptionnelles, mais dont les conditions humaines du travail ne peuvent durer dans le temps. D’autres sont dites citoyennes, veillant tant au bien-être de leurs collaborateurs qu’à leur gestion énergétique, mais dont la logique financière est un gouffre inacceptable, nécessitant l’intervention permanente de l’Etat ou du citoyen lui-même pour combler ces déficits. Certains surfent sur la vague du boom économique des produits écologiques, mais sans pour autant être cohérents en matière énergétique ou suffisamment à l’écoute de leurs collaborateurs.
Les entreprises durables seront donc celles qui réussiront à gérer le plus harmonieusement possible, ces dimensions humaines, financières et environnementales. Ainsi, depuis que le monde est monde, nous vivons des équilibres instables, précaires, mais sources de capacité d’imagination et d’adaptabilité aux grandes ruptures. Et comme nous cherchons à mieux équilibrer nos vies dans notre vie (amicale, familiale, d’entreprise et des hobbies), l’entreprise sera une aventure durable si elle veille à respecter ces points.
Un climat social à construire
Ces entreprises doivent donc construire un climat social permettant l’épanouissement de leurs collaborateurs, pour que le mot « travail » dont les origines étymologiques issues du latin « tripalium » (instrument de torture) puisse laisser place à une véritable « récréation », favorisant le plaisir de satisfaire ensemble les clients. L’efficacité de ces entreprises doit être basée sur l’adaptabilité, l’innovation et l’anticipation pour que leurs résultats financiers permettent l’enrichissement des compétences.
Enfin la prise de conscience environnementale n’est pas qu’une question de mode temporaire favorisant les messages marketing, mais bel et bien une condition sine qua none, du développement durable dans le respect écologique de son environnement.
L’innovation à l’échelle internationale
L’innovation technologique est au cœur des solutions de développement durable. Après une communication basée sur le catastrophisme remuant les consciences, l’heure est à l’application individuelle de solutions efficaces Les innovations technologiques, fidèles à la fameuse loi des 3 C (Cleve, Clean and Competitive) sont nombreuses et réellement source d’espoir pour le futur.
Je pense à ces solutions d’auto gestion interactive de la consommation énergétique apportant des économies de plus de 50 % dans les bâtiments actuels, à de nouveaux capteurs d’énergie solaire qui suivent le parcours des rayons du soleil concentrant davantage la chaleur, à ces voiles de Kite qui équiperont les bateaux de croisières et autres cargos pollueurs des mers, réduisant ainsi de moitié leur consommation de carburant, à ces nano-membranes filtrant l’eau la rendant potable, à ces nouvelles piles flexibles recyclables de la taille d’un ticket de métro qui à base de nanotechnologies permettent de générer de l’énergie, par simple différence de température de quelques degrés, des ascenseurs à eau de mer fixant quotidiennement 100 millions de tonnes de carbone au cours d’un processus naturel.
Les innovations ne manquent donc pas, pour trouver des solutions respectant les trois dimensions écologiques, sociales et économiques. Ces technologies ont un apport direct pour l’environnement : la vidéoconférence, le télétravail peuvent permettre de diminuer directement les impacts environnementaux de l’activité humaine. Les technologies de l’information permettent l’organisation du covoiturage, du partage de propriété des voitures, facilitent les transports en commun.
L’impact des innovations
Elles ont un apport direct pour l’économie : c’est à travers le développement de compétences que la société évolue en profondeur. Ce besoin de compétence se couple au besoin de recherche pour encourager l’innovation en matière de TIC et d’efficacité énergétique au sens large. De nombreux secteurs économiques peuvent en profiter : des modes de transport moins gourmands en carburant, des bâtiments plus efficaces en matière énergétique (eau, carbone) etc. Il est à rappeler que les transports et le bâtiment représentent aujourd’hui plus de 50 % des pollutions.
Les outils de management environnemental permettent d’identifier et de mettre en œuvre des démarches de progrès importantes. Ils sont un apport direct pour l’équilibre social : toute démarche de développement durable est fondée sur la participation, la gouvernance. C’est tout l’enjeu du collectif, du collaboratif. Il est envisageable de réellement parler de cogestion, de codécision, de coproduction.
Des mesures à prendre
Pour cela, il convient de faire progresser réellement le niveau culturel global, et donc d’éduquer et de former. En Californie, la bulle Internet semble bien lointaine ! Sous l’impulsion du gouverneur californien Arnold Schwareznegger, la « Silicon Valley » veut se positionner comme le centre de Recherche et Développement mondial, des Technologies de l’Information du développement durable.
Une politique musclée à coups de millions de dollars pour apporter des solutions concrètes au respect de la planète. Alors que les USA sont parmi les plus gros pollueurs de notre belle planète, l’état de Californie montre l’exemple en étant le premier état américain à avoir de fait, adopté le protocole de KYOTO, obligeant l’état à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. Et fidèle à la réactivité du « Golden State », les sociétés de capital risque californiennes ont très bien compris que le Développement Durable est probablement la plus forte opportunité économique du XXIème siècle.
L’engagement de l’administration californienne permettra la création de 100.000 emplois et le développement de 4 milliards de dollars de valeur ajoutée. Par ce type d’actions réunissant des politiques, des industriels, des scientifiques et des financiers, l’état californien souhaite devenir l’épicentre des « technologies vertes ».
La France est au cœur de l’action
Dans ce contexte international, la France est au cœur de l’action, étant elle-même très impliquée dans ces problématiques via le transport, l’énergie, l’agriculture et le tourisme. Dans ce cadre, le sillon rhodanien est en train de devenir un terrain fertile aux projets de développement durable.
Capitalisant le savoir-faire de nombreuses entreprises spécialisées dans les technologies de l’information, les projets naissent rapidement dans une dynamique de réseaux synergiques, alliant les compétences du design stéphanois, les nanotechnologies grenobloises, le « serious game » lyonnais
Ainsi voit-on diverses solutions technologiques jouer leur rôle dans les projets de développement durable : sondes wifi d’information de la qualité environnementale de l’air et de l’eau, des solutions de gestion interactive d’énergie solaire apportant des économies de 50 %, de nouvelles piles flexibles génératrices d’énergie.
C’est en s’appuyant sur cette richesse naturelle, en développant des expériences dignes de sens, et en poussant les acteurs variés à coopérer, que cette « Silicon Valley du développement durable Française » peut naître. C’est donc en jouant la « glocalisation » (vision internationale et capitalisation locale), en poussant les coopérations en réseau, entre acteurs aux compétences variées, et en capitalisant les expériences que ces territoires peuvent donner lieu à de grands projets aux résonances internationales.
Une complexité des enjeux
Ce contexte international ne doit pas occulter la véritable complexité des enjeux qui sont devant nous. Pendant que de nombreuses mesures sont prises pour lutter contre une meilleure gestion de ressources planétaires, des gaspillages et des catastrophes écologiques viennent tous les jours réduire à néant cette colossale énergie dépensée pour inverser la tendance actuelle.
Certes, les nombreuses communications sur les conséquences catastrophiques du réchauffement de la planète ont véritablement engendrées une prise de conscience collective, mais il reste encore beaucoup de travail pour faire changer les comportements individuels. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui laissent le moteur de voiture fonctionner, alors qu’ils sont en train de vider des emballages dans les containers de recyclages prévus à cet effet.
Stratégies durables : l’affaire de tous
Aujourd’hui la réalité de l’avancée est une affaire de tous, où chaque individu apporte un peu de son action, de son expérience. Et, comme le définit Michel Serres : « La science, c’est ce que les parents apprennent aux enfants, la technologie, ce que les enfants apprennent aux parents ». L’intégration des technologies dites vertes dans notre quotidien familial comme entrepreneurial est issue de la volonté de tous, et non pas d’une décision étatique ou purement économique. A l’image de ce qui se passe dans le monde des technologies de l’information avec le succès des blogs, des forums c’est avant tout les nombreux échanges d’expériences qui donnent lieu à des succès applicatifs.
Chaque individu, chaque entreprise, chaque association, chaque politique, a sa part de responsabilité dans sa capacité à expérimenter, à coopérer et transmettre le fruit de ses succès. C’est sans doute à ce prix que le changement comportemental donnera des résultats visibles à l’échelle internationale. Ceci, en veillant à ce que notre attitude face aux technologies propres évolue progressivement de contre-active à réactive, puis de pro-active à interactive. Le développement durable est une condition vitale de la survie de l’humanité.
La communication de la part des entreprises, qui ont parfaitement compris les enjeux économiques et les opportunités marketing associées, doit être maniée avec grande précaution. L’effet boomerang d’une communication mercantile exagérée serait évidement lourde de conséquences. Les changements sont donc en cours, mais veillons à rester vigilants afin que la trilogie du développement durable (équitable, économique, écologique) ne devienne pas un argument marketing plus important que la réalité de ses mises en œuvre, vitales pour notre avenir et celui des générations futures.
Article par Bertrand Lazare