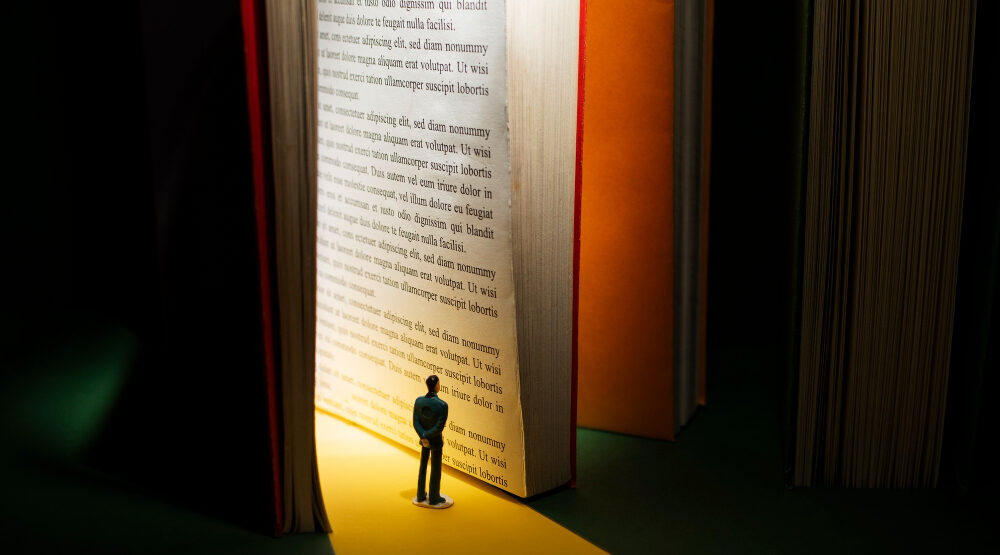Depuis une décennie, le mot « disruption » est devenu un mantra dans les boardrooms, les incubateurs et les conférences internationales. On l’invoque comme une sorte de Graal entrepreneurial : chaque startup, chaque produit, chaque initiative se doit de « casser les codes », de « bouleverser les industries » ou de « révolutionner l’expérience client ». Mais derrière ce storytelling séduisant se cache une réalité moins glorieuse : la majorité des entreprises et des entrepreneurs reproduisent les mêmes modèles, revisitent les mêmes idées et, paradoxalement, échouent à créer de nouveaux cadres véritables.
Pour les dirigeants et créateurs d’entreprise, comprendre pourquoi ce phénomène se produit est essentiel. Car si la disruption est devenue un totem rhétorique, l’innovation véritable – celle qui construit des cadres durables plutôt que de briser des règles éphémères – reste rare et précieuse.
Le storytelling de la disruption : un concept devenu banal
La disruption, popularisée par Clayton Christensen dans les années 1990, décrit un processus précis : l’émergence d’innovations qui changent radicalement la manière dont un marché fonctionne, souvent en commençant par des segments négligés avant de dominer l’industrie. Le concept est rigoureux, analytique et repose sur l’observation du marché, des technologies et des comportements.
Mais le storytelling qui l’entoure aujourd’hui a pris une tournure plus symbolique qu’opérationnelle. Dans les présentations, les communiqués de presse et les pitchs de startups, « disruption » est devenu synonyme de « cool », « radical » ou « iconoclaste ». Le problème, c’est que ce storytelling transforme la disruption en un impératif performatif : il faut sembler révolutionnaire, même si l’innovation réelle est mineure ou marginale.
En pratique, beaucoup d’entreprises se contentent de réinterpréter des modèles existants, de peindre en rouge ce qui était bleu, ou de promettre de « casser les codes » sans jamais poser de nouveau cadre qui structure durablement l’expérience client ou le fonctionnement du marché.
Pourquoi casser les codes est devenu un réflexe
Le désir de « casser les codes » répond à plusieurs motivations compréhensibles :
Pression du marché et des investisseurs :
dans un écosystème obsédé par la croissance rapide et les levées de fonds, les mots « innovation radicale » et « disruption » attirent l’attention et la crédibilité.
Culture médiatique :
les médias adorent les histoires de révolutions et de ruptures. Un produit disruptif se vend mieux qu’un produit qui améliore subtilement un marché existant.
Psychologie entrepreneuriale :
les fondateurs et dirigeants aiment se percevoir comme des avant-gardistes, des visionnaires capables de briser des normes et de défier les idées reçues.
Cette combinaison crée un biais puissant : l’action est valorisée si elle semble disruptive, mais l’ampleur réelle de l’innovation importe moins que la narration qui l’accompagne.
La fracture entre disruption narrative et création de cadres
Le véritable changement ne réside pas seulement dans la rupture, mais dans la capacité à créer un nouveau cadre : un ensemble de règles, de standards et de structures qui redéfinissent durablement un marché, une expérience ou une organisation.
Airbnb, par exemple, n’a pas seulement cassé les codes de l’hôtellerie : la plateforme a créé un nouveau cadre d’hospitalité. Uber, malgré la polémique qui l’entoure, a mis en place un cadre de mobilité urbaine basé sur l’accessibilité instantanée et la notation des conducteurs. Spotify a redéfini l’accès à la musique en instituant un modèle freemium qui a structuré l’industrie. Dans chacun de ces cas, l’innovation va au-delà de la rupture : elle invente des règles nouvelles et cohérentes qui permettent à l’écosystème de fonctionner autrement.
Or, ces exemples sont l’exception plutôt que la norme. Beaucoup de prétendues disruptions sont des « copies améliorées » ou des ajustements cosmétiques : elles cassent une règle superficielle mais ne créent pas de cadre nouveau qui transforme le marché de façon pérenne.
Les conséquences pour les entreprises
Se concentrer uniquement sur la rupture plutôt que sur la construction de cadres a des conséquences concrètes :
- Épuisement des équipes : les employés sont poussés à être constamment radicaux et créatifs, sans vision claire de la direction.
- Dilution stratégique : les initiatives semblent innovantes à court terme mais ne génèrent pas de valeur durable.
- Perte de crédibilité : lorsque le storytelling ne correspond pas à la réalité, clients et investisseurs deviennent sceptiques.
À terme, cette obsession de la disruption performative peut créer un environnement où la véritable innovation est étouffée : les équipes ont peur de créer lentement mais solidement, car cela ne correspond pas à la narration attendue.
Réhabiliter la création de cadres
Si casser les codes n’est plus suffisant, que devraient faire les dirigeants et créateurs d’entreprise ? La réponse réside dans le concept de création de cadres :
- penser l’innovation comme un moyen de structurer,
- harmoniser
- enrichir l’écosystème plutôt que simplement le perturber.
- Identifier les règles implicites : toute industrie fonctionne selon des normes, explicites ou tacites. Comprendre ces règles permet de décider lesquelles méritent d’être challengées et lesquelles peuvent être utilisées pour construire un nouveau cadre.
- Créer des standards cohérents : un cadre ne se limite pas à un produit ou à une technologie. Il inclut des pratiques, des interfaces, des expériences et même des modèles économiques. La cohérence transforme la rupture en levier durable.
- Impliquer l’écosystème : les cadres efficaces ne sont pas imposés unilatéralement. Ils émergent de l’interaction entre acteurs, clients et partenaires. La disruption narrative seule ne suffit pas : il faut co-construire les nouvelles règles.
En adoptant cette approche, les entreprises peuvent devenir de véritables architectes de marché plutôt que des casseurs de règles isolés.
Le rôle du leadership dans ce changement
Réhabiliter la création de cadres exige un leadership différent. Les dirigeants doivent :
- valoriser la patience : construire un nouveau cadre prend du temps et ne se traduit pas par des titres sensationnels ou des levées de fonds immédiates.
- encourager la rigueur : les équipes doivent réfléchir aux implications de chaque innovation sur l’ensemble du marché, et pas seulement sur le produit ou le service.
- célébrer l’apprentissage : même si un cadre ne réussit pas immédiatement, l’expérimentation fournit des enseignements précieux pour la prochaine initiative.
Ce leadership n’est pas incompatible avec la disruption : il la canalise et la transforme en une force structurante plutôt qu’en une communication performative.
Comment passer du storytelling de disruption à la création de cadres
Pour les dirigeants et créateurs, transformer cette vision en pratique nécessite plusieurs étapes concrètes :
Recentrer la narration interne :
plutôt que de communiquer sur « casser les codes », parlez de « structurer de nouvelles expériences » ou de « construire des standards durables ».
Mesurer la valeur systémique :
au lieu de mesurer uniquement le buzz ou la croissance immédiate, évaluez l’impact sur l’écosystème, la cohérence et la pérennité.
Encourager la réflexion systémique :
chaque initiative doit être évaluée en termes de nouvelles règles qu’elle impose ou transforme, plutôt que sur son caractère superficiellement disruptif.
allouer du temps et des ressources : créer un cadre nécessite de l’expérimentation, de la recherche et des itérations. Les entreprises doivent accepter que le retour sur investissement ne soit pas immédiat.
En adoptant ces pratiques, le storytelling de la disruption cède la place à une démarche stratégique plus profonde, capable de créer un impact réel et durable.